OLBIE OU ESSAI SUR LES MOYENS DE REFORMER LES MŒURS D’UNE NATION
JEAN-BAPTISTE SAY
(1800)
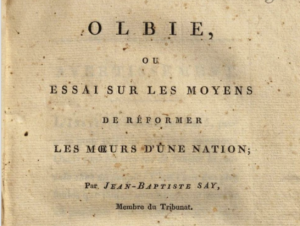
PRÉFACE
OLBIE : L’ŒUVRE OUBLIÉE DE JEAN-BAPTISTE SAY
(éditions Institut Coppet — 2014)
Jean-Baptiste Say est resté célèbre pour un livre, le Traité d’économie politique, qu’il fit paraître en 1803, à l’âge de 36 ans. Cette publication ne lançait pourtant pas le début de sa carrière littéraire. Malgré son jeune âge, Jean-Baptiste Say s’était déjà mêlé à l’époque à plusieurs questions controversées, et notamment, dès 1789, celle de la liberté de la presse. [1] Profitant des temps libres que lui laissait son métier d’employé de banque, Say avait également écrit deux pièces de théâtre, La Tante et le Prétendu, et Le Curé Amoureux, puis un opéra comique, Les Deux Perdrix. En 1800, il avait surtout publié un court texte, qui marqua un tournant dans sa carrière et anticipa sa gloire future : Olbie, ou Essai sur les moyens de réformer les mœurs d’une nation.
Jean-Baptiste Say était né à Lyon le 5 janvier 1767, de Françoise Castanet et de son mari Jean-Estienne Say, un commerçant lyonnais originaire de Genève.
À cette époque, la jeune science de l’économie politique était déjà en ébullition. En France, les Physiocrates étaient à la mode. En 1767, le livre de Mercier de la Rivière, L’Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, faisait sensation, au point que Catherine II l’appelait auprès d’elle en Russie. Cette même année, les Physiocrates mettaient sur pied leur journal d’économie, les Éphémérides du Citoyen, et Turgot, qui leur était proche, écrivait son chef-d’œuvre intitulé Formation et distribution des richesses. À quelques centaines de kilomètres de la France, enfin, un professeur Écossais, Adam Smith, à peine revenu d’un long périple à travers toute l’Europe, entamait la rédaction de ce qui deviendrait la Richesse des Nations.
Naître à une telle époque était une chance, ainsi que l’exprimera bien Albert Thibaudet : « Qui aura vécu sa jeunesse sous Louis XVI, sa maturité sous la Révolution et l’Empire, sa vieillesse sous la Restauration, tiendra dans sa mémoire un des morceaux de durée les plus variés et les plus puissants que l’histoire ait permis. » [2]
Ce jugement, ô combien vrai à bien des égards, sous-estime pourtant l’importance du développement de la science économique, qui se fit parallèlement au début de la vie de Jean-Baptiste Say, avant de se faire avec et par lui.
Or pour comprendre comment s’est effectuée la rencontre de Say avec la science économique, il est nécessaire de lire Olbie.
***
C’est au début de la décennie 1790, si troublée pour la France, que Jean-Baptiste Say fit cette rencontre. Il venait de rentrer d’un long séjour en Angleterre, et de se faire embaucher par Étienne Clavière, futur ministre des finances et alors simple administrateur d’une compagnie d’assurance. C’est dans la bibliothèque de cet homme qu’il eut la chance de trouver un exemplaire, en anglais, de The Wealth of Nations. Plus tard, Jean-Baptiste Say racontera à son frère : « Clavière avait un exemplaire de Smith qu’il étudiait fréquemment ; j’en lus quelques pages dont je fus frappé, et aussitôt que je le pus j’en fis venir un exemplaire que j’ai encore. » [3]
Mais mettre en application les principes de Smith, ou les répandre en France, n’était pas encore possible pour notre jeune homme. Bien qu’il fût un temps employé au Courrier de Provence de Mirabeau, son poste ne consistait qu’à recevoir et gérer les abonnements. Ce n’est qu’en 1794 qu’il fut lui-même, à proprement parler, un journaliste. Il prit la direction d’un nouveau journal, intitulé La Décade philosophique, littéraire et politique, avec cette devise : « Les lumières et la morale sont aussi nécessaires au maintien de la République que le fut le courage pour la conquérir. » Soit que sa lecture d’Adam Smith n’ait pas encore porté ses fruits, soit qu’il n’ait pas trouvé d’occasions pour les traiter, les questions économiques étaient étonnamment absentes des articles du jeune rédacteur en chef.
Il faudra attendre 1798, et un concours de l’Institut National, d’où naquit Olbie, pour voir Jean-Baptiste Say s’exprimer en tant qu’économiste.
Dans cet ouvrage, certainement, Say ne développe pas uniquement ni même principalement des réflexions économiques. Le sujet de son mémoire est bien plutôt, ainsi que l’indique le sous-titre, un « essai sur les moyens de réformer les mœurs d’une nation ». Mais en connaisseur des leçons de l’économie politique, Say a bien conscience du fait que les principes de cette science constituent la base sur laquelle, justement, il faut réformer les mœurs d’une nation.
C’est par la connaissance, c’est par l’instruction et le savoir, nous dit d’abord Jean-Baptiste Say, que la morale peut faire le plus grand progrès, et que la société peut avancer vers un degré plus élevé de civilisation. Say écrit :
« Les hommes instruits, en général, font moins de mal, commettent moins de dégâts que ceux qui ne le sont pas. L’homme qui a étudié l’agriculture, et qui sait ce qu’il faut de soins pour faire pousser une plante, pour élever un arbre, celui qui connaît leurs usages économiques, sont moins près de les détruire, que l’ignorant chez qui ces précieuses productions ne réveillent aucune idée. De même, l’homme qui a étudié les bases sur lesquelles se fondent l’ordre social et le bonheur des nations, ne les sape jamais sans répugnance. » [4]
« Mais c’est principalement en nous éclairant sur nos propres intérêts que l’instruction est favorable à la morale. Le manouvrier qui boit en quelques heures ses profits de la semaine, qui rentre chez lui pris de vin, bat sa femme, corrompt par son exemple des enfants qui pourraient devenir l’appui de sa vieillesse, et qui enfin ruine sa santé et meurt à l’hôpital, calcule moins bien que cet ouvrier diligent qui, loin de dissiper ses petites épargnes, les accumule, ainsi que leurs intérêts, se fait un sort sur ses vieux jours, et passe l’âge du retour au sein d’une famille active qu’il a rendue heureuse, et dont il est adoré. » [5]
Cette connaissance, ainsi que ces deux citations le font déjà sentir, est en grande partie économique. Les principes de l’économie politique sont en effet ceux qui présentent « les bases sur lesquelles se fondent l’ordre social et le bonheur des nations » et qui exposent les vertus de l’épargne et de la tempérance. D’où il résulte, pour Say, que la science économique est une « science importante, la plus importante de toutes ». [6]
La connaissance de ses principes est, selon notre auteur, d’une nécessité tout à fait impérieuse. Ce fait lui fait écrire des mots qui sonnent d’une manière toute particulière quand on connait la carrière future de Say :
« Quiconque ferait un Traité élémentaire d’économie politique, propre à être enseigné dans les écoles publiques, et à être entendu par les fonctionnaires publics les plus subalternes, par les gens de la campagne et par les artisans, serait le bienfaiteur de son pays. » [7]
En effet, bien que négligée par les peuples, la science de l’économie politique est pourtant celle qui lui enseigne comment ils s’enrichissent.
« L’indigent, assailli par tous les besoins, regarde des signes noirs empreints sur des feuilles blanches, comme une savante futilité. Il ignore que les plus sublimes connaissances, que les utiles notions de l’économie politique, par exemple, sources fécondes de la prospérité et du bonheur des nations, sont cachées sous les caractères qu’il méprise, et que si ses aïeux avaient su en soulever le voile, il ne serait pas, lui, réduit à partager avec sa grossière famille un morceau de pain noir sous une hutte de sauvage. » [8]
Jean-Baptiste Say, lui si versé dans les matières économiques, ne s’avise pourtant pas de vouloir devenir un conducteur de peuple, qui, pour reprendre le mot de Voltaire, forcerait les Français à devenir heureux. [9] Si l’instruction est si nécessaire, continue ainsi Say, c’est aussi parce que la force ne suffira jamais à rendre un peuple moral et sage :
« Nous voulons que les hommes se conduisent bien. Suffit-il de le leur commander ? Le premier de nos maîtres, l’expérience, nous dit que non. Si les meilleurs préceptes, appuyés de l’autorité des lois, de l’ascendant de la force, de la sanction divine, suffisaient pour rendre les hommes vertueux, il n’est pas de nation qui ne fût un modèle de toutes les vertus ; car il n’en est pas une dont les lois ne commandent de bien vivre ; il n’est pas de religion qui ne menace le pécheur de punitions effrayantes, et qui ne promette des récompenses magnifiques à l’homme de bien. Que sont cependant ces nations si bien endoctrinées ? En est-il une seule où l’homme ambitieux n’ait pas écrasé ses rivaux ; où la vengeance n’ait pas exercé ses fureurs ; où l’amour du lucre n’ait pas inspiré les tromperies les plus honteuses et les plus viles prostitutions ? » [10]
« Si les lois divines et humaines ont si peu de pouvoir pour fonder de bonnes mœurs, où faut-il en chercher les moyens ? Dans le cœur de l’homme. « Quiconque se mêle d’instituer un peuple, dit Rousseau, doit savoir dominer les opinions, et par elles gouverner les hommes ». Si l’on veut que telle manière d’être, telle habitude de vie s’établisse, la dernière chose à faire est donc d’ordonner que l’on s’y conforme. Voulez-vous être obéi ? Il ne faut pas vouloir qu’on fasse : il faut faire qu’on veuille. » [11]
« On a fait de mauvais républicains chaque fois qu’on a voulu rendre les hommes tels, le pistolet sur la gorge. On a conquis l’apparence, tout au plus. Il en serait de même de la vertu : la violence ne peut que lui ôter de ses grâces et de ses attraits. La sotte pruderie que tout le monde fut forcé d’affecter dans les dernières années de Louis XIV, produisit les dérèglements de la régence. » [12]
C’est donc par l’éducation, c’est par la diffusion toujours plus étendue des principes de la morale et de la science de l’économie politique, que les citoyens pourraient être mieux informés sur ce qui constitue leurs intérêts, et tout le livre Olbie est consacré à prouver cette assertion.
***
L’avantage des écrits de jeunesse, qu’ils soient de Marx ou de Say, c’est qu’ils renseignent sur le projet global de l’auteur, sur ses intuitions fondamentales, mais aussi sur les différentes étapes qu’on dû franchir ses idées.
De ce point de vue, Olbie ne nous déçoit pas : ce petit livre nous fournit bien une image différente de Say que son Traité et que ses ouvrages d’économie ultérieurs.
Libéral, Jean-Baptiste Say est loin d’être insensible aux souffrances du peuple. On le voit critiquer l’inégalité des richesses et recommander l’épargne aux ouvriers pour améliorer leur condition, notamment à travers l’établissement de caisses de prévoyance. Mieux : en apprenti économiste, il en étudie en détail le fonctionnement, pour montrer pourquoi les ouvriers pourraient y trouver effectivement une solution à certaines de leurs difficultés. Il précise même qu’il faudrait que l’État ne vienne pas troubler le fonctionnement de cette salutaire institution privée.
« Dans nos villes, il y a actuellement un grand nombre de professions dans lesquelles les ouvriers gagnent en six jours leur dépense de dix. Ils pourraient donc, en se réservant un jour pour le repos, mettre de côté la valeur de trois journées par décade. Dans les villes, chaque journée peut être évaluée deux francs : ainsi un ouvrier pourrait, avec de la conduite, mettre six francs tous les dix jours à la caisse d’épargnes. Or un homme qui, à l’âge de vingt ans, mettrait tous les dix jours de côté six francs jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, toucherait à cet âge, par l’effet des intérêts accumulés à cinq pour cent, un capital de près de vingt mille francs ; mais pour que l’ouvrier ait confiance dans une caisse d’épargnes, il ne faut pas qu’il puisse redouter les conceptions fiscales d’un gouvernement versatile, qui serait capable, l’année suivante, de supprimer ou de dénaturer l’établissement. » [13]
Il nous apparaît aussi comme un féministe avant l’heure, en phase en cela avec toute la tradition libérale, de John Stuart Mill à Yves Guyot en passant par Paul-Leroy Beaulieu. [14] Reconnaissant que « la nature a généralement donné aux femmes les qualités morales dans un plus haut degré qu’à nous », Say écrit par exemple, sur le sujet de l’éducation :
« Nous devons aux femmes, nos premières connaissances et nos dernières consolations. Enfants, nous sommes l’ouvrage de leurs mains : nous le sommes encore quand nous parvenons à l’état d’hommes. Leur destinée est de nous dominer sans cesse, par l’empire des bienfaits, ou par celui des plaisirs ; et là où elles ne sont pas vertueuses, c’est en vain que nous voudrions le devenir. C’est par l’éducation des femmes qu’il faut commencer celle des hommes. » [15]
Say nous surprend plus lorsqu’il s’aventure à défendre l’impôt progressif, qu’il considère équitable « par cette raison que dans l’état de civilisation, l’augmentation de revenu est d’autant plus difficile, que le revenu est moindre. Suivant un dicton populaire, les premiers cent écus sont plus durs à gagner que les derniers cent mille francs. » [16]
Il nous étonne encore quand il nous parle de la « grande vénération » qu’il a pour Rousseau et de la « persuasion où je suis que ses écrits seront au nombre de ceux qui contribueront le plus au perfectionnement futur de l’espèce humaine ». [17]
Sa condamnation de l’égoïsme, bien que différente de l’image traditionnelle du libéralisme économique, est cependant dans la lignée des écrits d’Adam Smith sur la philosophie morale. Ainsi, quand Say évoque le « sentiment qui nous fait compatir aux affections des autres » et qu’il le présente comme un « sentiment précieux, l’opposé de l’égoïsme, un des plus beaux attributs de l’homme »[18], il ne fait que reproduire l’une des idées-forces de la Théorie des sentiments moraux du maître écossais, qu’il avait pu consulter dans l’une des trois traductions françaises disponibles. [19]
Et cependant, malgré certains traits qui peuvent le rendre méconnaissable, Jean-Baptiste était déjà le partisan d’un libéralisme des plus vigoureux, parfaitement en phase avec les enseignements de cette science de l’économie politique dont il s’était fait l’élève. À l’occasion d’une discussion sur le commerce, Say prend ainsi le soin de s’affirmer partisan du libre-échange intégral et de pointer du doigt la bêtise du protectionnisme :
« Supposons un moment que chacune des communes, petites et grandes, qui composent la France, loin de chercher à multiplier leurs communications, et à étendre leurs relations entre elles, entourât son territoire d’une clôture, et, dans la vue de favoriser le débit de ses propres denrées, empêchât l’introduction des denrées des communes voisines, ou du moins y mît de grandes entraves ; ces communes en seraient-elles plus heureuses, plus riches et mieux pourvues ? Loin de là, dira-t-on. Eh bien ! ces lignes de places fortes, ces douanes, ces commis qui garnissent les frontières des États, ont le même inconvénient pour tous et pour chacun. Sous prétexte d’enfermer en dedans l’argent, on ferme en dehors l’abondance. Le jour où l’on fera tomber les barrières qui séparent les nations, détruira la cause la plus féconde des guerres, et précédera de peu de temps une époque de prospérité générale. » [20]
C’est sur ce libéralisme économique, défendu d’une manière scientifique, que reposeront l’ensemble des discussions du Traité d’économie politique qui paraîtra trois ans plus tard. Son Traité, plus qu’Olbie, vite oubliée, lui assurera une gloire considérable. Jean-Baptiste Say deviendra le maître de toute la pensée économique française pendant au moins un siècle.
À la fin de son ouvrage, anticipant presque cette gloire qui l’attendait, Say disait anticiper que dans l’avenir « les noms de pacificateur, de créateur de la prospérité publique, ne seront pas entourés de moins d’éclat que celui de conquérant. » [21] Aujourd’hui que sa grande célébrité d’autrefois nous apparaît entièrement consommée, il semble que cette prophétie ne se soit pas vraiment réalisée. À moins qu’un jour, demain peut-être, la France s’attache à lire et à faire lire ses grands économistes, et le premier d’entre eux : Jean-Baptiste Say.
Benoît Malbranque
Institut Coppet
AVERTISSEMENT
L’Institut national, en l’an V [22], proposa pour sujet de prix cette question : Quels sont les moyens de fonder la morale chez un peuple ? C’est l’une des plus belles que jamais aucune société savante ait proposée. Elle avait un degré d’utilité tout particulier pour la France, qui ne possédait, pour faire marcher la République, que des hommes formés aux habitudes de la monarchie. Malheureusement cette question ne produisit aucun discours que l’Institut jugeât digne de la couronne.
Alors l’Institut la reproduisit avec une restriction qui devait la rendre encore plus difficile à traiter. Il demanda, non pas quels sont les moyens, mais quelles sont les institutions, etc. Si l’on n’avait pas réussi à fonder la morale lorsqu’on en avait tous les moyens à sa disposition, on devait y réussir moins encore, lorsque la faculté de s’occuper de plusieurs moyens, qui ne sont pas des institutions, était ôtée.
Enfin un nouveau programme restreignit encore les ressources laissées aux concurrents, et alla jusqu’à leur tracer un plan dont il ne leur fut pas permis de s’écarter. Aussi l’Institut, sur le rapport d’une commission, a-t-il jugé qu’aucun des ouvrages envoyés au concours n’avait rempli les conditions du programme, et il a retiré cette question.
Quoique l’Essai qu’on va lire ait été envoyé à ce dernier concours, je suis un des premiers à applaudir au parti qu’a pris l’Institut ; sa détermination est conforme au système qu’il avait adopté relativement à cette question ; mais je prendrai la liberté d’exposer par quel motif je n’ai pas cru devoir entrer dans ses vues : ce sera répondre à la seule critique que la commission chargée de l’examen des ouvrages, a faite du mien, qu’elle a d’ailleurs, dans son rapport, traité beaucoup trop favorablement sans doute.
Suivant elle, ma méthode « présente, au lieu de raisonnements, des tableaux, et met en action ce que d’autres ont mis en théorie et en système : mais c’est précisément une théorie et un système qu’on demandait. »
En premier lieu, je crois avoir accompagné mes tableaux d’assez de raisonnements pour qu’on se rendît compte de leurs motifs ; le lecteur en jugera. En second lieu, j’ai cru qu’un ouvrage envoyé au concours ouvert par un corps savant, n’était pas destiné uniquement pour ce corps savant ; que ses membres ne demandaient point aux concurrents de les éclairer, mais de travailler à des écrits qui pussent influer sur l’opinion générale, répandre des vérités utiles, détruire des erreurs dangereuses. Or ce n’est point avec des abstractions qu’on parvient à ce but, c’est, si je ne me trompe, en revêtant les préceptes de la raison des grâces de l’élocution et des charmes du sentiment. Sans doute je suis loin de l’avoir atteint ; mais la commission de l’Institut devait-elle me blâmer d’y prétendre ?
Mon principal désir, en composant cet ouvrage, ayant été de me rendre utile, j’ai dû l’imprimer. Et quel temps fut plus favorable à la publication d’un écrit sur les mœurs de la nation, que celui où nous sommes, que celui où deux hommes dont les talents éminents et la moralité ne sont pas contestés, même de leurs plus grands ennemis, ont conçu le projet de fonder la stabilité de la République sur l’observation des règles de la morale, et ont été placés par leurs concitoyens dans les premières magistratures ? Certes, c’est à une telle époque qu’il est permis de se livrer aux rêves d’une imagination philanthropique. Je regrette seulement d’avoir réduit à la mesure ordinaire d’un discours académique, un ouvrage qui, par l’importance de son objet, par les nombreux développements dont il était susceptible, offrait la matière d’un livre.
Les notes trop étendues pour être placées au bas des pages, ont été renvoyées à la fin. Les endroits auxquels elles ont rapport dans le courant de l’ouvrage, sont marqués d’une lettre majuscule. La plupart renferment des digressions et des citations qui, sans être étrangères au sujet, auraient interrompu le fil des idées.
SOMMAIRE
Définition des mots mœurs, morale, moralité. — But de la morale. — Deux sortes d’institutions sont nécessaires pour réformer les mœurs : celles qui agissent sur les hommes neufs, ou enfants, et celles qui agissent sur les hommes faits. — De quelle nature doivent être les premières, les secondes. — Le peuple d’Olbie, peuple imaginaire, fournit des exemples de l’application de ces principes. — Chaque principe de détail est développé en même temps que l’exemple. — Un bon traité d’économie politique doit être le premier livre de morale, et pourquoi. — Du pouvoir de l’argent. — De l’autorité de l’exemple. — Des effets de l’instruction. — De l’influence des femmes. — Des fêtes, des monuments. — Gardiens des mœurs. — Le bonheur considéré comme moyen. — Résultats.
OLBIE, ou Essai sur les moyens de réformer les mœurs d’une nation
Par le mot de Mœurs, appliqué aux hommes, il ne faut point entendre seulement les relations honnêtes et régulières des deux sexes entre eux, mais les habitudes constantes d’une personne, ou d’une nation, dans ce qui regarde la conduite de la vie.
La Morale est la science des mœurs. Je dis science ; car, dans l’état de société, les règles de conduite ne sont pas toutes d’institution naturelle ; elles s’apprennent. Il est vrai qu’elles s’apprennent dès l’enfance et par routine ; mais le langage, qui est une science aussi, ne s’apprend-il pas de même ?
La Moralité est l’habitude de consulter les règles de la Morale dans toutes ses actions. Entre tous les êtres, l’homme seul paraît être susceptible de posséder cette belle faculté.
Le but de la Morale est de procurer aux hommes tout le bonheur compatible avec leur nature. En effet, les devoirs qu’elle nous prescrit ne peuvent être que de deux espèces : A- ceux dont l’accomplissement a pour objet notre propre conservation et notre plus grand bien ; l’avantage en est immédiat et direct ; et B- ceux dont l’accomplissement fait le bonheur des autres hommes. Or ces derniers sont réciproques. Qu’on les suppose fidèlement remplis : chaque personne jouira des vertus de toutes les autres. C’est le cas d’un contrat mutuellement avantageux. Ainsi une nation qui connaîtrait et suivrait généralement les règles de la morale, ferait, dans toute la rigueur du terme, ce qu’on appelle un bon marché. Elle serait la plus heureuse des nations.
Le soin de fixer et de disposer ces règles, regarde le Moraliste. Ici, je suis forcé de supposer qu’elles sont connues, que l’on sait positivement quels sont les devoirs d’hommes, de fils, de frères, de citoyens, de magistrats, d’époux et de pères. Ma tâche est de rechercher par quels moyens on peut engager un peuple vieilli dans des habitudes vicieuses et dans de funestes préjugés, à suivre ces règles, de l’observation desquelles sa félicité serait l’infaillible récompense.
***
Lorsque cette bonne idée tombe dans la tête des chefs d’une nation de vouloir réformer ses mœurs, il est deux sortes d’institutions dont il est nécessaire qu’ils s’occupent : celles qui doivent donner de bonnes mœurs aux hommes à venir, c’est-à-dire celles qui ont rapport à l’éducation[23], et celles qui peuvent reformer les hommes faits.
L’éducation se propose deux objets : la direction des facultés physiques et morales de l’enfance, et en second lieu son instruction.
Rousseau regarde le premier de ces deux objets comme le plus important. En effet, de bonnes mœurs ne sont que de bonnes habitudes, et cette première direction a pour but de former ces bonnes habitudes, soit au physique, soit au moral. « La plupart des républiques, dit Bacon, n’auraient pas eu besoin de faire tant de lois pour diriger les hommes, si elles avaient pris la précaution de bien élever les enfants ».
Cependant, quelque importante que soit cette partie de l’éducation, on aurait très grand tort de regarder celle qui a rapport à l’instruction comme indifférente pour la morale. L’instruction a, relativement aux mœurs, ces deux grands avantages : c’est d’abord qu’elle les adoucit, et, en second lieu, qu’elle nous éclaire sur nos vrais intérêts.
Elle adoucit les mœurs en tournant nos idées vers des objets innocents ou utiles. Les hommes instruits, en général, y font moins de mal, commettent moins de dégâts que ceux qui ne le sont pas. L’homme qui a étudié l’agriculture, et qui sait ce qu’il faut de soins pour faire pousser une plante, pour élever un arbre, celui qui connaît leurs usages économiques, sont moins près de les détruire, que l’ignorant chez qui ces précieuses productions ne réveillent aucune idée. De même, l’homme qui a étudié les bases sur lesquelles se fondent l’ordre social et le bonheur des nations, ne les sape jamais sans répugnance.
Mais c’est principalement en nous éclairant sur nos propres intérêts, que l’instruction est favorable à la morale. Le manouvrier qui boit en quelques heures ses profits de la semaine, qui rentre chez lui pris de vin, bat sa femme, corrompt par son exemple des enfants qui pourraient devenir l’appui de sa vieillesse, et qui enfin ruine sa santé et meurt à l’hôpital, calcule moins bien que cet ouvrier diligent qui, loin de dissiper ses petites épargnes, les accumule, ainsi que leurs intérêts, se fait un sort sur ses vieux jours, et passe l’âge du retour au sein d’une famille active qu’il a rendue heureuse, et dont il est adoré.
C’est surtout dans un état libre qu’il importe que le peuple soit éclairé. C’est de lui que s’élèvent les pouvoirs, et c’est du sommet du pouvoir que découle ensuite la vertu ou la corruption ; c’est entre les mains des gens en place que sont toutes les nominations, toutes les institutions et l’ascendant de l’exemple. S’ils sont ineptes, méchants et corrompus, l’ineptie, la perversité et la corruption inondent toute la pyramide sociale.
Telle est, selon moi, l’influence qu’exercent sur les mœurs les deux parties qui constituent l’éducation.
N’ayant pas la prétention de donner dans cet écrit un traité d’éducation plus qu’un traité de morale, je suis forcé de supposer que les principes d’une bonne éducation sont connus. Ils ont été discutés et établis par de grands maîtres, à la tête desquels on peut compter, parmi les modernes, Montaigne, Locke et Rousseau. Montaigne, esprit juste, philosophe érudit, mais écrivain peu méthodique, a laissé échapper dans ses admirables causeries, le germe des idées recueillies par les deux autres. Locke a lié, complété cette doctrine, l’a étendue à tous les cas : mais son livre est sec et minutieux ; il n’attaque pas les préjugés de toutes les sortes, et l’on y chercherait vainement le charme de style qui fait lire l’Émile de Rousseau, non plus que cette éloquence du sentiment, qui est la raison pour les esprits faibles, et qui, jointe à la raison, fait les délices des esprits éclairés. Aussi le livre de Jean-Jacques, malgré un petit nombre de paradoxes, qu’il y soutient peut-être avec trop de prédilection, malgré l’impossibilité de faire l’application de quelques-uns de ses préceptes, même des principaux, a produit une révolution dans la manière d’élever les enfants ; et si jamais la moitié des habitants de la France parvient à savoir lire, et à comprendre seulement la moitié de ce livre important, l’influence en sera prodigieuse. Alors un discours comme celui-ci deviendra la chose du monde la plus inutile.
S’il n’est pas de mon sujet de poser les principes d’une bonne éducation, je dois au moins chercher par quels moyens la généralité d’une nation encore très retardée, peut être amenée à les adopter ; car une partie de la morale à fonder actuellement, est celle qui portera les hommes à répandre de bonnes semences pour l’avenir.
Et d’abord, comment une nation qui n’aurait que de mauvaises habitudes, pourrait-elle en donner de bonnes à ses jeunes citoyens ? Elle ne doit pas en abandonner l’espoir. Les pères peuvent se croire intéressés à faire le mal ; jamais à l’enseigner. Ils peuvent vouloir communiquer leurs préjugés ; mais si les institutions qui les ont nourris n’existent plus, ces préjugés ne germeront pas au sein de leurs enfants. Les pères sont ignorants… : on peut compter sur l’orgueil paternel qui les fait jouir du mérite et des succès de leurs fils. Enfin, si d’excellents instituteurs existent, si l’avenir respire dans les écrits de quelques grands hommes, cette nation ne doit désespérer de rien. J’appelle grands hommes ceux qui, dans le mouvement général vers un perfectionnement, ont devancé leur siècle.
Une nation qui a de mauvaises mœurs et de bons livres, doit de tout son pouvoir favoriser l’enseignement de la lecture.
L’indigent, assailli par tous les besoins, regarde des signes noirs empreints sur des feuilles blanches, comme une savante futilité. Il ignore que les plus sublimes connaissances, que les utiles notions de l’économie politique, par exemple, sources fécondes de la prospérité et du bonheur des nations, sont cachées sous les caractères qu’il méprise, et que si ses aïeux avaient su en soulever le voile, il ne serait pas, lui, réduit à partager avec sa grossière famille un morceau de pain noir sous une hutte de sauvage.
Veut-on qu’il donne de l’instruction à ses enfants ? qu’on commence par lui procurer assez de tranquillité et une portion, suffisante de bien-être, pour qu’il puisse songer à ce qui ne sera jamais à ses yeux qu’un objet d’utilité secondaire.
Or, cette portion suffisante de bien-être ne saurait résulter que d’une sage répartition des richesses générales, qui elle-même ne peut être le fruit que d’un bon système d’économie politique ; science importante, la plus importante de toutes, si la moralité et le bonheur des hommes méritent d’être regardés comme le plus digne objet de leurs recherches. [24]
Ce serait en vain qu’on voudrait accélérer d’une manière forcée cette marche naturelle des choses. La bonne éducation, l’instruction, dont l’aisance sera la source, dont les bonnes mœurs seront la conséquence, ne germeront jamais qu’avec l’aisance du peuple. C’est ce dont il faut d’abord s’occuper. Si l’on refuse de commencer par le commencement, on ne créera que des institutions nominales, qui pourront bien avoir dans l’origine l’apparence et l’éclat d’institutions solides, mais qui ressembleront bientôt à ces festons de feuillage, à ces arbres factices, sciés dans les forêts pour embellir les fêtes ; superbes végétaux sans racines, qui jouent un moment la nature champêtre, mais qui, incapables de produire ou des fleurs ou des fruits, n’offrent bientôt aux regards qu’un pompeux arrangement de fagots desséchés.
De bonnes institutions d’éducation une fois établies, ne sont que des semences pour l’avenir. Les hommes qu’elles produiront auront pris la bonne habitude d’être vertueux ; leur morale peut se passer de tout autre fondement. Mais la portion déjà formée d’une nation doit-elle renoncer entièrement à l’espérance de se donner de bonnes mœurs ? Il serait trop affligeant de le penser. On a comparé l’homme à un arbrisseau qui, jeune et souple encore, peut se ployer à toutes les directions, et qui, devenu grand, se roidit contre tous les efforts. Heureusement que la ressemblance n’est pas entière : l’arbre végète ; l’homme a une volonté, des besoins, des passions, et il reste contre ses mauvais penchants plusieurs leviers puissants ; mais il faut qu’on veuille s’en servir, et qu’on trouve des hommes capables de les manier.
Nous voulons que les hommes se conduisent bien. Suffit-il de le leur commander ? Le premier de nos maîtres, l’expérience, nous dit que non. Si les meilleurs préceptes, appuyés de l’autorité des lois, de l’ascendant de la force, de la sanction divine, suffisaient pour rendre les hommes vertueux, il n’est pas de nation qui ne fût un modèle de toutes les vertus ; car il n’en est pas une dont les lois ne commandent de bien vivre ; il n’est pas de religion qui ne menace le pécheur de punitions effrayantes, et qui ne promette des récompenses magnifiques à l’homme de bien. Que sont cependant ces nations si bien endoctrinées ? En est-il une seule où l’homme ambitieux n’ait pas écrasé ses rivaux ; où la vengeance n’ait pas exercé ses fureurs ; où l’amour du lucre n’ait pas inspiré les tromperies les plus honteuses et les plus viles prostitutions (C) ?
Qu’on ne s’imagine pas que plusieurs d’entre elles n’offrent qu’un petit nombre d’exemples de ces crimes. Ils sont rares, exercés en grand, parce que les grandes occasions sont toujours rares ; mais les causes qui les produisent dans les circonstances importantes, existent et agissent perpétuellement dans les circonstances de la vie commune. Si l’on ne voit pas tous les jours un frère détrôner son frère, tous les jours on voit un aîné de famille disputer à son cadet, à un bâtard innocent de l’erreur de sa naissance, les moindres parcelles d’un immense héritage.
La justice humaine, pauvre et inégale justice, atteint bien quelques-uns des crimes qui troublent le repos de la société, mais jamais elle n’atteint et ne détruit la cause qui les fait commettre ; d’où il résulte qu’elle punit en effet, non le crime, mais la maladresse du criminel qui n’a pas su se mettre à couvert de son glaive. La justice n’enseigne pas la morale : elle enseigne la prudence et l’astuce.
Si les lois divines et humaines ont si peu de pouvoir pour fonder de bonnes mœurs, où faut-il en chercher les moyens ? Dans le cœur de l’homme. « Quiconque se mêle d’instituer un peuple, dit Rousseau, doit savoir dominer les opinions, et par elles gouverner les hommes ». Si l’on veut que telle manière d’être, telle habitude de vie s’établisse, la dernière chose à faire est donc d’ordonner que l’on s’y conforme. Voulez-vous être obéi ? Il ne faut pas vouloir qu’on fasse : il faut faire qu’on veuille. [25]
Je ne prétends point que, pour faire adopter une institution, on doive la calquer sur les préjugés de ceux pour qui elle est faite. Il faut bien que Lycurgue ait choqué en quelque chose les opinions de son siècle, puisqu’en voulant faire adopter ses lois, il excita une émeute et qu’il fut assailli à coups de pierres ; mais ses lois subsistèrent. Qu’on se fiche contre une institution nouvelle, j’y consens ; mais qu’on soit amené, par son propre intérêt, à la conserver ; qu’elle soit telle que non les ordres du législateur, mais la nature des choses, l’attire plus fortement que le goût général ne la repousse. Pourquoi cette considération, la première dont on doive s’occuper en portant une loi, en fondant une institution, est-elle ordinairement la dernière dont on s’avise ?
Il s’agit donc, je le répète, de chercher dans le cœur de l’homme, et là seulement, la garantie de sa conduite.
L’homme soupire sans cesse après le bonheur, et principalement après le bonheur prochain et sensible (D) : s’il ne s’ouvre devant lui pour l’atteindre que la voie du crime, il s’y précipite. Si le chemin de la vertu peut y conduire, il le préfère. Cette disposition mise en nos âmes par la nature, et que tous les rhéteurs du monde essayeraient en vain de changer, doit diriger sans cesse le moraliste. Au lieu de s’attacher à vaincre les désirs de l’homme, il doit s’en servir.
On a dit qu’il fallait rendre la vertu aimable : j’ose ajouter qu’il faut la rendre profitable. Le vice est hideux : rendons-le funeste.
Si l’on a vu des institutions opérer sur les mœurs des prodiges, ne nous y trompons point, c’est que les législateurs qui les ont établies, ont connu ce mobile, et en ont tiré parti. Trois cents Spartiates meurent aux Thermopyles pour leur patrie ; c’est un des plus grands exemples de dévouement dont l’histoire ait conservé le souvenir. Comment Lycurgue parvint-il à leur inspirer cet héroïque courage ? Nous aurions pu le deviner ; mais Xénophon nous l’apprend positivement : « Ce grand législateur, dit-il, a pourvu au bonheur de l’homme brave, et a dévoué le lâche au malheur et à l’opprobre ». [26] Fuir et être perpétuellement misérables étaient pour les compagnons de Léonidas une même chose. Le moyen, après cela, d’abandonner son poste, et de reparaître aux bords de l’Eurotas ! Ces braves gens n’avaient pas deux partis à prendre : ils n’avaient plus qu’à mourir ; c’est ce qu’ils firent. [27]
Faisons pour la vertu ce que Lycurgue fit pour le courage, et que, suivant l’expression de Rousseau, elle puisse ouvrir toutes les portes que la fortune se plaît à fermer. [28] Plusieurs colonies modernes qui ont établi leurs institutions suivant ces principes, les ont vues couronnées du succès. La plupart des Européens qui formèrent des établissements sur les côtes de l’Amérique septentrionale, n’emportèrent ni les regrets, ni même l’estime de leurs anciens compatriotes. Plusieurs étaient des débiteurs insolvables ou même frauduleux, et quelques-uns avaient plus que des fautes à se reprocher. Arrivés sur le continent américain, il fallut bien qu’entre eux, ils honorassent les qualités qui seules pouvaient conserver la société naissante. Les emplois, le pouvoir, le crédit, la fortune, allèrent chercher ceux qui se rendaient recommandables par leur bonne foi, leur esprit de conduite, leur amour du travail. Les hommes sans probité dans les affaires, sans délicatesse envers les femmes, sans bienveillance pour leurs frères, n’y pouvaient subsister. Il fallait qu’ils changeassent de caractère ou qu’ils partissent. Aussi les mœurs de ce peuple ont-elles, en général, offert aux nations d’Europe, même pendant les orages d’une révolution, des exemples de vertus inconnus parmi elles ; et le rebut de ces nations a mérité d’en devenir le modèle. [29]
Tels sont, je crois, les principes qui doivent guider dans la recherche et l’adoption des institutions propres à fonder la morale chez un peuple. Je vais maintenant montrer ces mêmes principes mis en pratique au sein d’une société qui a établi sa liberté politique sur les ruines d’une monarchie absolue, et qui n’est parvenue à consolider l’édifice de cette liberté, qu’en changeant totalement ses mœurs, ou, si l’on veut, ses habitudes (E). Ce peuple, qui habite un pays nommé Olbios, en français Olbie, jouissant, depuis un demi-siècle environ, d’une liberté fondée sur de bonnes lois, est trop avancé dans la route de la sagesse, pour que les reproches que pourra exciter le souvenir de son ancienne dépravation aient de quoi l’offenser. On ne rougit que des fautes qu’on est encore capable de commettre.
Je ne puiserai chez les Olbiens qu’un petit nombre d’exemples. C’est tout ce que me permettent les bornes que je me suis prescrites. Mais ces exemples suffiront, j’espère, pour faire naître des idées plus étendues, plus liées, plus justes peut-être ; et mon travail, quoique imparfait, n’aura pas été inutile.
J’ai cru devoir établir des principes avant de proposer des exemples, parce que les uns peuvent être bons, et les autres mal choisis. C’est aux hommes qui sont plus éclairés et plus puissants que moi, à tirer des premiers toutes les conséquences qui peuvent en sortir, à déployer leur génie, la fermeté de leur caractère, dans l’application de ces principes ; ce qui est sans doute la tâche la plus difficile, lorsqu’il s’agit de créer des institutions sociales.
On verra que je suppose toujours que les chefs de la nation, ceux de qui les institutions dépendent, ont la ferme volonté de régénérer les mœurs de leurs concitoyens ; autrement, il serait bien superflu de s’en occuper. [30] Lycurgue changea les mœurs de Sparte ; mais il le voulut fortement. [31] Si les Spartiates eussent préféré de rester corrompus, et que Lycurgue eût été de leur avis, je ne sais pas trop par quel moyen la réforme eût pu s’opérer.
C’est donc aux législateurs des nations, aux plus influents de leurs magistrats, de leurs orateurs, de leurs écrivains, à concourir avec moi dans cette entreprise. Que ceux de mes concitoyens qui sont faits pour influer sur les mœurs nationales, par leurs places ou par leurs talents, se livrent enfin à l’accomplissement de cette œuvre louable et grande. Puissent-ils concevoir combien il doit en résulter de solide gloire pour eux-mêmes, et de bonheur véritable pour tous !
Après la révolution qui permit aux Olbiens de se conduire, non plus d’après d’anciens usages, mais suivant les conseils de la raison, les chefs de la nation s’attachèrent à diminuer la trop grande inégalité des fortunes ; ils sentirent que, pour se former de bonnes mœurs, la situation la plus favorable dans laquelle une nation puisse se trouver, est celle où la majeure partie des familles dont elle se compose, vit dans une honnête aisance, et où l’opulence excessive est aussi rare que l’extrême indigence.
La misère expose à des tentations continuelles ; que dis-je ? à des besoins impérieux. Non seulement les actes de violence coupables, mais encore la dissimulation, les friponneries, les prostitutions[32], les émeutes, sont presque toujours le fruit de l’indigence. Que de gens ont embrassé un parti politique abhorré, ou des opinions hasardées, uniquement pour subsister ! Tel homme n’aurait pas bouleversé son pays, s’il eût eu de quoi vivre. Ah ! si les riches, chez certains peuples, entendaient bien leur intérêt, loin de pomper la substance du pauvre, pour grossir sans mesure leur fortune, ils y mettraient volontairement des bornes, et sacrifieraient une partie de leur avoir, afin de jouir en paix du reste.
Les grandes richesses ne sont pas moins funestes aux bonnes mœurs (G). La facilité d’acheter, chez les hommes, produit autant de maux que la tentation de se vendre. L’opulence endurcit l’âme : on apprécie mal des besoins qu’on ne ressent jamais et à l’abri desquels on se croit pour toujours. Les riches sont entourés d’une foule de complaisants qui, pour se rendre agréables, éloignent de leur vue les objets hideux, et proposent un plaisir qu’ils partagent, plutôt qu’un bienfait dont ils sont jaloux.
Mais ce ne sont point des règlements et des lois somptuaires qui préservent une nation des excès de l’opulence et de la misère ; c’est le système complet de sa législation et de son administration. Aussi le premier livre de morale fut-il, pour les Olbiens, un bon traité d’économie politique. Ils instituèrent une espèce d’académie, qu’ils chargèrent du dépôt de ce livre. Tout citoyen qui prétendait à remplir des fonctions à la nomination des premiers magistrats, fut obligé de se faire publiquement interroger sur les principes de cette science ; principes qu’il pouvait à son choix défendre ou attaquer. Il suffisait qu’il les connût pour que l’académie lui accordât un brevet d’instruction, sans lequel la route des grandes places lui était fermée (H).
Bientôt ces places furent toutes occupées, sinon par des esprits supérieurs, au moins par des hommes assez éclairés pour être en état de prendre un bon parti dans les questions principales. La plupart des opinions se rallièrent autour des meilleurs principes, et il en résulta un système suivi d’économie politique, d’après lequel toutes les autorités de l’État réglèrent leur conduite ; tellement que les hommes avaient beau changer, les maximes, dans les points importants, restèrent les mêmes : et comme une cause sans cesse agissante, ne manque jamais de produire son effet, il arriva que sans injustices, sans déchirements, sans secousses, l’honnête aisance devint très commune, et l’excès des richesses et de l’indigence fort rare.
Alors la plupart des citoyens, trop peu opulents pour user leur vie dans des plaisirs continuels, mais assez à l’aise pour ne point éprouver les atteintes du découragement ou les angoisses du besoin, se livrèrent à ce travail modéré qui laisse à l’âme tout son ressort : peu à peu ils s’accoutumèrent à chercher leurs plaisirs les plus chers dans la société de leur famille et d’un petit nombre d’amis ; ils cessèrent de connaître le désœuvrement, l’ennui, et le cortège de vices qui les accompagnent : vivant plus sobrement, leur humeur fut plus égale, leur âme plus disposée à la justice et à la bienveillance qui sont mères de toutes les autres vertus.
Afin d’éloigner encore davantage les maux qui suivent l’oisiveté (I), on fit revivre cette loi d’Athènes qui obligeait chaque citoyen à déclarer quels étaient ses moyens de subsister ; et comme quelques-uns avaient des moyens de subsister légitimement sans travail, on y lit un léger changement, en obligeant chaque citoyen à faire connaître ses occupations habituelles. Cette désignation devait nécessairement accompagner son nom et sa signature dans tous les actes publics ; on ne pouvait les produire dépourvus de cette formalité. Ainsi, au défaut d’une profession lucrative, on y voyait souvent le nom d’un homme qui s’occupait à des recherches de physique, ou bien à des expériences pour le perfectionnement de l’agriculture, ou bien à donner une éducation libérale aux enfants orphelins de son frère. Lorsqu’il y avait une disparate choquante entre la conduite tenue et l’occupation professée, c’était, pour le faux déclarateur une source de ridicules ou même de reproches plus graves, auxquels on avait grand soin de se soustraire. Si une affaire, une circonstance imprévue, mettait en évidence un citoyen, et qu’il eût négligé de remplir cette formalité, son nom n’était jamais rappelé, sans être suivi de la qualification d’homme inutile.
Par ce moyen on évita que l’amour du gain ne devînt à Olbie le seul stimulant qui engageât les hommes à se livrer au travail. Les Olbiens savaient que l’amour du gain est un écueil presque aussi dangereux que l’oisiveté. Lorsque cet amour est très vif, il devient exclusif comme tous les autres ; il étouffe une foule de sentiments nobles et désintéressés qui doivent entrer dans l’âme humaine perfectionnée. C’est ainsi que chez certains peuples, ou même chez les habitants de certaines villes, trop adonnés au commerce, toute idée, autre que celle de s’enrichir, est regardée comme une folie ; tout sacrifice d’argent, de temps, ou de facultés, comme une duperie. Un tel peuple paye quelquefois des gens à talents, parce qu’il en a besoin, mais les gens à talents ne naissent point dans son sein. Or comme l’argent donne des serviteurs peu attachés et non des amis fidèles et des citoyens capables, il arrive que les nations de ce genre finissent, et même assez promptement, par être mises à contribution, dominées, et enfin renversées par celles qui ont suivi d’autres principes. Que sont devenus les Phéniciens et leurs successeurs les Carthaginois ? À peine savons-nous de leurs affaires intérieures, autre chose, sinon qu’ils existèrent et qu’ils s’adonnèrent presque exclusivement au commerce.
Notre Europe nous offre plusieurs exemples pareils.
Venise, à qui un trafic immense donnait le moyen de salarier de nombreuses flottes et de grandes armées, commandées toujours par un général étranger qui n’était guère que le premier commis de ces marchands à Venise, soutint à la fois des guerres contre le Turc, l’Empire, le Pape et la France ; et en dernier lieu un bataillon a suffi pour la prendre.
La Hollande, le pays du monde le plus riche et le plus peuplé en proportion de son étendue, n’a-t-elle pas été constamment victime de toutes les puissances belligérantes de l’Europe qui l’ont mise à contribution tour à tour, et ont ensuite disposé à leur gré de son indépendance ? États-Unis de l’Amérique, prenez garde à la tendance générale des esprits dans votre belle république. Si ce qu’on dit de vous est vrai, vous deviendrez riches, mais vous ne resterez pas vertueux, mais vous ne serez pas longtemps indépendants et libres (K).
Il faut donc que l’amour du travail ne soit pas constamment excité par le désir du gain ; et le bonheur, la conservation même de la société exigent qu’un certain nombre de personnes dans chaque nation cultivent les sciences, les beaux-arts et les lettres[33] ; nobles connaissances qui font naître des sentiments élevés, des talents utiles à l’association. Tel écrivain, du fond de son modeste cabinet, travaille plus efficacement à établir la gloire, la puissance et le bonheur de son pays, que tel général qui lui gagne des batailles (L).
Si je n’étais point resserré dans les bornes d’un discours, c’est ici que je montrerais ce que les mœurs auraient à gagner au développement des plus nobles facultés de l’esprit et de l’âme ; je combattrais accidentellement l’éloquent paradoxe du philosophe de Genève (M) ; je prendrais la défense de la seule noblesse que puisse reconnaître l’égalité politique : celle des lumières, la seule qu’on ne doive point au hasard et qui ne soit jamais la compagne de la médiocrité ; je ferais remarquer ce bon sens chinois, qui fait de mandarin et de lettré deux mots synonymes, ne concevant pas que celui qui est placé plus haut par ses connaissances, puisse être mis plus bas par son rang, et que la sottise et l’immoralité doivent jamais commander au génie et à la vertu.
Les Olbiens encouragèrent par d’autres moyens, dans la classe ouvrière, cet amour du travail, plus utile pour elle que pour toutes les autres ; ils établirent des caisses de prévoyance (N). Tous ceux qui parvenaient à mettre de côté une petite somme, pouvaient, tous les dix jours, la mettre en réserve dans une de ces caisses ; et là, par l’effet ordinaire de l’accumulation des intérêts, ils la voyaient croître au point que, parvenus à l’âge du repos, ils se trouvaient maîtres d’un certain capital ou d’une rente viagère. Presque tous les artisans confiaient une plus ou moins grande partie de leurs salaires aux caisses de prévoyance ; et au lieu de donner à leurs plaisirs, à l’intempérance, trois ou quatre journées sur dix, ils n’en donnaient plus qu’une à leurs délassements. Les plaisirs qu’on goûte en famille sont les moins dispendieux ; aussi les préféraient-ils pour grossir leur épargne ; et lorsque le jour du repos venait, on ne voyait plus, comme auparavant, à Olbie, les cabarets pleins d’ivrognes abrutis, chantant et jurant tour à tour : mais on rencontrait fréquemment dans les campagnes qui entourent la ville, un père, une mère et leurs enfants, tous animés d’une gaîté tranquille, celle du bonheur, et qui marchaient vers quelque rendez-vous champêtre pour s’y réunir avec d’autres amis de même état qu’eux.
Les Olbiens ne s’étaient point contentés de se donner, relativement à l’économie politique, une législation favorable à la morale ; ils avaient graduellement retranché de la leur, tout ce qui pouvait lui être contraire. Ils avaient senti que ce serait en vain que le moraliste travaillerait à rendre les hommes bons, si on laissait subsister les lois qui tendent à les rendre pervers (O). C’est ainsi qu’ils supprimèrent les loteries (P), qui offrent un appât à la cupidité, à la paresse, au vol quelquefois, et entretiennent cette disposition, funeste à la prospérité des empires, et qui consiste à compter plutôt, pour sa fortune, sur le hasard que sur son industrie. [34] Ils étaient loin, par conséquent, d’autoriser, et encore plus d’encourager la publication de ces livres de magie, où l’on emploie des explications de rêves, des calculs de nécromance, pour induire le misérable à porter chez un receveur, le dernier écu qu’il possède, l’écu avec lequel il allait acquitter une dette ou bien acheter le diner de ses enfants. Impôt funeste ! supporté par le besoin qui désire d’acquérir, et non par l’opulence qui a mille moyens plus assurés de grossir son trésor.
De même que les loteries, les maisons de jeux disparurent ; et lorsqu’on traversait le quartier où jadis elles étaient accumulées, ou n’était plus exposé à rencontrer sur son chemin, un malheureux, l’œil hagard, cherchant, d’un pas incertain, un pont du haut duquel il put précipiter son infortune.
Après avoir détruit, autant que cela se pouvait, les causes de dépravation, les Olbiens s’occupèrent des encouragements à donner à la bonne conduite et aux belles actions. Ils prévinrent et surpassèrent le conseil du célèbre Beccaria, qui voulait qu’on instituât des prix pour les actions vertueuses, de même qu’on a attaché des peines aux délits. Tout chez eux devint un instrument de récompense (Q). Les fonctions auxquelles étaient attachés du pouvoir ou des émoluments, les exemptions permises, les missions honorables, devinrent le prix d’une action éclatante, de l’exercice sublime ou soutenu de vertus privées, d’une conduite sans reproche dans des circonstances délicates, du zèle qui avait porté à fonder ou à soutenir un établissement d’humanité, et même d’un bon livre, fruit pénible de longues études et d’utiles méditations. Le mot de faveur fut effacé des dictionnaires. Tout arrêté de nomination portait les titres que le candidat avait eus pour être préféré ; on y faisait mention de toutes les fonctions qu’il avait antérieurement exercées ; et afin que le public fut juge du mérite de ses titres, chaque arrêté était imprimé dans une feuille des nominations, publiée par le Gouvernement, et dont tous les articles pouvaient être réimprimés, débattus partout.
Mais dans une République, beaucoup de places sont données immédiatement par le peuple. Comment, demandera-t-on, celles-là, qui sont même la source de toutes les autres, purent-elles être un instrument de récompense pour les plus vertueux, si le peuple, dépourvu lui-même de connaissances et de moralité, les accordait aux plus hypocrites, aux plus impudents ? [35] Ce malheur, qui, à la vérité, se fit cruellement sentir dans l’enfance de la République olbienne, diminua, et finit par disparaître tout à fait à mesure que le peuple devint plus éclairé.
Quand les citoyens d’un même État peuvent se rapprocher, se voir et s’entendre à leur aise, ils découvrent bientôt parmi eux ceux qui méritent d’être estimés ; or, comme leur intérêt est d’élire des personnes incapables d’abuser de leurs emplois pour les tourmenter et les voler, ils laissent de côté l’intrigant, et choisissent l’homme de bien.
Afin que les citoyens d’un même canton apprissent à se connaître, les Olbiens instituèrent dans chaque arrondissement, non des sociétés politiques (R), mais des sociétés de délassement ; où tous les citoyens inscrits sur le registre civique se rendaient souvent le soir, principalement aux jours du repos. Ils pouvaient même y conduire leur famille. Dans ces réunions, qui le plus souvent joignaient au local qu’elles s’étaient choisi, l’agrément d’un jardin, envoyait s’établir, non des discussions générales, mais des conversations particulières. Ici l’on prenait des rafraîchissements, tandis qu’ailleurs on jouait à la boule, au billard, à différents jeux d’adresse ; plus loin, on lisait les nouvelles du jour. Bientôt les habitants d’un même quartier connurent le caractère, et jusqu’aux habitudes les uns des autres, et il en résulta des élections éclairées, favorables aux intérêts généraux, et qu’on put regarder comme de véritables récompenses des vertus privées.
Et d’ailleurs le peuple fit de bons choix, parce qu’on lui en donna l’exemple.
On n’avait point jusque-là connu le pouvoir de l’exemple, lorsqu’il est donné par des personnes éminentes en dignité ou en mérite, si ce n’est pourtant à la Chine, où l’empereur, à certain jour de l’année, met lui-même la main à la charrue. Ce pouvoir de l’exemple est tel entre les mains d’un gouvernement, que je ne crois pas qu’on puisse citer une seule nation qui ait eu de la moralité dans les temps où son gouvernement en a manqué, ni une seule qui en ait manqué lorsque son gouvernement lui en a fourni le modèle.
Dans l’Utopie de Thomas Morus, le gouvernement Utopien, du moment qu’il est en guerre avec une autre nation, met à prix la tête du prince ennemi, de ses ministres, de ses généraux ; il accueille, il donne de grandes terres et une existence honorable aux meurtriers ; il répand dans le pays ennemi des invitations à la trahison, le tout afin d’éviter les batailles et l’effusion du sang humain. Ce n’est pas ainsi que se conduisit Camille avec le maître d’école des Falisques. Si jamais l’Utopie a existé, le peuple doit avoir fait son profit de ce beau système ; et tout particulier en procès avec un autre, a dû chercher à gagner le cuisinier de sa partie adverse, afin d’éviter le scandale d’un procès. Hommes qui gouvernez, prenez-y garde ; vous parlez et agissez devant de grands enfants : pas un de vos gestes, pas une de vos paroles ne sont perdus (S).
Lorsque le peuple d’Olbie vit les places occupées par des hommes probes, instruits, dévoués à la chose publique sans l’être à aucun parti (T), il s’habitua à priser ces qualités, et il eut honte de faire de mauvais choix.
Les candidats, à leur tour, voyant que le mérite plutôt que l’or, était un moyen d’avancement, en vinrent peu à peu au point d’estimer l’or moins que le mérite. Ce fut un grand point de gagné ; car plus l’or est utile, plus on lui sacrifie de vertu. S’il garantissait de la mort, s’il procurait la force et la beauté, une santé inaltérable, des amis sincères, l’amour de nos épouses, le respect de nos enfants, indépendamment des autres jouissances qu’il achète, je ne pense pas que lorsqu’il s’agirait d’en gagner, le plus grand forfait arrêtât l’homme le plus vertueux.
Pour diminuer de plus en plus son pouvoir, les principaux parmi les Olbiens professèrent un assez grand mépris pour le faste. La simplicité des goûts et des manières fut à Olbie un motif de préférence et un objet de considération. Les chefs de l’État adoptèrent un système général de simplicité dans leurs vêtements, dans leurs plaisirs, dans leurs relations sociales. Jamais leurs domestiques, ni les soldats de leur garde ne témoignèrent une déférence stupide pour les livrées du luxe. [36] Le gros du peuple contracta par degrés la même habitude, et bientôt on ne vit plus un troupeau d’imbéciles ébahis à la vue d’une garniture de diamants ou de quelque autre colifichet de cette espèce (U). On n’estima plus les gens à proportion de la consommation qu’ils faisaient : qu’arriva-t-il ? Ils ne consommèrent rien au-delà de ce qui était vraiment nécessaire à leur utilité ou à leur agrément. Le luxe attaqué dans sa base qui est l’opinion, fit place à une aisance plus généralement répandue (V) ; et, ce qui arrive toujours, le bonheur augmenta en même temps que les mœurs se réformèrent.
À mesure que le goût du faste diminua, l’argent qui s’y consacrait prit une direction plus louable et plus productive. Il alla vivifier les manufactures, mettre en valeur l’industrie et le talent qui périssaient de misère, sans profit pour la société, sans gloire pour la nation. Dès lors, les riches qui se bornaient à une vaine ostentation de leurs grands biens, craignirent d’être mésestimés. On en vit qui voulurent attacher leur nom à un édifice public, ou bien faire couler l’abondance dans des canaux creusés à leurs frais ; les uns s’occupèrent à ouvrir une grande route, les autres à construire un port nouveau ; enfin ils ambitionnèrent la gloire d’être appelés les bienfaiteurs du pays, et on leur pardonna leurs richesses.
Les Olbiens n’auraient été que de faibles moralistes, s’ils n’avaient pas senti à quel point les femmes influent sur les mœurs. Nous devons aux femmes, nos premières connaissances et nos dernières consolations. Enfants, nous sommes l’ouvrage de leurs mains : nous le sommes encore quand nous parvenons à l’état d’hommes. Leur destinée est de nous dominer sans cesse, par l’empire des bienfaits, ou par celui des plaisirs ; et là où elles ne sont pas vertueuses, c’est en vain que nous voudrions le devenir. C’est par l’éducation des femmes qu’il faut commencer celle des hommes.
Heureusement que la nature qui a répandu sur cette moitié de notre espèce, les grâces et la beauté, a paru se complaire à la douer en même temps des plus aimables qualités du cœur ; et peut-être l’orgueil de l’homme sera-t-il forcé d’avouer que, si l’on en excepte cette vertu qui souvent nous ordonne de surmonter nos goûts et nos affections, la justice, compagne de la force, la nature a généralement donné aux femmes les qualités morales dans un plus haut degré qu’à nous. Elles sont plus accessibles à la pitié, plus disposées à la bienfaisance, plus fidèles dans leurs engagements, plus dévouées dans leurs affections, plus patientes dans l’infortune. Précieuses qualités ! Il n’est pas une de vous dont je n’aie éprouvé les doux effets. Si quelques femmes ne vous ont pas possédées toutes, il n’en est pas une seule du moins qui ne porte votre germe en son sein ; et, laissant de côté les exceptions, méprisant les sarcasmes de la frivolité, j’ose affirmer que le sexe qui a le plus de grâces, est encore celui qui a le plus de vertus.
Les Olbiens ne s’attachèrent donc pas, comme on l’a fait dans de certaines sectes à combattre le penchant qui entraîne l’homme vers la femme. C’est un instrument aussi puissant qu’il est doux : faut-il le briser au lieu de s’en servir utilement ? Ils ne suivirent pas non plus le conseil de Platon, qui, dans sa République vraiment imaginaire, veut que le sort décide et pour une seule fois, chez un ordre entier de citoyens, d’un commerce qui nous ravale au niveau des brutes, s’il n’est anobli par la constance et par les plus délicates préférences de l’âme. Les Olbiens mêlèrent au contraire l’amour honnête à toutes celles de leurs institutions qui purent l’admettre ; et, s’il faut l’avouer, ils prirent quelques conseils de nos siècles de chevalerie.
Alors ils sentirent la nécessité de donner aux femmes les deux vertus qui leur conviennent par-dessus toutes les autres, et sans lesquelles le charme et l’ascendant de leur sexe s’évanouissent tout à fait : je veux dire la douceur et la chasteté. Chez ce peuple la douceur des femmes naquit des mœurs générales qui elles-mêmes furent le fruit de l’ensemble des autres institutions. Les vertus domestiques et privées étant estimées et révérées parce qu’elles étaient utiles, et un mauvais ménage étant un obstacle qui repoussait également l’estime et la fortune, on donna beaucoup d’attention à ces égards habituels qui adoucissent les mœurs, et qui, s’il est permis de s’exprimer ainsi, veloutent le chemin de la vie.
Plusieurs professions dont l’effet est d’endurcir le cœur ou d’aigrir le caractère, furent interdites aux femmes, et elles jouirent de quelques privilèges analogues à leurs goûts et à leurs qualités. Ce fut à elles que le gouvernement confia l’exercice de la bienfaisance nationale ; il protégea les associations que plusieurs d’entre elles formèrent en faveur des filles à marier, des femmes en couches ; associations louables qui présentent le touchant tableau de la faiblesse généreuse, faisant cause commune avec la faiblesse infortunée.
Les sexes se mêlèrent moins dans la société, même parmi la classe ouvrière. De bons principes d’économie politique ayant répandu un peu d’aisance dans cette classe, les femmes ne furent plus forcées par l’indigence de partager avec les hommes ces travaux pénibles et grossiers qu’on ne peut leur voir exercer sans gémir. Elles purent donner leur temps et leurs peines au soin de leur ménage et de leur famille qui furent bien mieux tenus, et elles perdirent ces formes masculines qui dans leur sexe ont quelque chose de hideux : femme et douceur sont deux idées que je ne saurais séparer. L’empire de la femme est celui de la faiblesse sur la force : du moment qu’elle veut obtenir quelque chose par la violence, elle n’est plus qu’une monstruosité. [37]
La chasteté est peut-être encore, pour les femmes, d’une plus haute importance que la douceur. Celle qui cesse d’être pure, perd non seulement ses plus séduisants atouts, mais elle perd presque tous les moyens de conserver les autres qualités de son sexe, et d’exercer les douces fonctions que lui a départies la nature. Si elle n’est pas mariée, elle rebute tous ceux parmi lesquels elle pourrait trouver un époux ; si elle est épouse, elle jette le désordre dans son ménage. Qu’un homme fasse une infraction aux lois de la chasteté, il est coupable sans doute ; mais cependant il peut être négociant probe, ami solide, bon fils, bon frère, enfin citoyen utile et estimable ; mais une femme qui n’est point chaste n’est rien… que dis-je ! rien ? Elle est une cause vivante de désordres.
Le pouvoir des sens et l’indigence sont, pour les femmes, les deux principales causes du libertinage. Quant à la première, une bonne législation relative au mariage et au divorce, en diminua par degrés l’activité à Olbie. Les goûts furent consultés ; les différences de fortune opposèrent peu d’obstacles aux unions légitimes ; et celles-ci purent subir tous les changements compatibles avec le maintien de l’ordre social. Rendons facile le chemin de la vertu, et n’imitons pas ces moralistes-législateurs qui ont placé son temple au sommet d’un mont escarpé, où l’on n’arrive que par un étroit sentier. C’est faire du monde entier un abîme !
La seconde cause de dépravation chez les femmes, l’indigence, mérite toute l’attention de ceux qui veulent fonder les mœurs sur les institutions sociales. L’indigence, fléau cruel pour tous, est affreuse pour la plus intéressante moitié du genre humain. Elle ne prive pas seulement les femmes des communes douceurs de la vie ; elle les pousse dans la corruption la plus honteuse, la plus dépourvue de l’attrait qui déguise quelquefois la laideur du vice. Il faut avoir faim pour trafiquer de ses faveurs ! Quel autre motif que ce besoin impérieux pourrait faire surmonter à tant d’infortunées les dégoûts de la prostitution ? Les malheureuses ! sans choix, sans désirs, souvent attaquées de maux douloureux, presque toujours le chagrin dans l’âme, elles s’en vont provoquer d’un sourire gracieux des êtres rebutants ! Quel sort ne préféreraient-elles pas à celui-là ? Chez les Olbiens, on eut soin de leur en offrir un plus désirable : elles l’embrassèrent avec enthousiasme.
Un jour, me promenant dans les rues d’Olbie, je fus heurté et renversé par un fardeau que je n’apercevais pas. On s’empressa autour de moi ; et comme un peu de sang coulait sur ma figure, on me fit entrer dans la maison la plus proche. Je me trouvai bientôt seul avec trois femmes proprement vêtues, quoiqu’avec simplicité, et qui paraissaient être les maîtresses de la maison. Elles m’avaient donné les premiers secours ; elles voulurent que je m’arrêtasse un moment pour me laisser le temps de reprendre mes forces.
Leur habitation n’avait point l’air d’une maison particulière ; elle excita ma curiosité. On s’en aperçut, et voyant que j’étais étranger, on répondit âmes questions à peu près en ces termes :
« Nous sommes une nombreuse société de femmes. Cette maison nous a été donnée par l’État, et l’État continue à nous protéger de même que beaucoup de sociétés semblables ; mais nous ne lui sommes nullement à charge. Le travail qui se fait dans la maison suffit pour payer nos dépenses (qui sont réglées avec beaucoup d’économie), et pour accorder une légère rétribution à celles d’entre nous qui font plus d’ouvrage que n’en exigent nos règlements. Nous avons trois gouvernantes et trois économes, que nous renouvelons par tiers tous les mois. Il ne nous est permis de recevoir des étrangers que dans cette salle commune, et nous ne pouvons voir personne à moins d’être trois ensemble. Ce n’est qu’au même nombre et avec la permission de deux au moins des gouvernantes que nous pouvons sortir.
Notre nombre est fixé par l’étendue de la maison. Nous choisissons nos compagnes ; mais tant qu’il se présente des aspirantes, nous sommes obligées de tenir notre nombre complet. En entrant ici on ne prononce aucun vœu, et l’on ne contracte d’autre engagement que celui de se soumettre à la règle établie. Il y a parmi nous des personnes qui ont été mariées, et d’autres qui ne le sont pas encore. Toutes ont la faculté de quitter la maison et de s’établir si elles en trouvent l’occasion. Alors elles emportent leur épargne particulière, mais l’épargne de la communauté reste. La seule charge que nous impose l’État, est d’instruire un certain nombre d’élèves dans les ouvrages des femmes, et de soigner un certain nombre de vétérantes.
Lorsqu’une élève, une vétérante, ou même une sœur, mérite de graves reproches, nous avons recours à l’administration qui, ordinairement, prononce sa sortie : c’est presque le seul acte d’autorité directe que le gouvernement exerce sur nous.
Notre vie est fort douce : nous jouissons de la force morale attachée à toute espèce de corporation, et d’une liberté suffisante pour connaître les agréments de la société. On nous aime, on nous considère ; et la plupart d’entre nous quittent la maison plutôt pour passer dans les bras d’un époux que pour entrer dans le sein de l’Éternel ».
J’appris ensuite que pour mériter d’entrer dans une de ces communautés civiles, les filles et les femmes sans fortune tenaient une conduite extrêmement régulière. Il ne faut pas en être surpris : qu’étaient au prix du sort dont elles jouissaient dans la communauté, les plaisirs du libertinage, si tant est qu’il y en ait ?
Ceci me donna l’envie de connaître quelques autres points de la législation des Olbiens relativement aux femmes. On leur réserve toutes les occupations qui peuvent convenir exclusivement à leur sexe. Il n’est permis à aucun homme de s’occuper de tout ce qui tient à l’habillement des femmes ou bien à leur coiffure ; et parmi les arts et métiers, il en est qu’elles seules peuvent exercer, comme l’art du passementier, de la gravure en musique, de la cuisine, et beaucoup d’autres ; de façon que les plus pauvres trouvent des moyens de gagner honnêtement leur vie. Ne reste-t-il pas assez de professions à exercer par les hommes qui ont toute la terre pour théâtre de leur industrie, et qui, dans tous les cas, ont des moyens de subsister honorablement en servant l’État sur ses flottes ou dans ses armées ?
On a regardé avec raison comme une très grande difficulté de déterminer jusqu’à quel point l’autorité publique peut porter ses regards dans les détails de la vie privée sans violer la liberté naturelle, sans gêner le développement des facultés de l’esprit. Hors l’avilissant espionnage, il n’en existe peut-être qu’un seul moyen. L’autorité ne saurait, sans tyrannie, scruter les motifs : qu’elle s’empare des résultats. À Lacédémone, deux frères eurent un procès : les éphores condamnèrent le père à l’amende, et le punirent ainsi de n’avoir pas inspiré à ses fils plus de désintéressement, plus d’amour mutuel.
Mais pour exercer une telle juridiction, est-ce assez de nos tribunaux modernes, qui connaissent des délits que les lois défendent, et non des vertus que la morale prescrit, et qui ne prennent jamais aucune décision que sur des preuves juridiques ? Ne pourrait-on imiter, au moins dans quelques points, la censure des anciens ?
On est trop porté à croire que de certaines institutions, mises en pratique chez les peuples de l’antiquité, ne conviennent plus à nos mœurs. Il semble que les hommes de ces temps-là fussent autres que nos contemporains. Hélas ! il suffit de parcourir l’histoire pour s’apercevoir que nous ne faisons que recommencer les sottises et les crimes de nos devanciers. Si telle institution produisit quelque bien pendant un temps, pourquoi ne serait-elle pas capable de le produire encore ? Croit-on qu’elle fut dans ce temps-là sans inconvénients et sans antagonistes ? Aristote se plaint amèrement des éphores de Lacédémone ; il dit qu’on trouve parmi eux des gens peu éclairés, d’autant plus sévères pour les autres, qu’ils sont plus indulgents pour eux-mêmes. [38] À Rome, peu d’années après l’établissement des censeurs, c’est-à-dire, dans toute la ferveur de cette belle institution, ne vit-on pas ces magistrats qu’on se représente si intègres, se livrer à tout leur ressentiment contre le dictateur Mamercus Emilius, personnage illustre dans la paix et dans la guerre, parce qu’il avait fait réduire la durée de leurs fonctions de cinq ans à un an et demi ? Aussitôt que le temps de sa dictature fut passé, ils privèrent, en vertu du pouvoir de leur charge, ce respectable citoyen du droit de suffrage, et le chargèrent d’un tribut huit fois plus fort que celui qu’il avait coutume de payer.
Certes, si les frondeurs d’alors se fussent autorisés de ces abus, comme ils le firent indubitablement, pour décrier l’éphorat et la censure, et qu’ils eussent réussi, ils n’en auraient pas moins écarté des institutions qui maintinrent la pureté des mœurs à Sparte, et à qui l’on dut peut-être les trois cents années que la république romaine dura encore.
Qu’on se borne donc à corriger ce que l’expérience prouva que ces institutions avaient de vicieux ; qu’on ôte à l’une et à l’autre les prérogatives politiques qui les rendirent si redoutables[39] ; mais qu’on ne les proscrive pas, seulement parce qu’elles ont pris naissance à Rome et à Sparte.
C’est sous ce point de vue qu’elles furent considérées par les Olbiens. Les censeurs chez eux eurent l’inspection des mœurs et rien de plus ; et c’est pour cette raison qu’on se borna à les nommer Gardiens des mœurs. Leur tribunal fut composé de neuf vieillards, choisis parmi des citoyens qui avaient exercé toute leur vie avec honneur des fonctions soit publiques, soit privées, mais qui alors étaient totalement retirés des affaires, et par conséquent peu accessibles à l’espérance ou à la crainte. Ces vieillards ne pouvaient prononcer qu’une amende modique, égale, tout au plus, au montant des contributions du condamné ; et, dans les cas très graves, une censure publique.
Aucun emploi dans l’État, quelque éminent qu’il fût, n’était à l’abri des décrets de ce tribunal, et nul citoyen n’était assez obscur pour se soustraire à ses applaudissements, si des vertus rares les avaient mérités. Ses jugements, comme celui d’un jury, étaient le résultat de sa conviction intime, et cette conviction se formait par tous les moyens possibles : dépositions ouvertes, informations secrètes, cri public lorsqu’il acquérait une sorte d’intensité, interrogatoires volontaires, franches explications, tout servait à l’éclairer.
Ce tribunal n’énonçait jamais positivement le fait qu’il voulait reprendre ; car il aurait fallu l’établir sur des preuves juridiques, et il n’en avait souvent que de morales. Par la même raison il ne donnait jamais le motif de ses décisions, et n’était soumis à aucune responsabilité ; ses membres étaient inviolables. Voici le prononcé d’un jugement qu’il rendit une fois en public contre un juge prévaricateur :
« LE PEUPLE D’OLBIE
honore les vertus et déteste le vice. [40]
« N… les Gardiens des mœurs vous exhortent, sous les yeux de vos concitoyens, à ne point recevoir de présents de la part de vos clients, et à n’écouter dans vos jugements que la voix de l’équité. Remettez dans la caisse des pauvres une amende égale à vos contributions annuelles ».
Lorsqu’un fonctionnaire public avait été l’objet d’un pareil jugement, il était obligé, tout le temps que duraient les mêmes fonctions, d’ajouter dans tous les actes publics, à ses autres titres celui-ci : censuré par les gardiens des mœurs. Il en était peu qui ne préférassent de donner leur démission.
C’étaient les gardiens des mœurs qui décernaient dans les solennités publiques, les récompenses nationales. Une fois un homme alla leur recommander son bienfaiteur : ils couronnèrent à la fois le bienfaiteur et l’obligé (X).
On conçoit que des fonctions aussi délicates exigeaient que ceux qui devaient les exercer fussent choisis avec des précautions toutes particulières. Chacun de ces magistrats de morale était élu pour deux ans et pouvait être sans cesse réélu, mais il était impossible que ce fût par les mêmes électeurs ; car chaque province envoyant à son tour son gardien des mœurs, et le moment de le remplacer n’arrivant jamais lorsque cette même province avait une nouvelle élection à faire, s’il se trouvait remplacé ou réélu, c’était par une autre province.
Lorsqu’il s’agissait de les nommer, c’est ainsi qu’on posait la question : Quel est, parmi les gens retirés, le plus honnête homme de la province ? Les citoyens ayant voix délibérative, se partageaient en deux jurys. L’un des deux faisait l’élection, mais il fallait qu’elle fût sanctionnée par l’autre. Si celui-ci refusait de sanctionner le choix, il fallait qu’il en fît un autre lui-même, auquel le premier jury pouvait à son tour refuser son assentiment.
J’ai dit que les gardiens des mœurs étaient au nombre de neuf ; tous les neuf instruisaient une affaire ; au moment de prononcer, on tirait au sort trois d’entre eux, et ces trois étaient les seuls qui prononçassent, mais il fallait qu’ils fussent unanimes. La collection de leurs jugements formait deux séries, l’une appelée le livre du mérite, l’autre le livre du blâme. Ce n’étaient point les Olbiens, c’étaient les Chinois qui avaient deviné l’usage qu’on peut faire de tels livres (Y).
On a vu que les gardiens des mœurs étaient en même temps les dispensateurs des récompenses dans les solennités publiques ; cela me conduit à faire connaître de quelle nature étaient les fêtes nationales chez les Olbiens, et quel fut le parti qu’ils en tirèrent pour la morale.
Les facultés de l’homme lui pèsent tant qu’il ne les exerce pas. Les enfants ne s’amusent à détruire, que parce qu’ils ne savent pas encore employer leur activité à construire. [41] De même l’homme, s’il ne fait du bien, s’occupe à faire du mal. Il convient donc de l’occuper utilement ; mais on ne s’occupe jamais utilement, sans diriger vers un même but une certaine quantité des mêmes moyens moraux ou physiques : or, cette direction suivie fatigue, et les délassements (c’est-à-dire les occupations qui, par moments, n’exigent plus la direction des efforts vers le même but) deviennent nécessaires.
Ces délassements peuvent être favorables ou contraires à la morale. Ils lui sont contraires, lorsqu’ils deviennent nuisibles ; tels étaient les combats des gladiateurs chez les Romains ; tels sont les divertissements d’un peuple grossier qui ne sait se délasser du travail, qu’en se livrant aux excès de la débauche et à tous les genres de désordres, c’est à-dire en faisant son mal et celui des autres.
Pour que les délassements soient moraux, il suffit qu’ils n’aient point d’effets funestes ; car ils produisent un bien par cela seul qu’ils délassent, et redonnent à nos facultés le ressort nécessaire pour continuer les travaux utiles. Lorsqu’à cet avantage, ils joignent celui d’ajouter, soit au physique soit au moral, quelques perfections à nos facultés ou à nos goûts, ils sont encore préférables.
Cependant il faut prendre garde qu’à force de vouloir rendre les délassements utiles, on n’en fasse une fatigue. Ne perdons pas de vue qu’ici le délassement est l’essentiel, et que l’utilité n’est qu’un accessoire.
Tel est le point de vue sous lequel les Olbiens considérèrent les beaux-arts, les spectacles, les fêtes publiques ; et c’est en partant de ce principe qu’ils se préservèrent de l’austère morosité des Spartiates et des premiers chrétiens. Ils crurent qu’il fallait d’abord plaire, toucher, s’emparer de l’âme par des moyens honnêtes ; et ensuite (mais seulement lorsque la chose était possible sans détruire ces premières impressions) les diriger vers un but moral et utile.
Ils firent grand cas des jeux de la scène (Z). La représentation théâtrale donne en nous une plus grande vivacité à ce sentiment qui nous fait compatir aux affections des autres ; sentiment précieux, l’opposé de l’égoïsme, un des plus beaux attributs de l’homme, et qui a de quoi intéresser jusque dans ses faiblesses ! Ils eurent un théâtre comme les Français, où dans une suite d’actions intéressantes, développées avec art, il ne se rencontre pas un exemple coupable, pas une idée vicieuse, qui ne soient présentés avec la juste horreur qu’ils doivent inspirer ; et où des modèles d’humanité, de grandeur d’âme, s’offrent à chaque instant et avec tous les accessoires propres à leur donner du charme.
À l’égard des fêtes nationales, les Olbiens cherchèrent les moyens de leur imprimer un puissant attrait ; car on ne saurait diriger les cœurs quand on ne réussit pas à les captiver.
À moins qu’on n’assiste à un spectacle extrêmement curieux, on ne se plaît dans les réunions qu’autant qu’on y joue soi-même un rôle. On aime les jeux du théâtre, bien que les spectateurs y soient purement passifs ; mais il faut le prestige qui naît des efforts réunis du poète, de l’acteur et du décorateur, pour soutenir l’attention du public ; aussitôt que l’un de ces magiciens fait mal son métier, la pièce ennuie et tombe. Or il est difficile d’offrir à un peuple nombreux, rassemblé pour une cérémonie nationale, un amusement aussi vif que celui qui résulte de l’ensemble des talents de plusieurs artistes qui ont mis en jeu toutes les ressources de leur industrie et tous les genres de séduction. Il ne reste donc au magistrat qui ordonne les fêtes publiques, que la ressource de mettre en scène les spectateurs eux-mêmes, de faire en sorte que chacun d’eux se regarde comme personnellement intéressé à l’effet de la représentation ; autrement il ne donnera pas une fête, mais un spectacle plus ou moins ennuyeux.
Les Olbiens présumant donc que si l’on faisait voir au peuple des processions sans ordre, que même il verrait mal ; que si on lui tenait des discours qu’il n’entendrait pas, il n’aurait pas grand goût pour les fêtes nationales, cherchèrent à le captiver d’une manière plus efficace. Ils mirent en pratique ce principe : Qu’on trouve dans vos fêtes non ce que vous voulez qu’il y ait, mais ce qu’on désire d’y trouver (Aa).
La jeune personne que l’instinct de son sexe et les goûts de son âge, portent à captiver les hommages, veut y être remarquée, admirée ; elle y trouvait ce plaisir. Du temps de la chevalerie, les dames se plaisaient aux tournois où leurs amants devaient paraître ornés de leurs couleurs, et où ils devaient être couronnés de leurs mains : elles ne manquaient point alors de s’y rendre. Chaque village, chez les Olbiens, eut, dans les jours de solennités, son tournois en miniature. Il s’y établit, selon les localités, des jeux de l’arc, ou bien de la cible, ou bien de la joute sur l’eau ; non pas à qui se jetterait dans la rivière, mais à qui parcourrait plus vite, à la voile, ou à la rame, un espace convenu ; ce qui favorisait l’adresse, la force du corps, et la bonne construction des bateaux. Les plus habiles recevaient leurs prix des mains des jeunes filles, et celles-ci soupiraient toujours après le retour des fêtes nationales.
Les mères jouissent dans leurs enfants : ce furent elles qui menaient par la main leurs fils au concours, et qui les accompagnaient ensuite au lieu où les attendait la couronne. Les Olbiens flattèrent l’orgueil maternel : l’amour maternel adora leurs institutions.
L’homme parvenu à sa maturité, est avide de pouvoir et de distinctions. Ce penchant, lorsqu’il est effréné, fait les tyrans ; bien dirigé, il peut former les bons citoyens. Les grades militaires et les emplois qui avaient rapport à la police des fêtes, étaient donnés aux hommes qui s’y étaient distingués ; mais en même temps, il fallait qu’ils possédassent les autres talents reconnus nécessaires ; il fallait qu’on ne pût citer aucun trait honteux pour les candidats, et le désir de remporter des prix de pure adresse, dut être accompagné de projets favorables aux mœurs et à l’instruction.
Mais ce qui donna un grand caractère à ces fêtes, fut la distribution des honneurs et des récompenses accordés par les Gardiens des mœurs, aux citoyens qui s’étaient rendus recommandables par leurs vertus. Ce tribunal étendait ses correspondances jusqu’au fond des provinces les plus éloignées ; quelquefois, au moment le moins prévu, on voyait arriver, en faveur d’un particulier obscur, une récompense donnée par la nation, et à la plus prochaine solennité, elle lui était décernée. La reconnaissance nationale aimait à aller chercher un citoyen dont les actions avaient été utiles au public, à l’exemple des Romains, si soigneux, après les grandes calamités de leur République, de combler des témoignages de leur gratitude les étrangers, les esclaves, et jusqu’aux animaux qui, durant leurs disgrâces, leur avaient rendu quelque service signalé.
Mais ce n’était pas toujours, pas même souvent, une action éclatante qui obtenait ces récompenses. C’était plutôt la persévérance d’une conduite estimable ; car les actions brillantes sont rarement un profit pour la société. Quel avantage valut aux Romains la conquête des Gaules, si ce n’est la tyrannie de César (Bb) ? Les bonnes mœurs, éminemment utiles lorsqu’elles se rencontrent dans les grandes places, sont encore utiles à l’État, et plus qu’on ne peut croire, dans une situation privée. Tout citoyen estimable, non seulement ne fait jamais tort au public ou à ses concitoyens dans les rapports nombreux qu’il a avec eux, non seulement il n’assoit jamais ses spéculations sur des entreprises contraires à l’intérêt général, mais il ne s’entoure que de personnes estimables ; il choisit parmi d’honnêtes gens, son gendre, son associé, ses domestiques, ses protégés ; il est, sans qu’il s’en doute et sans que le gouvernement s’en aperçoive, un instrument actif de récompenses pour la bonne conduite, de honte et de privations pour le vice. Et je n’ai pas encore parlé du bon exemple qu’il fournit à sa famille, à ses voisins, à sa commune ; de la bonne éducation qu’il donne à ses enfants… Non, je ne crains pas de le dire : si la majorité d’une nation se trouvait composée de tels hommes, cette nation serait la plus heureuse de la terre ; il ne serait pas difficile de prouver qu’elle en serait encore la plus riche et la plus puissante.
J’ai considéré jusqu’à présent le bonheur comme récompense : il mérite d’être aussi regardé comme moyen. Il adoucit les mœurs qu’aigrit l’infortune. Mais la joie n’est pas le bonheur, et les feux d’artifice ne font pas le moindre bien à la morale. Le bonheur véritable se compose, non de plaisirs, mais d’une satisfaction soutenue, et de tous les instants. Aussi les Olbiens furent-ils convaincus qu’ils travaillaient pour les mœurs en multipliant les douceurs et les agréments de la vie.
Leurs villes, leurs villages étaient riants, leurs habitations commodes, propres, et d’une élégante simplicité. [42] Ils avaient de nombreuses fontaines et des jardins publics. Les communications des différentes provinces entre elles étaient faciles ; le peuple en devint plus sociable et les connaissances plus répandues. On aurait pris les chemins pour des promenades : un sentier large et élevé, des bancs et même des abris de distance en distance, rendaient dispos et content le voyageur à pied. Le simple citoyen regardait la patrie comme une mère, depuis qu’elle en avait les bontés ; et il lui restait quelques instants pour songer au bien général, depuis que l’État s’était occupé de son bien particulier.
Mais si les attentions de la société envers ses membres s’offraient partout à leurs yeux, partout aussi ils lisaient leurs devoirs envers elle.
Le langage des monuments se fait entendre à tous les hommes ; car il s’adresse au cœur et à l’imagination. Les monuments des Olbiens retraçaient rarement des devoirs purement politiques, parce que les devoirs politiques sont abstraits, fondés sur le raisonnement plus que sur le sentiment, et enfin parce que leur observation suit nécessairement de l’observation des devoirs privés et sociaux, qui, pareils à ces brins dont se composent les plus gros câbles, forment dans leur ensemble le lien le plus solide du corps politique. Les Olbiens n’avaient qu’un Panthéon des grands hommes, et plusieurs Panthéons pour les vertus. Ils ne se bornaient pas à élever un temple à l’Amitié, et à poser au-dessus de son portail un écriteau de bois, portant ces mots : À l’amitié. On y entrait, et tout rappelait à l’âme les douceurs que procure ce sentiment délicieux et les devoirs qu’il impose. Les yeux s’arrêtaient sur les statues d’Oreste et de Pylade, de Henri et de Sully, de Montaigne et de La Boétie. On avait gravé sur leurs piédestaux les principaux traits de leur vie ou leurs paroles mémorables. Parmi les inscriptions dont les murs du temple étaient ornés, on trouvait celles-ci :
Aime pour qu’on t’aime.
Qu’un ami véritable est une douce chose !
Pour les cœurs corrompus, l’amitié n’est point faite.
L’amitié d’un grand homme est un bienfait des dieux.
L’adversité est le creuset où s’éprouvent les amis.
Laisse voir à ton ami ton cœur jusque dans ses derniers replis, et sois sûr qu’il faut en ôter les sentiments que tu crains de lui montrer.
L’ami qu’il nous faut, n’est pas celui qui nous loue.
Il faut s’attendre à tout, hors à l’ingratitude d’un ami.
Cent autres temples s’élevaient pour célébrer d’autres vertus. Et ce n’était pas seulement dans l’intérieur des villes que les monuments parlaient au peuple ; c’était aussi dans les autres lieux fréquentés, au milieu des promenades, le long des grandes routes. La pierre, le bronze racontaient partout des actions louables, ou bien proclamaient des préceptes utiles. Des statues, des tombeaux enseignaient au peuple ce qu’il devait imiter, ce qui devait exciter ses regrets, ce qui méritait ses hommages. [43] C’est ainsi qu’au rapport de Platon, on pouvait faire un cours de morale en parcourant l’Attique.
Les préceptes étaient toujours choisis parmi les plus utiles et les plus usuels. Nous avons vu en quoi de justes notions d’économie politique étaient favorables à la morale : eh bien ! des notions de ce genre se mêlaient à toutes les autres ; l’agriculteur, le négociant, le manufacturier, en se promenant, en voyageant, s’éclairaient sur leurs vrais intérêts ; ils rencontraient, par exemple, les maximes suivantes dont le tour simple et pourtant vif se retient aisément, et se répète de même :
Aide-toi, le ciel t’aidera
On paie cher le soir les folies du matin.
Si vous aimez la vie, ne perdez pas le temps ; car la vie en est faite.
La Paresse va si lentement, que la Pauvreté l’atteint tout d’un coup.
Avez-vous une chose à faire demain ? faites-la aujourd’hui.
Il en coûte plus pour nourrir un vice que pour élever deux enfants.
N’employez pas votre argent à acheter un repentir.
Si vous ne voulez pas écouter la raison, elle ne manquera pas de se faire sentir.
On rencontrait encore, suivant les endroits, des préceptes applicables aux différentes professions, et même aux divers emplois de la société ; mais il a suffi, je pense, que j’indiquasse ceux qu’on vient de lire.
Les pères de famille suivirent peu à peu l’exemple offert par l’autorité publique ; car l’exemple que, dans les commencements, on imite si peu, est ce qu’il y a de plus infailliblement imité avec le temps. On put lire dans leurs maisons des sentences applicables à l’ordre intérieur des familles, et les enfants nourris de ces maximes, que l’expérience confirmait pour eux, en firent la règle de leur conduite, et la transmirent à leurs enfants. On fut heureux, parce qu’on fut sage : hommes et nations ne peuvent l’être autrement.
NOTES DE L’AUTEUR
Note (A).
Les devoirs qu’elle nous prescrit ne peuvent être que de deux espèces. Page 2.
Je ne conçois pas qu’il puisse exister des devoirs parfaitement inutiles pour les autres créatures ou pour nous-mêmes. Toute vertu qui n’a pas l’utilité pour objet immédiat, me paraît futile, ridicule, pareille à cette perfection de Talapoin, qui consiste à se tenir sur un seul pied plusieurs années de suite, ou dans quelque autre mortification nuisible à lui-même, inutile aux autres, et que son Dieu même doit regarder en pitié.
Note (B).
L’avantage en est immédiat et direct. Page 2.
On pourrait croire qu’il est superflu de rechercher les moyens de rendre l’homme fidèle à ces devoirs, qui ont pour objet son propre avantage, puisque l’intérêt personnel doit le porter naturellement à les remplir. Cela serait vrai, si l’homme connaissait toujours ses véritables intérêts ; mais il les sacrifie souvent, soit à ses passions, soit à des opinions fausses et même ridicules, comme ces Indiens qui, pour gagner le paradis, se précipitent sous les roues du char du grand Lama ; ou ces pieux cénobites qui, pour une cause pareille, usent leurs jours dans le jeûne et les macérations.
Enfin l’homme qui sacrifie un bien solide et durable à un plaisir passager, n’est pas mieux éclairé sur ses vrais intérêts. Montesquieu a dit : « Lorsque les sauvages du Canada veulent avoir les fruits d’un arbre, ils coupent l’arbre par le pied, et le renversent ; voilà le despotisme ». Montesquieu aurait pu dire avec la même justesse : Voilà le vice.
Note (C).
Il n’est pas de religion qui ne menace le pécheur de punitions effrayantes, qui ne promette des récompenses magnifiques à l’homme de bien. Que sont cependant ces nations si bien endoctrinées ? En est-il une seule où l’homme ambitieux n’ait pas écrasé ses rivaux, où la vengeance n’ait pas exercé ses fureurs, où l’amour du lucre n’ait pas inspiré les tromperies les plus honteuses et les plus viles prostitutions ? Page 13.
Je croirais m’écarter de mon sujet, si j’attaquais la vérité de telle ou telle religion ; je dois seulement prouver qu’elles n’ont point amélioré les mœurs du genre humain. J’examinerai ensuite si elles n’ont pas sur les hommes une influence plutôt funeste que favorable. Ce qui suit ne s’adresse pas aux vrais croyants, mais aux gens, peut-être plus nombreux, qui, ne croyant pas, sont néanmoins persuadés qu’il est dangereux de désabuser le vulgaire.
Que les religions n’ont pas amélioré les mœurs du genre humain ; c’est une vérité dont l’histoire offre malheureusement des preuves trop multipliées. Les temps de la plus grande dévotion ont toujours été les temps de la plus grande férocité, de la plus profonde barbarie ; les temps que chaque nation aurait voulu pouvoir effacer de ses annales. Les païens n’ont abandonné les sacrifices humains, que lorsque les lumières de la philosophie eurent ébranlé, chez les principaux d’entre eux, la croyance de leurs pères. Il fallut détruire la religion des druides pour abolir des horreurs du même genre. Le peuple le plus humain de l’Orient est le peuple chinois ; or le pouvoir y est entre les mains de l’empereur et des mandarins, qui sont tous des hommes éclairés et philosopher ; et les peuples mahométans, qui sont sans comparaison les plus religieux de la terre, en sont, quoi qu’en disent leurs partisans, les plus immoraux. Tous les vices d’Europe se retrouvent parmi eux ; ils se livrent à des sensualités barbares, qui font frémir : leur manière de faire la guerre est inhumaine ; les traités n’ont, chez eux, de garants que l’intérêt personnel. Un pacha manque de fidélité envers le sultan, et le sultan manque de parole au pacha, du moment qu’ils croient pouvoir le faire impunément. L’argent fait tout chez ces peuples ; la vertu rien.
Il y a plus : les religions n’excluent pas les vices et les crimes auxquels elles paraissent plus particulièrement opposées. Quelle secte a eu un fondateur et des principes plus doux que la religion chrétienne ? C’est la seule qui ait érigé l’humilité en vertu. L’oubli des injures, le pardon des offenses sont mis par elle au rang des premiers devoirs. Si l’on vous donne un soufflet sur une joue, a dit son auteur, tendez Vautre aussitôt. Les sectaires de cette religion étaient imbus de ces maximes dès l’enfance : on les menaçait de tourments éternels, s’ils ne les mettaient en pratique : cependant quelle secte offre plus d’exemples d’intolérance et de férocité ? laquelle a eu des ministres plus arrogants dans le pouvoir, plus implacables dans les vengeances ? Le temps où cette religion a brillé de tout son éclat, c’est-à-dire depuis Constantin jusqu’à Louis XIV, ce temps a été plus fécond en crimes qu’aucun autre, et la découverte d’un nouveau monde n’a servi qu’à étendre plus loin les calamités du genre Inhumain et la barbarie des disciples du doux Jésus. « Les ossements de cinq millions d’hommes, est-il dit dans un des meilleurs ouvrages de ce siècle, ont couvert ces terres infortunées où les Portugais et les Espagnols portèrent leur avarice, leurs superstitions et leurs fureurs. Ils déposeront, jusqu’à la fin des siècles, contre cette doctrine de l’utilité politique des religions, qui trouve encore parmi nous des apologistes ». [44]
Je n’ai point dit que les religions aient occasionné tous les maux qui ont marché à leur suite. Le défaut de lumières et de bonnes institutions, dont elles-mêmes n’étaient que les conséquences, a sans doute été la cause principale de cette grande détérioration des mœurs ; ce qu’il y a d’évident, c’est qu’elles ne l’ont pas empêchée.
Les avantages présents, ou du moins très prochains et évidents, sont les seuls qui fassent impression sur l’esprit de l’homme ; par la même raison, les maux sensibles et prochains aussi, sont les seuls qu’il redoute véritablement. L’effet des uns et des autres ressemble à l’explosion de la poudre à canon, qui cause un ébranlement violent lorsqu’elle est proche, et se fait à peine sentir à une grande distance. C’est par cette même raison qu’on se console avec le temps d’un malheur, quelque violent qu’il ait été.
Cette disposition dans l’âme humaine est peut-être ce qui rend les récompenses que promettent, et les châtiments dont menacent les religions, si peu efficaces. Examinez bien quels motifs ont balancé l’amour dans le cœur de cette femme, à qui son amant a demandé un rendez-vous : la crainte du scandale qui en résultera parmi ses connaissances et ses parents ; la crainte qu’une grossesse de contrebande, la naissance d’un enfant illégitime, ne la plongent dans un abîme de chagrins ; voilà ce qui la retient, plutôt que les chaudières bouillantes de l’enfer, qui certes devraient inspirer bien plus d’effroi. Si dans de certaines occasions, ce sentiment d’effroi a été exalté par des circonstances particulières, telles qu’un beau sermon, une solennité imposante, l’impression n’en a jamais été durable, elle s’est effacée par degrés, et le monde a repris son train.
Il en a été de même des récompenses. J’ai de la peine à croire que le bonheur de voir Dieu face à face ait jamais enfanté une belle action.
Mais non seulement il me paraît prouvé que les opinions religieuses n’empêchent pas le mal ; elles ont de plus, sur les habitudes de l’homme, des influences que je crois très fâcheuses.
On convient généralement aujourd’hui parmi les personnes qui font quelque usage de leur raison, que c’est un mauvais moyen de rendre les enfants sages, que de les menacer du loup ou du diable. On s’est aperçu que cette pratique peuple leur imagination de fantômes, qu’elle fausse leur jugement, rend leur âme timide, et par conséquent incapable de sentiments grands et généreux, et enfin que cette espèce d’argument n’étant pas susceptible de démonstration, son autorité s’affaiblit au lieu de s’accroître, et laisse l’esprit dépourvu de motifs plus solides pour se bien conduire. Eh bien, pourquoi faudrait-il employer dans l’éducation des hommes, un moyen reconnu si mauvais dans celle des enfants ?
En second lieu, l’homme ne peut donner qu’une certaine dose d’attention aux choses dont il s’occupe ; si l’on multiplie le nombre de ses devoirs, on diminue nécessairement le soin qu’il peut donner à l’accomplissement de chacun ; alors on voit des pratiques ridicules tenir la place d’obligations essentielles. « Nos prédicateurs, dit Voltaire avec le trait qui le caractérise, prouvent en trois points et par antithèses, que les dames qui étendent légèrement un peu de carmin sur leurs joues, seront l’objet des vengeances de l’Éternel ; que Polieucle et Athalie sont des ouvrages du démon ; qu’un homme qui fait servir sur sa table pour deux cents écus de marée un jour de carême, fait immanquablement son salut, et qu’un pauvre homme qui mange pour deux sous et demi de mouton, va pour jamais à tous les diables ».
On sent que les personnes qui font de l’exécution de ces graves devoirs, l’objet de leurs études, ne peuvent pas diriger la masse entière de leurs affections vers les devoirs véritables, qui d’ailleurs sont mis en seconde ligne par les personnes religieuses, comme étant des devoirs mondains. L’homme est toujours porté à l’indulgence envers lui-même ; lorsqu’il a rempli des devoirs qu’il regarde comme indispensables, il se repose satisfait de ses efforts. Une personne religieuse fait tacitement ce raisonnement : il n’est pas donné à la créature d’être en tout parfaite ; ceux qui se plaignent de moi n’en ont pas tant fait ; il est bien facile de contenter le monde, quand on se met à l’aise sur tout le reste, etc. Elle se paie de ces raisons et d’autres semblables, et trop souvent elle vit mal avec les hommes, se croyant assez bien avec Dieu.
Dans les anciens États du pape, le même homme se précipitait de bonne foi au-devant du Saint-Père, afin de recevoir ses bénédictions, et pour trente-six francs, il se chargeait de donner un coup de stylet à votre ennemi.
Sous le rapport économique, les pratiques religieuses absorbent un temps et des facultés, qui pourraient être employés d’une manière productive. On sait à présent combien les ordres religieux, qui dans leur oisiveté consomment et ne remplacent pas, appauvrissent un État. Le même inconvénient a lieu à l’égard de tous les ministres des cultes ; il est seulement moins sensible dans les pays où ils sont moins nombreux. Les jours de repos, qui ne sont pas absolument nécessaires au rétablissement des forces physiques et morales, produisent un mal du même genre. [45] Les personnes qui se sont occupées d’économie publique, sentiront la valeur de cette raison.
D’autres obligations sont encore plus funestes à la chose publique, et même sont directement contraires aux devoirs du citoyen. On trouve un exemple bien triste de cette espèce de danger dans Flavien Josephe.
« Pendant le siège de Jérusalem, dit cet historien, Pompée fit construire une terrasse du haut de laquelle les Romains battaient le temple avec leurs machines de guerre. Si les Juifs n’avaient été empêchés par leur croyance de rien faire le jour du sabat, pas même les actes nécessaires à leur défense, jamais les Romains n’eussent achevé cette terrasse. Aussitôt que Pompée se fut aperçu de cela, il n’exposa point ses soldats à y travailler les autres jours que celui du sabbat… Les Romains choisirent pour l’assaut un jour de jeûnes et de prières ; après avoir pris le temple, ils tuèrent tous ceux qui s’y trouvèrent. Les Juifs n’en continuèrent pas moins leurs prières et leurs sacrifices, ne pouvant en être détournés ni par la crainte de la mort, ni par le désir de secourir leurs frères que les Romains égorgeaient, tant est grand leur respect pour les institutions divines » ! [46]
Certes, voilà une utile dévotion ! Et que penser de la naïveté de ce bon historien juif, qui regarde cette circonstance comme tellement honorable pour sa nation et pour sa religion, que dans la crainte qu’on ne doute de la vérité de son récit, il invoque le témoignage de Tite-Live et de Strabon ?
La même chose à peu près eut lieu à Rome, sous le règne d’Aurélien. Les barbares étaient aux portes de la ville, et l’em-pereur, à la tête d’une armée, les tenait en échec ; mais il avait besoin de secours : le sénat offrait des sacrifices. Il lui écrivit pour hâter sa lenteur : On imaginerait, dit-il, que vous êtes assemblés dans une église chrétienne, non dans le Panthéon de Rome.
Aucune religion ne fait consister la suprême vertu dans le bien qu’on fait aux autres ; ce n’est qu’un précepte accessoire dans toutes ; le précepte essentiel est l’attachement au dogme, à la foi, à la secte, en un mot, et à ses rites. Elles vous disent, faites le bien, d’accord ; mais surtout soyez fidèles à votre croyance : quiconque ne croit pas, est un l’éprouvé, un libertin, un scélérat auquel il est dangereux de se fier. [47]
Lorsque le dogme renferme des articles évidemment absurdes, l’absurdité ne tarde pas à éclater aux yeux des personnes éclairées, d’abord, et ensuite de tout le monde. Alors les esprits façonnés dès l’enfance à regarder comme une même chose la croyance et la morale, jugent que cette dernière est vaine comme l’autre, et le mépris qu’on ressent pour le dogme, fait mépriser les préceptes quelquefois très louables, dont il était accompagné. C’est peut-être à cette cause qu’on doit attribuer en partie les excès dont la populace de quelques-unes de nos villes s’est souillée à différentes époques depuis la révolution ; elle n’avait point d’autre morale que celle des curés : le choc des évènements politiques devait tôt ou tard renverser les curés ; mais ce renversement n’aurait point ébranlé la moralité du peuple, s’il avait eu la véritable moralité : celle qui est dans le cœur et dans les habitudes.
Ensuite, et c’est une chose très remarquable, les livres sacrés, dans presque toutes les religions, sont d’une immoralité révoltante. Platon, dans sa République, ne veut point qu’on entretienne les jeunes gens de la théogonie des Grecs, renfermée dans les livres saints de ces temps-là. Il pense que ces livres offrent des exemples de dissension entre les hommes, de vengeance de la part des dieux, et en général, de mauvais modèles appuyés sur de grandes autorités. Il ajoute que c’est un malheur insigne que de s’accoutumer de bonne heure à ne trouver rien d’extraordinaire dans les actions les plus atroces. N’est-il pas bien honteux pour nous, que dans cette théogonie des Grecs, qui excite une si vive indignation dans l’âme du disciple de Socrate, on ne rencontre cependant ni un patriarche qui prête sa femme pour de l’argent, comme Abraham, ni un inceste aussi dégoûtant que celui de Loth, ni des histoires aussi scandaleuses que celles du lévite d’Ephraïm, d’Onan, de Jahel, de Judith, de David, et mille autres ?
Enfin une cruelle expérience a prouvé que la superstition, ou le fanatisme, qui n’est que la superstition mise en action, est de toutes les passions la plus ravageante, la plus féconde en actes de cruauté. En recherchant la cause de cette désastreuse propriété, on trouve que toutes les passions, hors celle-là, proviennent d’un désir, d’un appétit qui peut agir avec violence, mais dont la violence n’est pas continuelle. Lorsque l’objet de la passion est obtenu, ou lorsque ses accès sont passés, l’humanité, la conscience reprennent leurs droits. Le fanatisme seul n’est point sujet à ces intermittences ; il cause le mal sans exciter le remords. Le fanatique ne croit pas soutenir sa propre cause, en défendant son opinion ; il croit au contraire se dévouer, et avoir droit aux plus grands éloges lorsqu’il commet les plus grands forfaits ; tels les révérends pères inquisiteurs, qui appellent leurs boucheries humaines des actes de foi ! Or, quel crime est plus dangereux que celui qu’on prend pour une vertu !
On dira peut-être que ces maux commencent à cesser, que les mœurs de l’Europe ne laissent plus redouter les fureurs du fanatisme. Eh ! cette disposition n’est due qu’à l’esprit philosophique qui a affaibli l’influence des opinions religieuses, même chez ceux qui les professent encore. Les idées sont devenues si libérales chez les personnes qui se croient les plus orthodoxes, que cent ans plutôt elles eussent passé pour hérétiques si elles avaient professé les mêmes opinions. Leur esprit de tolérance, leur incrédulité sur quelques points qu’elles ont rejetés comme trop ridicules, eût passé alors pour un libertinage de l’esprit et un relâchement menant droit à la perdition.
Une autre conviction qui résulte de la contemplation des évènements passés, c’est que les religions détruisent une partie du bonheur de l’homme sur la terre, le seul dont le moraliste politique puisse s’occuper. Dans la religion chrétienne, par exemple, les terreurs de l’âme, les devoirs futiles, les pénitences multipliées, les défenses oiseuses, la longueur des prières, la sévérité des pratiques, altèrent le caractère.
L’évangile à l’esprit n’offre de tous côtés,
Que pénitence à faire et tourments mérités,
a dit Boileau. Dans les temps, et chez les nations où il a complètement dominé, l’homme était triste, morne, hébété : le passé ne lui offrait que des regrets, le présent que des entraves, l’avenir que des craintes. Comparez les statues des Grecs avec les statues du Moyen âge : beauté de l’art à part, vous apercevrez en général la sérénité du bonheur, la tranquillité de l’âme empreintes dans les premières ; et dans les autres, vous verrez toujours la sombre tristesse de gens farouches, dominés pas la terreur, et bourrelés par leur conscience.
Que si l’on cite des exemples qui prouvent que les religions aient produit un bien incontestable, il n’en résultera autre chose, sinon que c’est un mauvais moyen qui a pu réussir quelquefois, mais qui n’est pas moins accompagné des plus grands dangers.
Si l’on se retranche dans quelques principes religieux, et qu’on abandonne tout le reste, comme l’intervention divine, les prêtres et ce qui s’en suit, alors on se borne à embrasser un système philosophique, tel que celui de Socrate, sur l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme, celui de Zenon, ou bien celui d’Épicure ; mais cela même est de la philosophie.
Au surplus, le danger des superstitions fût-il plus grand encore, il ne faut jamais tenter de les renverser par l’intolérance et la persécution. D’abord, parce que la persécution est elle-même un mal et un mal affreux, outre qu’elle attaque le plus évident et le plus inviolable de tous les droits, celui qu’a tout homme de penser comme il lui plaît. Ensuite, parce que ce moyen va directement contre son but : l’opiniâtreté est un des travers de l’homme, et les persécutions de quelques empereurs ont merveilleusement servi à l’établissement du christianisme.
Il faut donc n’employer jamais, en matière d’opinion, que les armes de la persuasion, et laisser faire le reste au temps et aux progrès naturels de l’esprit humain.
Note (D).
L’homme soupire sans cesse après le bonheur, et principalement après le bonheur prochain et sensible. Page 16.
Je dois prévenir ici une objection qu’on ne manquera pas de me faire : « Selon vous, dira-t-on, l’appât du bonheur est nécessaire pour rendre les hommes vertueux, et la vertu procure le bonheur ; donc elle porte avec elle son encouragement ; donc toute institution qui emploie le bonheur comme moyen, est superflue ».
Je prie qu’on ait égard à une distinction importante. Le bonheur que la vertu procure à une nation, lorsqu’elle est généralement, ou presque généralement pratiquée, est un bonheur composé de toutes les jouissances tranquilles et pures qu’entraîne l’exercice du bien, qu’on en soit l’agent ou bien l’objet. Le bonheur prochain que je donne ici comme moyen, et non comme fin, est cette jouissance prompte et personnelle après laquelle on court dans les sociétés corrompues, quoiqu’elle ne débarrasse avec certitude, ni des remords présents, ni de l’inquiétude future, ni des maux fruits de l’intempérance, ni des maux produits par la haine des autres et par leur mauvaise foi. À mesure que les sociétés politiques feront des pas vers la vertu, ce bonheur moyen se changera en un bonheur résultat, le seul vraiment digne de l’ambition des hommes, et le seul capable de procurer une félicité constante, autant que l’admet notre nature.
Note (E).
…Une nation qui n’est parvenue à consolider l’édifice de cette liberté, qu’en changeant totalement ses mœurs, ou, si l’on veut, ses habitudes. Page 20.
Les plus grandes révolutions ne sont pas les révolutions politiques. Elles font passer le pouvoir des mains d’un seul ou d’un petit nombre entre les mains de la multitude, qui est bientôt obligée de le confier de nouveau à un petit nombre ou bien à un seul, surtout chez les grandes nations. Qu’en résulte-t-il lorsqu’une révolution morale ne suit pas celle-là ? Rien, ou presque rien. L’autorité change de main, mais la nation reste la même. Les opinions, les passions, l’ignorance, par conséquent l’infortune, subsistent ; les mêmes fautes des gouvernants se renouvellent, etc.
Quid leges sine moribus
Vanœ procifiunt ?
Hor.
Note (F).
Pour réformer les mœurs d’un peuple, c’est une belle institution que la République. Page 22. (À la note.)
Il est à propos d’aller au-devant d’une objection que bien des personnes ne manqueront pas de faire au sujet de cette assertion, que l’établissement d’un gouvernement républicain est favorable à la pureté des mœurs. Elles diront que l’expérience elle-même plaide contre ce principe, et elles auront beau jeu à trouver des exemples d’immoralité dans les temps qui entourent le berceau de la république française. Pour les combattre, j’emprunterai les armes que me fournit un auteur qui a publié un écrit sur la matière qui m’occupe, le citoyen de T…, dont l’ouvrage et les initiales décèlent un penseur profond et un excellent écrivain. Voici ce qu’il dit à ce sujet :
« Personne malheureusement ne peut nier que depuis quelques années, en France, les crimes sont plus nombreux, les passions plus exaspérées, les malheurs particuliers plus multipliés ; en un mot, que le désordre de la société est plus grand qu’auparavant. Les meilleurs citoyens sont ceux qui en sont le plus affligés.
Quelle est la cause de cette triste vérité ? Tous les gens irréfléchis, et c’est le grand nombre, vous répondent que la révolution a démoralisé la nation française : et ils croient avoir rendu raison de tout. Mais qu’entendent-ils par ce mot ? Veulent-ils insinuer que le changement de gouvernement a rendu nos mœurs plus dépravées, nos sentiments plus pervers ? Alors ils oublient que les mœurs et les sentiments des hommes ne changent point ainsi du jour au lendemain, ni même en un petit nombre d’années. Il est constant, au contraire, que le temps présent est toujours, pour ainsi dire, le disciple du temps antérieur, et que nous sommes mus aujourd’hui par les habitudes, les passions et les idées contractées ou acquises sous l’ancien ordre social. Si telles étaient les causes de nos maux actuels, il faudrait sans hésiter les attribuer tous à cet ancien régime si follement regretté…
Veulent-ils insinuer que les principes sur lesquels repose le nouvel ordre social sont destructifs de la morale ? Cette prétention serait insoutenable : car ce qui caractérise particulièrement le nouveau système, et le distingue spécialement de l’ancien, c’est de professer plus de respect pour les droits naturels et originaires des hommes que pour les usurpations postérieures ; de consulter les intérêts du grand nombre plus que ceux du petit ; de préférer les qualités personnelles aux avantages du hasard ; de mettre la raison au-dessus des préjugés et des habitudes, de soumettre toutes les opinions à son examen, et d’obéir à ses décisions plutôt qu’aux autorités et aux exemples. Assurément on ne peut nier que l’adoption de chacune de ces idées ne soit un pas vers la justice. Aussi les plus violents adversaires de ce système ne l’ont jamais attaqué dans ses bases. Tous, en le déclarant impraticable, sont convenus que c’était une sublime théorie. Ce ne sont donc pas ses principes qui sont opposés à la saine morale ; au contraire.
Cependant par quelle fatalité la somme du mal moral est-elle encore plus grande sous le règne des vérités que sous celui des erreurs ? C’est que les troubles intérieurs et extérieurs qui ont accompagné cette grande et subite réformation, ont encore accru les besoins de l’État, et par conséquent les désordres de l’administration, et ont diminué l’action des lois répressives dans le moment où elles étaient le plus nécessaires. Avec ces deux circonstances, la pratique de la morale s’est détériorée, quoique sa théorie se perfectionnât.
Ajoutons, pour notre consolation, que si le mal moral est augmenté, il ne peut être que momentané. N’étant pas une conséquence de nos institutions politiques, étant même contraire à leur esprit, il ne peut subsister longtemps avec elles. Il faut qu’il les renverse ou qu’elles le subjuguent. Et puisqu’elles ont pu naître, elles doivent avoir de profondes racines. Le mal est toujours le mal ; mais il est bien différent qu’il soit l’effet de l’ordre établi ou de la difficulté de son établissement. C’est, ce me semble, ce que l’on n’a pas assez distingué, soit qu’on ne l’ait pas voulu, ou qu’on ne l’ait pas su ».
Note (G).
Les grandes richesses ne sont pas moins funestes aux bonnes mœurs. Page 25.
Une question qui me paraît mériter d’être attentivement examinée, c’est de savoir si, parmi les moyens de favoriser les fortunes médiocres, il convient d’employer dans l’assiette des contributions une progression géométrique, au lieu d’une progression arithmétique.
On a dit qu’une contribution qui impose les revenus davantage à mesure qu’ils deviennent plus considérables, tend à décourager l’industrie, parce qu’elle la charge d’autant plus, qu’elle obtient plus de succès. On a dit encore qu’en suivant une progression toujours croissante, l’impôt doit finir par emporter la totalité du revenu ; ce qui équivaudrait à une expropriation.
Il me semble que ces deux inconvénients résultent seulement de certaines espèces de progressions géométriques ; mais qu’il est d’autres progressions qui ne les entraînent en aucune façon. Il en est telle qui s’augmentant toujours à mesure que le revenu s’augmente, n’enlève jamais au contribuable la totalité, mais seulement une partie de cette augmentation, de même que certaines courbes en géométrie s’approchent constamment d’une ligne droite sans jamais la joindre. Par exemple, à chaque augmentation de revenu, la part de l’État pourrait n’enlever, outre la contribution précédente, qu’un dixième de l’amélioration ; l’industrie ne serait pas découragée, puisque l’individu industrieux profiterait toujours de neuf dixièmes sur l’amélioration produite par son industrie.
Cette distinction une fois faite, ce mode paraît le seul équitable ; car les besoins de l’homme ne s’étendant point en raison directe de l’augmentation de sa fortune, le superflu augmente dans une proportion progressive, à mesure que la fortune s’accroît. Or l’impôt doit être en raison directe du superflu seulement ; car le nécessaire, c’est-à-dire cette portion de revenu sans laquelle on ne peut vivre, ne saurait être taxé ; autrement la taxe serait un arrêt de mort.
Pour parvenir au même but, on a dit : distrayez d’un revenu ce que vous croyez nécessaire pour vivre, d’accord ; et imposez le reste sans progression. Mais, dans l’état de civilisation, il est impossible d’établir le taux du nécessaire. Le nécessaire se fond en nuance imperceptible dans le superflu ; et ce sont précisément les dégradations de cette nuance qu’atteint équitablement une contribution progressive bien conçue, c’est-à-dire une contribution qui n’absorbe jamais qu’une portion modérée de l’augmentation du revenu.
Elle est encore équitable par cette raison, que dans l’état de civilisation, l’augmentation de revenu est d’autant plus difficile, que le revenu est moindre. Suivant un dicton populaire, les premiers cent écus sont plus durs à gagner que les derniers cent mille francs ; c’est-à-dire que, lorsqu’on est parvenu à un certain degré de fortune, la facilité de gagner est augmentée dans la proportion de 333 à 1. Je suis loin de vouloir que la progression de l’impôt augmente dans cette proportion, qui, si le dicton était juste, serait pourtant conforme à l’équité.
Note (H).
Un brevet d’instruction, sans lequel la route des grandes places lui était fermée. Page 26.
« À la Chine, il n’y a proprement que trois classes d’hommes : les lettrés, parmi lesquels on choisit les mandarins, les agriculteurs et les artisans, dans le nombre desquels on comprend les marchands. Ce n’est qu’à Pékin qu’on confère les derniers degrés dans les lettrés, à ceux qui, dans un examen public, montrent qu’ils ont acquis beaucoup de lumières sur les sciences de la morale et du gouvernement, telles qu’elles sont enseignées dans les anciens auteurs chinois, et avec lesquelles l’histoire du pays est intimement liée. L’empereur distribue parmi ces gradués tous les emplois civils de l’État ». Macartney, tom. III, pag. 184.
Note (I).
Afin d’éviter les maux qui suivent l’oisiveté, &c. Page 27.
À Olbie, les pâturages, et en général toutes les propriétés rurales, sont clos par des haies vives. On ne se clouterait pas que cet usage fût favorable aux mœurs. Cependant qu’on prenne la peine d’observer que les gens qu’on emploie à la campagne à mener paître les bestiaux (et ce sont ordinairement des enfants), y prennent l’habitude de l’oisiveté, et la conservent souvent toute leur vie ; heureux quand ils n’y contractent pas celle du vol et de quelques autres vices ! Mais lorsque les pâturages sont clos, on y laisse les bestiaux sans gardiens, et il y a moins de temps et de facultés perdus, moins de mauvaises habitudes contractées. Aucune loi, aucun règlement n’est sans influence sur la morale. Jadis, à Olbie, on ne paraissait pas s’en douter.
Tant que le système politique actuel exigera une armée permanente, même en temps de paix, il faudra éviter la corruption, qui naît de l’oisiveté des militaires dans les garnisons. Le meilleur moyen sera d’imiter les Romains, qui occupaient les loisirs de leurs troupes à construire ces utiles chaussées qui se prolongeaient jusqu’aux extrémités de l’empire, ces pouls, ces amphithéâtres, ces portiques qui excitent encore noire admiration. Annibal usa de la même politique : on rapporte que, dans la vue de garantir ses troupes des suites funestes de l’oisiveté, il les força de planter des oliviers le long des côtes d’Afrique. [48] Je sais que nous aurions des préjugés à vaincre ; mais il y a des moyens de les combattre. On peut flatter l’orgueil des corps militaires, en attachant leur nom aux ouvrages qu’ils auront exécutés ; on peut leur attribuer une haute-paie, et compter les années consacrées à ces travaux, comme des années de guerre, etc.
Note (K).
Vous deviendrez riches ; mais vous ne resterez pas vertueux, vous ne serez pas longtemps indépendants et libres. Page 31.
Lorsque l’influence de l’argent devient immense dans une nation, et que le soin de s’en procurer est le premier de tous, la politique de cette nation devient étroite, exclusive, et même barbare et perfide. C’est l’influence des marchands qui a déterminé et dirigé la plupart des guerres que l’Angleterre a faites depuis qu’elle est devenue éminemment commerçante. « La violence et l’injustice des conducteurs du genre humain, dit Smith[49], est un mal ancien contre lequel je crains bien qu’il n’y ait point de remède ; mais la capricieuse ambition des rois et des ministres n’a pas été, durant le dernier siècle et celui-ci, plus fatale au repos de l’Europe que l’impertinente jalousie des marchands ». Or, si toute une nation se compose de marchands, comment s’élèvera-t-elle à ces idées libérales qui seules peuvent améliorer le sort du genre humain ?
Supposons un moment que chacune des communes, petites et grandes, qui composent la France, loin de chercher à multiplier leurs communications, et à étendre leurs relations entre elles, entourât son territoire d’une clôture, et, dans la vue de favoriser le débit de ses propres denrées, empêchât l’introduction des denrées des communes voisines, ou du moins y mît de grandes entraves ; ces communes en seraient-elles plus heureuses, plus riches et mieux pourvues ? Loin de là, dira-t-on. Eh bien ! ces lignes de places fortes, ces douanes, ces commis qui garnissent les frontières des États, ont le même inconvénient pour tous et pour chacun. Sous prétexte d’enfermer en dedans l’argent, on ferme en dehors l’abondance. Le jour où l’on fera tomber les barrières qui séparent les nations, détruira la cause la plus féconde des guerres, et précédera de peu de temps une époque de prospérité générale. Mais le moyen de faire entendre cela à ceux qui ne combinent que des prix-courants ?
Note (L).
Tel écrivain, du fond de son modeste cabinet, travaille plus efficacement à établir la gloire, la puissance et le bonheur de son pays, que tel général qui lui gagne des batailles. Page 32.
Les hommes riches ou les hommes élevés en dignités, ont eu souvent pour les gens à talents, une considération si petite, qu’elle avoisinait le dédain. La raison en est, je crois, que les gens riches et les gens en place, pouvant exercer une grande influence d’une manière prompte, et regardant les gens à talents comme des personnes dont l’influence est plus faible et plus éloignée, ils croient avoir peu à craindre et à espérer d’eux. Or c’est là ce qui engendre le dédain.
Plus les gens puissants par leurs emplois ou par leurs richesses, sont médiocres, plus ils sont portés à croire que cette influence des talents est faible et éloignée ; ils doivent par conséquent les dédaigner plus que d’autres.
Par la raison contraire, s’ils ont des talents eux-mêmes, ils en connaissent la valeur, les attirent, les ménagent ; et une preuve infaillible de mérite personnel dans un homme puissant, c’est de le voir entouré de gens de mérite. J’ai beau chercher dans l’histoire, je ne trouve point d’exemples qui contredisent ce principe.
Mais on sent qu’il ne peut être justement appliqué que par des spectateurs absolument désintéressés ; car, s’il est fondé, les sots en pouvoir et les sots qui les entourent, sont trop intéressés à se croire mutuellement des génies, pour s’apprécier équitablement les uns les autres.
Note (M).
Je combattrais accidentellement l’éloquent paradoxe du philosophe de Genève, Page 32.
La grande vénération que j’ai pour Rousseau, la persuasion où je suis que ses écrits seront au nombre de ceux qui contribueront le plus au perfectionnement futur de l’espèce humaine, n’a jamais fermé mes yeux à ce que j’ai cru être chez lui des erreurs. Ses enthousiastes lui ont fait du tort comme ils en font toujours. En admirant tout dans ses ouvrages, ils ont décrédité ce qui s’y trouve de beau, de sublime, d’admirable ; ils ont engendré ses détracteurs.
Pour moi, j’aimerais mieux qu’il n’eût pas écrit sa diatribe contre les connaissances humaines. Les principes m’en paraissent faux, les conséquences forcées, et les exemples nullement concluants. Voici un de ces exemples les plus brillants :
« Que dirai-je de cette métropole de l’empire d’orient qui, par sa position, semblait devoir l’être du monde entier, de cet asile des sciences et des arts proscrits du reste de l’Europe, plus peut-être par sagesse que par barbarie ? Tout ce que la débauche et la corruption ont de plus honteux ; les trahisons, les assassinats et les poisons de plus noir ; le concours de tous les crimes de plus atroce : voilà ce qui forme le tissu de l’histoire de Constantinople ».
C’est bien vrai. L’histoire du Bas-Empire est une des plus dégoûtantes qu’on puisse lire. Mais n’est-ce pas plutôt parce que les Romains y transportèrent leurs vices et leur corruption, que parce qu’ils y transportèrent leurs arts ? Pourquoi chercher une cause indirecte et disputée, lorsqu’il y en a une directe et naturelle ?
Les mêmes excès qui avaient souillé les règnes des Tibères et des Nérons, se répétèrent dans l’empire grec, avec un caractère plus hideux et plus bas s’il est possible. Mais si les sciences et les arts eussent été la cause de cette corruption, elle eût diminué en même temps que les sciences et les arts y dégénérèrent ; bien loin de là, elle augmenta.
Rousseau dit que ce fut peut-être plus par sagesse que par barbarie, que les arts furent proscrits du reste de l’Europe. C’est à dire que ce fut par sagesse qu’Attila saccagea l’Italie, que les Vandales ravagèrent et cette Espagne si riche, et cette côte d’Afrique couverte de cités si florissantes ; ce fut par sagesse que les chrétiens barbares de l’occident firent les croisades, etc., etc.
Soyons de bonne foi : ce sont les institutions civiles et politiques qui entraînent la corruption des mœurs. Les mœurs des Romains devinrent abominables, quand le sort des armes eut mis les richesses du monde entre leurs mains, et renversé la république. Les mœurs de l’empire de Constantin ne furent pas moins corrompues par les mêmes causes, et elles prirent un caractère plus vil et plus féroce, à mesure que le gouvernement, sans cesser d’être absolu, devint plus faible et le peuple plus superstitieux.
Autre erreur. Dans ce discours, Rousseau confond sans cesse la vertu avec l’amour de la liberté et le courage de la défendre ; et à ce compte, il trouve les Chinois le plus vicieux de tous les peuples.
Note (N).
Ils établirent des caisses de prévoyance. Page 33.
Dans nos villes, il y a actuellement un grand nombre de professions dans lesquelles les ouvriers gagnent en six jours leur dépense de dix. Ils pourraient donc, en se réservant un jour pour le repos, mettre de côté la valeur de trois journées par décade. Dans les villes, chaque journée peut être évaluée deux francs : ainsi un ouvrier pourrait, avec de la conduite, mettre six francs tous les dix jours à la caisse d’épargnes. Or un homme qui, à l’âge de vingt ans, mettrait tous les dix jours de côté six francs jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, toucherait à cet âge, par l’effet des intérêts accumulés à cinq pour cent, un capital de près de vingt mille francs ; mais pour que l’ouvrier ait confiance dans une caisse d’épargnes, il ne faut pas qu’il puisse redouter les conceptions fiscales d’un gouvernement versatile, qui serait capable, l’année suivante, de supprimer ou de dénaturer l’établissement.
Note (O).
Ce serait en vain que le moraliste travaillerait à rendre les hommes bons, si on laisse subsister des lois qui tendent à le rendre pervers. Page 34.
« Une personne qui viole les lois de son pays, quoique certainement très digne de blâme, peut être incapable de transgresser les règles de la justice naturelle. Tel aurait pu être un excellent citoyen, si les lois n’avaient pas fait un crime de ce qui n’en est pas un aux yeux de la nature. On voit, par exemple, peu de gens scrupuleux relativement à la contrebande, lorsqu’elle peut s’opérer sans les compromettre. Manifester des scrupules pour acheter des marchandises introduites en fraude, serait considéré en de certains lieux, comme une délicatesse ridicule ; cependant on protège par là le vol des revenus publics, ainsi que le parjure qui accompagne ordinairement la contrebande ; l’indulgence du public encourage le contrebandier ; et lorsque la force publique le trouble dans ses opérations, il est prêt à employer la résistance ouverte, pour protéger ce qu’il s’est accoutumé à regarder comme un métier.
Sous les gouvernements corrompus, où l’argent du peuple va engraisser des fripons ou des traitants, ou se dissipe en folles entreprises, les particuliers se font très peu de scrupule de frauder le fisc ; de là les ruses, les fausses déclarations, etc., etc. » [50]
Il résulte de tout cela, que sans la moralité de la législation, sans la moralité de l’administration, il ne faudra jamais compter sur la moralité du peuple.
Note (P).
Ils supprimèrent les loteries. Page 35.
Lorsqu’il fut question à Olbie de supprimer les loteries, un préposé du fisc représenta qu’on allait perdre un million de pièces d’or qu’elles valaient annuellement au trésor public ; on lui répondit : Si les loteries nous l’apportent un million, la portion de mœurs que les loteries nous ravissent, en vaut plus de dix.
Je raconterai à ce sujet ce qui arriva au temps d’une guerre dans ce même pays d’Olbie. On avait imposé à un peuple vaincu une contribution excessive ; on croyait cette mesure excusée par la nécessité de subvenir aux besoins de l’armée. Un sage s’avança et dit : « Si vous êtes justes et modérés, vous recevrez des contributions un peu moins fortes, mais vous n’aurez pas besoin de tant de soldats pour vous faire obéir. La justice et la modération vous vaudront cent mille hommes, et ne coûteront pas tant à nourrir, sans parler de la bonne réputation que vous laisserez après vous ».
Dans tout autre pays, on aurait tourné le dos à ce radoteur : à Olbie, on le lit percepteur des contributions de guerre, et il se conduisit d’après ses principes ; ce qui au reste n’arrive pas toujours.
Note (Q).
Tout chez eux devint un instrument de récompense. Page 36.
On objectera d’abord, que dans la distribution des places, il faut plutôt considérer les talents qui conviennent à la place, que l’avantage d’en faire un instrument de récompense ; mais il se trouve toutes sortes de places pour toutes sortes de talents ; et d’ailleurs, tous les encouragements qui sont à la disposition des chefs d’une nation, ne sont pas de l’or et des places. La plus petite caresse a souvent plus de prix que le bienfait le plus grand.
On prétendra que le véritable patriotisme doit être désintéressé, et qu’on doit se sacrifier pour son pays sans en rien attendre ; on fera là-dessus de fort belles phrases ; elles seront applaudies de la multitude ; ce seront même les seules applaudies. Mais au sortir d’une telle assemblée, le philosophe ira proposer au plus bruyant applaudisseur, que dis-je ? à l’orateur qui avec le feu de la persuasion et les yeux humides, aura manifesté ces sentiments généreux ; il leur proposera, dis-je, le moindre sacrifice en faveur du bien public… et il ne l’obtiendra pas. Alors, replongé dans ses réflexions, et connaissant mieux le moyen d’agir sur l’esprit des hommes, il ne fera plus dépendre le bien public de vains discours ; il sentira la nécessité de l’asseoir sur une base moins brillante et plus solide.
Pourquoi du temps de la république romaine, les questeurs chargés à la suite des armées, de l’emploi délicat de recueillir les dépouilles des vaincus, se distinguèrent-ils par leur probité ? C’est que la questure était le premier pas pour arriver aux charges curules. Chez un peuple où l’on peut parvenir à tout sans qu’on soit honnête homme, le grand nombre sera toujours d’avis que ce n’est pas la peine de l’être.
Note (R).
Les Olbiens instituèrent, non des sociétés politiques, &c. Page 38.
Ce n’est point dans les sociétés politiques qu’on peut faire de bons choix pour les fonctions publiques : l’intrigue et l’adresse y sont trop sur leurs gardes et ont un trop grand soin d’y teindre leurs discours de la couleur du moment ; tandis que dans des réunions habituelles et de simple délassement, on apprend à connaître les sentiments et les vertus de l’homme privé. C’est là qu’on sait s’il est probe dans son commerce, s’il a soin de son père, de son épouse, de son fils ; s’il a du bon sens naturel et des lumières acquises. Or ce sont ces qualités-là qu’il suffit de connaître pour faire de bons choix. Il en résulte que si l’on veut que des réunions de citoyens soient utiles à la chose publique, il faut précisément éviter qu’elles soient des réunions politiques.
Note (S).
Pas un de vos gestes, pas une de vos paroles ne sont perdus. Page 41.
Si l’exemple des chefs d’une nation est fort propre à répandre des habitudes morales, il faut l’attribuer non seulement à notre penchant vers l’imitation, mais encore à une sorte d’envie qui ne veut pas faire moins que les personnages éminents. On se dit : untel a fait ceci, pourquoi ne le ferais-je pas ? Éraste, qui joue un si grand rôle, se permet telle action ; pourquoi me l’interdirais-je ? Il est haut, dédaigneux : si j’étais affable, on me croirait humble ; si j’étais bon homme, on s’imaginerait que je suis sans conséquence.
Mais lorsque les hommes en pouvoir, au contraire, ont de la sociabilité, des vertus, on rougit de n’en pas avoir ; on se dit : untel qui est fort au-dessus de moi, est simple et bon ; si j’ai de la morgue et de mauvaises mœurs, je deviendrai odieux et ridicule. Si l’on ne fait pas positivement ce raisonnement, le sentiment des convenances et l’intérêt personnel font qu’on se conduit comme si on le faisait.
À Olbie, lorsqu’un incendie se manifestait autrefois, c’était à qui se soustrairait au devoir d’y porter des secours. Plusieurs fois les premiers magistrats travaillèrent aux pompes, et donnèrent momentanément un abri et des vêtements aux incendiés ; depuis lors, c’est à qui se distinguera par les mêmes bienfaits.
Note (T).
Lorsque le peuple d’Olbie vit les places occupées par des hommes probes, instruits, dévoués à la chose publique sans l’être à aucun parti, &c. Page 41.
Les premiers magistrats se plaignent de la difficulté de trouver des hommes dignes de leur confiance. En effet, le cercle des personnes de leur connaissance, quelque étendu qu’il soit, est toujours fort borné relativement au grand nombre d’emplois dont ils peuvent disposer. Mais, de leur côté, mettent-ils une assez grande importance à l’exercice de cette partie de leurs fonctions ? Et, à le bien prendre, n’en est-ce pas la partie la plus importante ? La plupart des actions, et même des décisions qui émanent d’un homme en place, viennent non pas de lui, mais de ses délégués. Quelque étendu que soit son pouvoir, le magistrat éminent n’a qu’une tête, deux bras, et vingt-quatre heures dans sa journée ; il prend bien les principales décisions, mais les plus nombreuses, celles qui établissent le plus de rapports entre l’administration et les administrés, il les abandonne à d’autres, bien qu’elles soient prises en son nom ; et si l’on rassemble la somme des volontés d’autrui, qui sont censées être l’expression de la sienne, on trouvera que cette somme excède de beaucoup l’influence de sa propre volonté.
Il en résulte que, quelle que soit sa moralité personnelle et son instruction, la moralité et l’instruction de ceux qu’il emploie influent encore plus, non seulement sur le sort de la chose publique, mais aussi sur sa propre sûreté et sur sa propre gloire. Il profite de tout ce qu’ils font de bien, et souffre de tout ce qu’ils font de mal ; et si l’on en a vu quelquefois qui par une stupide jalousie, et pour se réserver plus d’honneur et de pouvoir, se sont entourés de gens médiocres, et ont ôté toute influence aux gens de mérite qu’ils ne déplaçaient pas, on a vu aussi qu’ils ont été constamment les dupes de ce calcul, et qu’ils ont porté le poids des fautes de leurs sous-ordres, et de la haine ou du mépris que ceux-ci inspiraient.
Par toutes sortes de raisons, les choix sont la partie la plus importante des fonctions des chefs d’un État ; et quand ils consacreraient la majeure partie de leur temps et de leurs facultés à en préparer de bons, à prendre désinformations et des notes, à aller à la recherche du mérite obscur, ou bien à découvrir ceux qui ne justifient pas leur confiance, ils ne feraient qu’une chose très raisonnable.
Qu’on juge par là combien sont peu dignes de leurs fonctions les gens qui ne considèrent leurs emplois que comme un moyen d’obliger leurs connaissances ou de se venger de leurs ennemis, ceux qui mettent dans les places tous leurs parents, leurs voisins, les compagnons de leurs plaisirs, et les protégés de leurs gens !
Note (U).
On ne vit plus un troupeau d’imbéciles ébahis à la vue d’une garniture de diamants ou de quelque autre colifichet de cette espèce. Page 43.
Des philosophes ont dit : Comment un homme peut-il se glorifier d’un habit galonné, une femme de ses dentelles, de ses bijoux ? Y a-t-il une seule personne qui puisse confondre ces babioles avec le mérite personnel, seul avantage dont on puisse raisonnablement être glorieux ? Ces philosophes, très estimables dans leur but, n’ont pas vu que ces avantages étaient du même genre que tous ceux dont les hommes se glorifient ; ils sont fiers de tout ce qui augmente leur influence personnelle. Or cette influence se compose de la force et de la beauté du corps (quoiqu’à un faible degré dans les sociétés policées), des talents, des places, de la fortune ; et comme les objets de luxe sont les marques d’une grande fortune, on est fier de porter des galons, des diamants, d’étaler de somptueux équipages, et de donner des repas splendides, de même qu’on est fier de ses emplois ou de ses talents ; plus le pouvoir et les talents sont incontestables, solides, et moins ils ont besoin de ces marques extérieures : aussi les dédaignent-ils souvent ; mais la médiocrité en fait grand cas. C’est dans la nature des choses.
La tâche du législateur moraliste est donc, non de sévir contre l’ostentation, ce qui ne la détruira pas ; mais d’arranger les choses de manière que la richesse, dont le faste est l’enseigne, ait moins de pouvoir qu’elle n’en a ; alors on sera moins tenté d’en faire étalage.
L’entreprise est difficile, mais n’est pas impossible, d’autant qu’il n’est pas nécessaire de détruire totalement le pouvoir de l’argent, mais de l’affaiblir, mais de mettre le désintéressement en honneur. Malè se res habet, cùm quod virtute effici debet, id tentatur pecuniâ. Cicéron
Note (V).
On n’estima plus les gens en proportion de la consommation qu’ils faisaient : qu’arriva-t-il ? Ils ne consommèrent rien au-delà de ce qui était vraiment nécessaire à leur utilité ou à leur agrément. Le luxe, attaqué dans sa base, qui est l’opinion, fit place à une aisance plus généralement répandue. Page 43.
J’ai tâché, dans cette phrase, de donner de justes idées sur le mot luxe, qui n’aurait pas excité tant de discussions s’il eût été mieux entendu. En le restreignant, comme je pense qu’on doit le faire, aux choses qui ne sont pas vraiment nécessaires à l’utilité et à l’agrément de la vie, on n’appellera objets de luxe que ceux qui n’ont qu’une valeur d’opinion. Ainsi quelques meubles d’argent, qui sont plus commodes et s’altèrent moins facilement que ceux d’étain ou de fer, ne seront pas des objets de luxe ; mais un mets dans sa primeur, un mets qui se paiera six cents francs deux mois avant qu’il ne vaille six sous, sera un objet de luxe, parce qu’on ne le sert sur une table que par ostentation, et qu’il n’est pas un plat moins cher qui ne fit autant plaisir.
En blâmant le luxe, je n’aurai donc point la folle prétention de ramener l’homme à un état sauvage, où l’on ne connaît d’ustensiles que les doigts et les dents ; de vêtements, que des peaux d’animaux ; d’habitations, que des cavernes. J’admettrai l’usage de tout ce qui chez des nations industrieuses et riches, concourt au bien-être des citoyens, sans pour cela faire l’apologie des recherches de la sensualité qui sont blâmables sous d’autres rapports. Après avoir ainsi restreint le nombre des choses qui tiennent purement au luxe, je ne crains pas de prononcer que le luxe est funeste aux États, grands ou petits, et que le pays où il y en aura le moins, sera le plus riche et le plus heureux.
Un des principes les plus faux en économie politique, ou plutôt une assertion qui n’est un principe qu’aux yeux de ceux qui n’ont pas les plus simples notions de l’économie politique, est celle qui prétend qu’un homme est utile à l’État en proportion de ce qu’il consomme. À ce compte, répond plaisamment J.-J. Rousseau à une assertion pareille, un Sybarite aurait bien valu trente Lacédémoniens.
Tout pays, par son agriculture, son commerce, donne des produits plus ou moins considérables, mais qui ne sont jamais sans bornes ; on ne saurait consommer dans ce pays que ce que lui rapportent son sol et son industrie ; et s’il s’y trouve des personnes qui y fassent une consommation surabondante des produits du sol ou de l’industrie, ce sera aux dépens d’autres personnes qui éprouveront des privations proportionnées. C’est la raison pourquoi le luxe et la misère marchent toujours ensemble.
Je suppose, pour exemple, que chez un peuple, un certain nombre de personnes s’adonnent, les unes à une profession, les autres à une autre, mais toujours à une profession utile ; ce pays sera abondamment pourvu de choses utiles. Mais voilà que l’envie de briller s’y introduit, et que la mode de galonner les habits se répand parmi les habitants les plus riches. Qu’arrive-t-il ? une portion de chaque classe d’ouvriers, se met à faire des galons : ainsi au lieu de cent mille ouvriers qui fabriquaient de bon drap ou bien du linge, il n’y en a plus que quatre-vingt mille qui suivent cette occupation. Cependant les gens aisés ne veulent pas en avoir une chemise ou un habit de moins ; il faut donc qu’une portion des habitants aille vêtue de guenilles et se passe de chemises. La conséquence est nécessaire. [51]
Vous verrez même que des gens à qui leur fortune donnerait la possibilité d’aller bien vêtus, se passeront de chemise pour porter des galons. Qu’on me permette de placer ici une citation de Franklin, où l’on retrouvera son originalité accoutumée.
« Presque toutes les parties de notre corps, dit-il dans une lettre à Benjamin Vaughan, nous obligent à quelque dépense : nos pieds ont besoin de souliers, nos jambes de bas, etc. Notre estomac exige de la nourriture. Quoique excessivement utiles, nos yeux, quand nous devenons raisonnables, demandent l’assistance peu coûteuse des lunettes ; ce ne sont pas encore eux qui dérangent nos finances ; mais les yeux des autres sont les yeux qui nous ruinent ».
Or ce qui ruine le particulier ruine l’État.
On dit encore : les ouvriers occupés à créer des objets de luxe ne seraient pas employés d’une autre manière. On est dans l’erreur ; il n’y a jamais moins d’oisifs que dans les contrées où les mœurs sont simples, et où par conséquent on produit peu d’objets de luxe. Vous dites que le luxe fait vivre des ouvriers : oui ; mais comment les fait-il vivre ? Avez-vous visité la ville de France que le luxe faisait le plus travailler, Lyon ? Avez-vous vu, dans le temps où l’ouvrage allait le mieux, ces misérables ouvriers, hâves, maigres, déguenillés, entassés dans des maisons à huit étages, pêle-mêle avec leurs femmes, leurs enfants, leurs métiers, leurs parents malades ? Si au lieu de faire des brocards d’or, ils avaient fabriqué de bons draps, ils auraient eu de bons habits. On en peut dire autant du maçon, du charpentier, du cultivateur ; ce n’est que dans un pays où il n’y a pas de luxe, ou très peu, qu’on voit tout le monde bien vêtu, bien logé, bien nourri, et content.
Un gouvernement qui veut enrichir et moraliser une nation, doit donc éviter d’offrir des objets de luxe à la vénération des peuples, et surtout de laisser croire qu’il en a besoin pour être considéré. Un tel gouvernement n’admettra, pour signes de l’autorité, ni les dorures, ni les velours, ni les dentelles, ni les broderies ; les consuls à Rome n’étaient remarquables que par la couleur de leur robe et par les faisceaux qui les précédaient ; et les tribuns, dont le pouvoir était si respecté que les empereurs eux-mêmes furent jaloux, trois siècles durant, de s’en revêtir, n’étaient distingués par aucune marque extérieure.
Qu’on y prenne garde ; qu’on se hâte de réformer dans nos usages ce qui tend à pervertir nos mœurs. Il s’agit, pour nous, d’exister ou de périr ; car une république sans des mœurs républicaines, ne saurait subsister.
Note (X).
Une fois un homme alla leur recommander son bienfaiteur : ils couronnèrent à la fois le bienfaiteur et l’obligé. Page 62.
Je sais fort bien tout ce qu’une pareille institution rencontrerait d’opposition parmi nous. Elle aurait pour ennemis, d’abord les hommes à qui les bonnes mœurs sont indifférentes, et ensuite tous les esprits étroits. Mais ce ne sont pas ces gens-là que doit consulter un gouvernement fortement intentionné pour le bien. Ils sont depuis longtemps en possession d’y mettre des entraves. « Vos idées, dit Saint-Lambert qui les connaissait, seront traitées de chimériques, et vos desseins de romanesques, par les hommes faibles et bornés, qui croient insensé tout ce qu’ils ne peuvent comprendre, et impossible tout ce qu’ils ne peuvent faire ». C’est parce que les personnes de cette espèce sont extrêmement nombreuses, qu’il faut en général plus de constance et de courage qu’on ne croit pour opérer le bien. Il n’est pas un abus qui ne trouve un défenseur ; il n’est pas une amélioration qu’il ne faille emporter à la pointe de l’épée. Sapere audete.
Note (Y).
Ce n’étaient point les Olbiens, c’étaient les Chinois qui avaient deviné l’usage qu’on peut faire de tels livres. Page 63.
« On ne néglige, en Chine, aucun moyen pour exciter à faire de bonnes actions et empêcher qu’on n’en fasse de mauvaises ; et l’on emploie également l’espoir de la louange et la crainte du blâme. Il y a un registre public, nommé le Livre du mérite, dans lequel on inscrit tous les exemples frappants d’une conduite estimable ; et dans les titres d’un homme, on mentionne particulièrement le nombre de fois que son nom a été inséré dans ce livre. D’un autre côté, celui qui commet des fautes est dégradé ; et il ne suffit pas qu’il se borne à ne porter que son titre réduit, il faut encore qu’il joigne à son nom le fait pour lequel il a été dégradé ». Voyage de Macartney, tome iv, page 158.
Macartney parle ailleurs d’un tribunal de censeurs, qui a pour objet la conservation de la morale publique et privée. Les Européens l’appellent le Tribunal des cérémonies, parce qu’en effet il les règle d’après ce principe unanimement reçu parmi ce peuple, que les formes extérieures, suivies scrupuleusement et sans relâche, maîtrisent toujours les opinions et les habitudes. L’esprit de suite est le caractère distinctif des Chinois ; et il faudrait souvent proposer leur exemple à une nation chez qui les meilleurs règlements tombent en désuétude au bout de trois mois, et où les lois même sont une affaire de mode.
Note (Z).
Ils firent grand cas des jeux de la scène. Page 66.
Les fêtes et les spectacles ont encore ce bon effet, qu’ils détachent l’esprit de la superstition et du fanatisme, lesquels se propagent principalement lorsque la couleur de l’esprit général est sombre et mélancolique, [52]et lorsque le peuple ne sait que faire de son loisir. Aussi nous n’avons jamais vu les temps où les divertissements, et surtout les jeux scéniques, ont été communs, signalés par les fureurs du fanatisme. Les excès de ce genre, si multipliés dans l’histoire moderne, remontent, pour chaque nation, à l’époque où elle n’avait encore que peu de spectacles, et des spectacles grossiers et imparfaits. Plus les plaisirs innocents sont faciles, moins on est disposé à se haïr, à se déchirer mutuellement.
Note (Aa).
Qu’on trouve dans vos fêtes, non ce que vous voulez qu’il y ait, mais ce qu’on désire d’y trouver. Page 69.
Si l’on veut absolument, dans les grandes villes, donner des spectacles au peuple, au moins qu’on s’empare de son attention par des actions allégoriques sensibles, frappantes, et surtout claires pour tout le monde. Pour que ces allégories soient bien comprises, que des programmes imprimés décrivent toutes les parties de l’action, et que des signaux désignés d’avance, et habilement exécutés, en marquent les différentes périodes. Pour qu’une fête publique intéresse comme spectacle, il faut que le sujet soit en rapport direct avec les affections, avec le sort des assistants.
Il faut encore que les accessoires concourent à augmenter l’effet de ces grandes représentations ; qu’on déploie, par exemple, beaucoup d’ordre et beaucoup d’habileté dans leur exécution ; que le local soit commode, et que rien n’y contrarie, n’y détruise les impressions de plaisir qu’on doit y recevoir ; qu’on n’y soit point exposé à de funestes accidents, et que le tranquille piéton puisse s’y rendre sans redouter d’être foulé par les pieds des chevaux, ou broyé sous les roues des carrosses ; que la police y soit faite par de solides barrières, et non par des sentinelles, qui toujours éteignent l’enthousiasme et mettent le plaisir en déroute. Les spectateurs croient avec satisfaction à leur propre dignité, en la voyant respectée par les autres.
Pour que l’homme soit vertueux, il faut qu’il se respecte, qu’il ait une haute idée de la dignité de son être : on doit donc éviter soigneusement tout ce qui peut tendre à rabaisser le peuple à ses propres yeux, de peur qu’il ne se mette, par sa conduite, au niveau du peu de cas qu’on fait de lui. Une soldatesque insolente, des dignitaires qui affectent des airs de hauteur, ou qui exigent des respects humiliants, portent par cette raison des atteintes à la morale.
Note (Bb).
Quel avantage valut aux Romains la conquête des Gaules, si ce n’est la tyrannie de César ? Page 72.
On connaît ce mot judicieux et spirituel d’une femme : Don-nez-nous la monnaie des grandes actions. Mais quelques hommes privilégiés sont appelés à donner en même temps les grandes actions et leur monnaie. On doit leur en savoir d’autant plus de gré, que jusqu’à présent les peuples ont eu la sottise d’attacher moins de gloire aux actions utiles qu’aux actions brillantes ; mais les peuples s’éclairent : il se prépare un siècle où les choses n’iront pas tout à fait ainsi. Les noms de pacificateur, de créateur de la prospérité publique, ne seront pas entourés de moins d’éclat que celui de conquérant ; et tout nous annonce qu’il est réservé à la France de distribuer à la fois ces deux sortes de gloire.
————————————
[1] Cf. « La fin de l’obscurantisme. La liberté de la presse selon Jean-Baptiste Say », Laissons Faire, numéro 7, décembre 2013, pp.21-24
[2] Albert Thibaudet, Histoire de la littérature française, Paris, 1981, p.67
[3] J.-B. Say à son frère Louis, 1827, cité dans Œuvres diverses de Jean-Baptiste Say, Paris, Guillaumin, p.545
[4] Infra, p.31
[5] Ibid.
[6] Infra, p.33
[7] Infra, p.34
[8] Infra, p.33
[9] La Henriade
[10] Infra, p.35
[11] Infra, p.36
[12] Ibid.
[13] Infra, p.91
[14] John Stuart Mill, De l’asservissement des femmes, 1869 ; Paul Leroy-Beaulieu, Le travail des femmes au XIXe siècle, 1873 ; Yves Guyot, La Prostitution, 1882
[15] Infra, p.49
[16] Infra, p.84
[17] Infra, p.89
[18] Infra, p.60
[19] Celle de Marc-Antoine Eidous dès 1764 (sous le titre de Métaphysique de l’âme), celle de Jean-Louis Blavet, en 1774, ou celle, notoirement meilleure, de Sophie de Grouchy, en 1798. (cf. mon article « “Trahi plutôt que traduit”. Lire Adam Smith en Français, 1750-1800 », Laissons Faire, Août 2013, pp. 13-18
[20] Infra, p.87
[21] Infra, p.105
[22] 1797
[23] Si quelqu’un pouvait douter du pouvoir de l’éducation, qu’il lise l’Histoire de Sparte. Je ne dis pas qu’on doive imiter les institutions de Lycurgue ; je dis seulement que les hommes sont ce qu’on les fait, sans partager cependant l’opinion d’Helvétius, qui croit que leurs facultés sont pareilles en sortant des mains de la nature.
[24] Quiconque ferait un Traité élémentaire d’Économie politique, propre à être enseigné dans les écoles publiques, et à être entendu par les fonctionnaires publics les plus subalternes, par les gens de la campagne et par les artisans, serait le bienfaiteur de son pays.
[25] On a fait de mauvais républicains chaque fois qu’on a voulu rendre les hommes tels, le pistolet sur la gorge. On a conquis l’apparence, tout au plus. Il en serait de même de la vertu : la violence ne peut que lui ôter de ses grâces et de ses attraits. La sotte pruderie que tout le monde fut forcé d’affecter dans les dernières années de Louis XIV, produisit les dérèglements de la régence.
[26] Xénophon, République de Sparte
[27] Si l’on me reproche d’appeler braves des hommes qui ne pouvaient se conduire autrement, je répondrai que je les appelle braves, parce qu’ils ne purent supporter la honte. C’est-là le fondement de toute espèce de bravoure ; et si Lycurgue a rendu ses Lacédémoniens les plus braves des hommes, c’est parce qu’il a su établir une honte impossible à surmonter.
[28] Gouv. de Pologne
[29] Je sais que les habitants des États-Unis n’ont point évité d’autres écueils, comme j’en ferai bientôt la remarque ; mais ils n’offrent pas moins un exemple de ce que peut l’intérêt personnel, dirigé vers le bien. Les scélérats que l’Angleterre transporte à la baie de Botanique, y deviennent tous d’honnêtes gens.
[30] Ils y sont plus intéressés que personne ; car jamais on n’a vu une révolution dans les institutions politiques, se consolider, à moins qu’il ne se soit fait en même temps une révolution dans les habitudes morales. Il est vrai que la première rend la seconde facile ; pour réformer les mœurs d’un peuple, c’est une belle institution que la République (F).
[31] En regardant comme une condition première pour opérer la réforme des mœurs, une volonté forte, j’assignerais presque pour condition seconde que cette volonté ne soit ni dure, ni intolérante. La volonté forte permet d’employer tous les moyens de réussir, même la patience et la longanimité ; tandis que la volonté intolérante réussit quelquefois à faire ployer les obstacles, mais ne les détruit jamais.
[32] Il faut tâcher que, pour vivre, on ne soit pas plus forcé de prostituer ses talents que sa personne. S’il est affligeant de voir la courtisane vendre au premier venu des faveurs qui auraient pu devenir la récompense des plus tendres sentiments, il n’est pas moins affligeant de voir l’homme de lettres vendre son approbation au vice puissant, et le peintre prêter la magie de ses couleurs aux obscènes conceptions d’un riche méprisé.
[33] Si les Anglais supportent mieux que nous le fardeau d’une guerre destructive, c’est qu’ils sont plus avancés en économie politique ; et à plusieurs époques, avant et depuis la Révolution, la France a perdu des ressources immenses, parce que ses gouvernants ignoraient jusqu’aux éléments de cette science.
[34] L’ouvrier qui se flatte de l’espoir de gagner 30 ou 40 mille francs dans quelques minutes, travaille de mauvaise grâce pour gagner 30 ou 40 sols par jour ; et néanmoins ce dernier travail est le seul productif, le seul qui contribue à enrichir l’État.
[35] Il ne faut pas perdre de vue que cet ouvrage a été écrit en l’an VII. La constitution de l’an VIII prévient une partie de ces inconvénients.
[36] J’avoue qu’un gouvernement ne peut user de ce moyen, que lorsque l’économie et l’ordre dans les finances le mettent en état de ne jamais recourir aux secours des gens à argent ; secours plus ruineux encore pour les mœurs publiques que pour le trésor public.
[37] Ils ne sont ni femmes ni hommes ces êtres en jupons, à l’œil hardi, à la voix rauque, qui, parmi la populace de nos villes, tiennent tête aux hommes, soit l’in-jure à la bouche, soit le verre à la main. C’est un troisième sexe.
[38] Rep. liv. II, pag. 9.
[39] Les éphores joignaient à leur influence civile un pouvoir politique très étendu, puisqu’ils convoquaient les assemblées du peuple, recevaient les ambassadeurs, etc. Les censeurs, à Rome, pouvaient faire passer un citoyen d’une tribu dans une autre, le surcharger de contributions, etc.
[40] Pourquoi, chez les modernes, néglige-t-on ces formules qui, pareilles à des étendards, rallient les opinions d’un peuple, et servent, au besoin, à mettre en évidence la contradiction des principes avec les actions ?
[41] Voilà en partie pourquoi l’homme ignorant, qui n’est qu’un grand enfant, fait plus de mal que de bien.
[42] Pour cela, il faut encore de l’aisance, et toujours de l’aisance ; de sorte qu’en définitif, il est inutile de travailler en morale avant d’avoir travaillé en économie politique : autrement, on ne fera que de beaux discours, on déploiera de beaux spectacles, à la suite desquels le peuple restera aussi vicieux qu’auparavant, parce qu’il ne sera pas moins misérable.
[43] Ces monuments ne font point le même effet dans les muséum, où ils ne sont visités que par des curieux, ni dans les palais, où le peuple ne pénètre jamais ; tandis que, lorsqu’ils se rencontrent sous les pas des promeneurs, des voyageurs, on est forcé de s’en occuper, on en cause : chaque jour ils réveillent des idées dans l’esprit de plusieurs milliers de personnes ; l’instruction se propage en même temps que les mœurs profitent.
[44] Tableau historique des progrès de l’Esprit humain, par Condorcet
[45] On voit, dans Crevecœur, que les gens du Connecticut observent si scrupuleusement le jour du repos, qu’ils ne brassent pas leur bière le samedi, de peur qu’elle ne travaille le dimanche.
[46] Joseph, liv. xiv, chap. 8.
[47] La raison en est simple : le soin principal de chaque secte est et doit être de se conserver ; aucun individu, aucun corps n’a jamais placé le soin de sa conservation en seconde ligne.
On voit dans saint Cyprien que de son temps (et c’était le beau temps de l’église chrétienne) les disciples du Christ étaient beaucoup plus loués par les chefs de leur secte pour leur foi et leur attachement aux dogmes, que pour la moralité de leurs actions : l’hérésie, l’apostasie attiraient toutes les foudres de l’église ; la violation des simples règles de la morale, n’exposait qu’à des réprimandes, à des exhortations. Ce système s’est perpétué jusqu’au milieu du dix-huitième siècle, où l’on a commencé à négliger le dogme en faveur de la morale ; mais cette négligence même était une atteinte portée à la religion.
[48] Aurel. Victor, dans la vie de Probus
[49] Richesse des Nations
[50] Smith, Richesse des Nations, tome III, page 378 de l’édition anglaise.
[51] Dans ce cas, le nombre de bras employés aux manufactures de toiles et de draps diminuant, le prix de la main-d’œuvre hausse. Les produits en sont par conséquent plus chers. Les citoyens les plus pauvres se privent d’une partie de ces produits. Au lieu de renouveler leur habit, ils l’usent jusqu’à la corde, ils le raccommodent, et l’on ne rencontre plus l’artisan vêtu d’un bon habit. Telle est la marche que suivent les choses dans le cas suppose.
[52] Les fondateurs de toutes les religions, et leurs successeurs, ont, par cette raison, en horreur toute sorte de spectacle.


Laisser un commentaire