Dans une série d’articles donnés en France et en Belgique en 1849 et 1850, Gustave de Molinari s’emploie à recommander le fonctionnement libre des théâtres dans un environnement concurrentiel, pour remplacer les monopoles, les privilèges et les subventions qui, malgré de bonnes intentions, ne parviennent qu’à multiplier les abus et éloigner les spectateurs. Il traque une à une les raisons des réglementaristes et en prouve la fausseté, en s’appuyant tant sur les conclusions de l’économie politique que sur les leçons de l’histoire économique des théâtres en France.
Dans le deuxième article, Molinari expose les fondements de sa défense de la liberté des théâtres, contre le pseudo-libéralisme des réformateurs de son temps, qui ne savent proposer que la liberté surveillée et réglementée. Contre les objections courantes, il fournit les justifications de la liberté totale. B.M.
La liberté des théâtres
par Gustave de Molinari
(recueil d’articles, 1849-1850)
Sommaire.
III. — L’enquête sur les théâtres.
IV. — Les subventions des théâtres en Belgique. — À propos de l’incendie du Théâtre de la Monnaie.
LA LIBERTÉ DES THÉÂTRES.
II.
Comment la liberté des théâtres doit être entendue. — Comment l’entend la bureaucratie.
— Histoire économique du Théâtre Français. [1]
La question des théâtres a marché. Deux projets de loi ont été soumis au conseil d’État. Le premier concerne les théâtres en général. Le second est relatif à l’organisation spéciale du Théâtre-Français.
Ces deux projets ne sont pas définitifs. Ce sont de simples ébauches esquissées dans les bureaux ; mais quelles ébauches ! On consent bien sans doute, de guerre lasse, à accorder la liberté aux théâtres ; mais c’est la liberté comme on l’entend dans les bureaux, la liberté réglementée, inspectée, censurée, vexée ; la liberté qui ne peut faire un seul pas sans avoir à ses trousses une nuée de commissaires, d’inspecteurs, de censeurs et de bureaucrates ; bref, la liberté pour la forme, mais la servitude pour le fond.
On en jugera tout à l’heure.
Mais d’abord, disons de quelle façon nous entendons la liberté des théâtres, nous qui ne sommes pas des bureaux.
L’industrie des théâtres est-elle, comme on l’affirme, une industrie exceptionnelle ? Est-il vrai que le gouvernement soit tenu de s’en occuper plus spécialement qu’il ne s’occupe de l’industrie des bottiers, des tailleurs d’habits ou des fabricants de bonnets de coton ? Nous ne le pensons pas, et voici nos réponses aux objections diverses des partisans de l’exception.
Première objection. Il est nécessaire que le gouvernement intervienne pour ce qui concerne l’emplacement et la construction des salles, qu’il impose des obligations et des précautions spéciales aux propriétaires et aux architectes, car l’industrie des théâtres est essentiellement dangereuse. Rien n’est prompt à brûler comme une salle de spectacle.
R. Les enquêtes municipales de commodo et incommodo et les assurances ne suffisent-elles pas ? Si les habitants d’un quartier redoutent le voisinage d’un théâtre, ils peuvent s’opposer à son établissement. Quant aux moyens de prévenir les incendies, les compagnies d’assurances en savent plus long là-dessus que les architectes officiels, et elles ont soin de veiller à ce que les précautions qu’elles imposent soient observées. D’ailleurs, l’intervention du gouvernement empêche-t-elle aujourd’hui les salles de brûler ?
Deuxième objection. Il faut que le gouvernement intervienne dans l’intérêt des spectateurs, pour faire aérer les salles, distribuer convenablement les places, donner l’étendue nécessaire aux dégagements, etc.
R. Aucune de nos salles privilégiées ne possède un ventilateur ; on y est généralement fort mal assis. Les couloirs de dégagement sont étroits, obscurs et infects ; presque partout, le public (du moins le public qui paye) est obligé de faire queue en plein air.
Sous un régime de libre concurrence (non réglementée), les entrepreneurs de spectacles seraient obligés de se préoccuper spécialement du confort des spectateurs ; car, sous ce régime, le public ne se ferait point faute d’abandonner les salles incommodes pour celles où on lui donnerait ses aises. Ne l’avons-nous pas vu déserter déjà, grâce à la concurrence, les vieux cabarets borgnes où s’entassaient nos pères, pour les cafés-renaissance, luxueusement peints à fresque, garnis de divans moelleux, et éclairés à giorno ?
Troisième objection. Une entreprise dramatique peut compromettre de nombreux intérêts si elle est mal conduite. Le gouvernement n’est-il pas tenu d’exiger un cautionnement du directeur, dans l’intérêt des artistes dramatiques, des décorateurs, des machinistes, des allumeurs de gaz et des ouvreuses de loges ?
R. Comment se fait-il que le gouvernement n’exige aucun cautionnement du manufacturier qui occupe des centaines ou des milliers d’ouvriers, dont sa faillite peut compromettre ou ruiner l’existence ? Pourquoi un cautionnement en faveur des ouvriers des théâtres, et pas de cautionnement en faveur des ouvriers des fabriques de coton, de lin, de laine, des usines métallurgiques, des exploitations agricoles et autres ?
Quatrième objection. Le gouvernement doit intervenir pour empêcher les théâtres de troubler matériellement et moralement l’ordre. Il ne saurait se dispenser de leur imposer des officiers de paix, des sergents de ville et des censeurs.
R. S’agit-il de l’ordre matériel ? Le premier intéressé au maintien du bon ordre dans un théâtre, c’est le directeur lui-même ; car le public ne fréquente pas volontiers des salles où l’on est exposé à recevoir des horions. Pourquoi donc ne pas laisser au directeur le soin de pourvoir au maintien de l’ordre ? Pourquoi lui imposer un nombre déterminé d’agents de la force publique ? N’est-ce pas comme si on lui imposait un nombre déterminé d’acteurs, de musiciens, de machinistes et d’allumeurs de gaz ?
S’agit-il de l’ordre moral ? De ce qu’on peut porter atteinte à la considération des citoyens et des familles, outrager la morale publique, insulter le gouvernement établi, dans une représentation dramatique, s’ensuit-il que la censure soit indispensable ?
Mais il y a une industrie qui est, sous ce rapport, infiniment plus dangereuse que celle des théâtres, c’est l’industrie de la presse. On affirmait aussi autrefois qu’aucune société ne pourrait subsister avec la liberté de la presse. Comment, disait-on, empêcher les journalistes de déverser l’injure et l’infamie sur les hommes et les choses les plus respectables ? Comment protéger les citoyens contre leurs insultes et mettre le gouvernement à l’abri de leurs appels à l’insurrection ? Comment maintenir l’ordre social sans la censure ?
Cependant la censure a été abolie, et, à l’exception de quelques esprits malades, personne ne songe aujourd’hui à la rétablir. Tout le monde convient que des lois répressives sagement mesurées et judicieusement appliquées suffisent pour contenir dans de justes limites la liberté de la presse.
Pourquoi donc les lois répressives ne suffiraient-elles pas, de même, pour contenir et régler la liberté des théâtres ?
Que si, par exemple, des auteurs dramatiques s’avisaient de mettre en scène moi ou les miens, pourquoi ne les contraindrait-on pas à me payer des dommages-intérêts pour compenser le tort qu’ils m’auraient causé ? Croit-on qu’ils s’y feraient prendre deux fois ? Que s’il me convenait, au contraire, d’aller voir ma charge dans un théâtre, comme il peut me convenir de la voir dans le Charivari ou dans la Silhouette, pourquoi me refuserait-on cette satisfaction innocente ? Pourquoi défendrait-on aux auteurs dramatiques de mettre en scène des hommes vivants, s’il plaisait à ceux-ci de jouir de cette réclame ?
Que si la morale publique était outragée sur la scène, pourquoi ne donnerait-on pas au spectateur, dont les yeux ou les oreilles auraient été offensés, le droit de traduire auteurs, directeurs et acteurs devant les tribunaux ? Pourquoi n’aurait-on pas envoyé, par exemple, la Suzanne du Vaudeville devant la police correctionnelle, comme s’étant baignée en un lieu prohibé ? À quoi bon la censure ?
Que si enfin on mettait en scène des Premiers-Paris incendiaires, pourquoi le gouvernement ne serait-il pas autorisé à intenter des procès de presse aux journalistes des théâtres ? Ici encore la répression ne suffirait-elle pas ?
Nous n’ignorons pas qu’il est bien plus commode de censurer une pièce ou de la suspendre que de réprimer les abus de la liberté théâtrale. Mais autrefois il était plus commode aussi de censurer les journaux, qu’il ne l’est aujourd’hui de poursuivre et de punir les délits de la presse. Les gouvernements sont-ils institués pour la commodité des gouvernants ou pour celle des gouvernés ?
Nous concluons donc que le gouvernement ne doit pas plus s’occuper des théâtres qu’il ne s’occupe des autres établissements industriels ; qu’il doit se borner uniquement à fournir, au prix le plus bas possible, des sergents de ville et des municipaux aux directeurs qui lui en font la demande, et veiller à ce que les auteurs dramatiques, en usant de leur liberté, ne portent aucune atteinte à la liberté d’autrui.
Voilà comment nous comprenons la liberté des théâtres.
Mais, avons-nous besoin d’ajouter que cette manière de voir n’est pas du tout celle des bureaux ?
D’après le premier projet de loi, que nous avons mentionné plus haut, pleine liberté est accordée aux exploitations théâtrales :
Mais nul ne pourra élever un théâtre sans avoir fait préalablement sa déclaration à l’autorité locale, et s’être conformé aux règlements relatifs à la construction et à l’aménagement des salles.
Mais, à Paris, toute salle de spectacle devra contenir au moins huit cents personnes.
Mais les troupes ambulantes de comédiens devront être autorisées par le ministre de l’intérieur, qui désignera la circonscription dans laquelle ils pourront jouer.
Mais les spectacles dits de curiosités, permanents ou périodiques, et les entreprises de concerts ne pourront être établis qu’avec l’autorisation du ministre de l’intérieur à Paris, et de l’autorité municipale dans les autres communes de France.
Mais les théâtres d’enfants ou d’élèves seront interdits.
Mais aucune pièce de théâtre ne pourra être représentée sans l’autorisation préalable du ministre de l’intérieur à Paris et des préfets dans les départements, et cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d’ordre public.
Mais des commissaires-inspecteurs nommés par le ministre seront institués auprès des théâtres, et les entrepreneurs seront tenus de communiquer auxdits commissaires-inspecteurs les manuscrits des ouvrages qu’ils voudront faire représenter.
Mais les subventions actuellement accordées à certains théâtres seront intégralement maintenues.
Voilà la liberté, comme on la comprend dans les bureaux.
Nous nous bornerons pour le moment à adresser quelques brèves observations aux promoteurs de cette liberté à la Figaro. Nous leur demanderons :
Pourquoi le gouvernement exigerait que toute salle de spectacle à Paris contînt au moins huit cents places. Ne serait-ce pas absolument comme s’il exigeait que tout journal eût au moins la dimension du Journal des Débats ou du Constitutionnel ?
Pourquoi le gouvernement imposerait aux concerts et aux spectacles de curiosités le régime du privilège ? En quoi la liberté des concerts est-elle plus anarchique que la liberté des théâtres ?
Pourquoi le gouvernement continuerait à organiser les troupes ambulantes qui exploitent les deux tiers de la France, alors qu’on a solennellement repoussé l’organisation du travail par l’État ?
Pourquoi le gouvernement appliquerait aux théâtres la loi qui régit le travail des enfants dans les manufactures, tandis qu’il ne s’occupe ni des jeunes danseurs de corde, ni des petits chanteurs des rues, racleurs de violon, joueuses de vielle ou de guitare, ni des conducteurs de singes, ni des montreurs de marmottes en vie.
Eh ! houp la Catarina !
Ne voilà-t-il pas un article de loi bien incomplet ?
Pourquoi le gouvernement instituerait des commissaires-inspecteurs des théâtres, alors que la révolution a fait justice des conseillers langueyeurs de porcs, inspecteurs aux empilements de bois et autres sangsues de l’industrie ?
Pourquoi enfin le gouvernement maintiendrait l’inique et détestable abus des subventions, en présence d’une Constitution qui proclame l’égalité devant la loi ?….
Mais ceci nous conduit à examiner le deuxième projet de loi.
Dans la presse dramatique, la liberté des théâtres est assez populaire, bien que certains journalistes spéciaux ne la comprennent guère mieux qu’on ne la comprend dans les bureaux. Mais ne vous avisez pas de proposer à ces libéraux la suppression des subventions ! Les plus tolérants vous traiteront de cœurs impitoyables, d’économistes sans entrailles, et ils vous signaleront à la vengeance « des pauvres artistes que vous voulez priver de leur pain » ; les autres n’hésiteront pas à vous accuser d’être stipendié par les puissances étrangères pour détruire l’art français. Or, ajoutent ces dignes conservateurs, que deviendrait Paris sans l’art ? Ne verrait-on pas les étrangers fuir cette capitale ravagée par les disciples d’Adam Smith et de J.-B. Say, et aller porter leur or dans des contrées où l’économie politique n’aurait pas encore exercé ses déprédations ? Privé de ses étrangers, au profit de Vienne, de Berlin, de Milan, voire même de Bruxelles, ô honte ! Paris verrait sonner l’heure fatale de sa déchéance. La banlieue subirait le contrecoup de la ruine de la capitale, et les départements verraient se répercuter chez eux les désastres de la banlieue. Et toutes ces ruines, on les aurait amoncelées pour avoir voulu économiser deux misérables millions. Ô les abominables économistes ! ô les iconoclastes, qui voudraient ruiner l’Art. L’Art se vengerait d’eux en ruinant la France !
Tel est le langage des conservateurs de l’art, lorsqu’on s’avise de toucher à l’arche sainte des subventions. Ce qu’il y a de plus piquant dans ces protestations faites au nom de l’art, c’est qu’elles émanent d’hommes qui protestaient naguère contre les vieilles traditions dramatiques dont les subventions assurent le maintien. Ces socialistes de l’art, qui répudiaient brutalement les traditions du passé, ces romantiques qui allaient jusqu’à traiter Racine de polisson, affirment aujourd’hui que tout serait perdu si l’on cessait de jouer les pièces de ce polisson et de ses pareils. Voilà leur logique romantique !
Mais qu’ils se rassurent ! La suppression des subventions n’aurait aucun des lamentables résultats dont ils s’effrayent. L’Opéra, l’Opéra-Comique, le Théâtre-Français, l’Odéon même pourraient parfaitement subsister sans subventions. Nous dirons plus : bien loin de contribuer à leur prospérité, les subventions leur sont nuisibles.
Tout n’est pas bénéfice, en effet, sous ce régime. On reçoit d’une main, mais on est obligé de rendre de l’autre. Une bonne partie de la subvention, si péniblement arrachée aux contribuables, est restituée aux personnages de l’administration haute et basse, sous forme d’entrées de faveur et de billets gratuits. M. Vivien évalue à plus d’un million le montant annuel des entrées gratuites dans les théâtres de Paris. Les théâtres subventionnés entrent naturellement pour une large part dans ce chiffre. À l’Opéra notamment, le nombre des entrées gratuites est presque aussi considérable que celui des places.
Voilà donc une première déduction à faire sur les subventions.
Il y en a une seconde, beaucoup plus importante encore, nous voulons parler de celle qui résulte des abus et de la mauvaise administration que les subventions engendrent. On a vu, on voit tous les jours, des directeurs céder leur privilège, après avoir palpé la subvention, et aller consommer paisiblement :
Loin du tumulte des cités,
les faveurs du budget. Ceci apparemment dans l’intérêt de l’art. Quant aux directeurs qui fonctionnent, ils passent leur vie à défendre contre d’avides compétiteurs une position enviée, et, le plus souvent, chèrement achetée. Aussi les entreprises subventionnées sont-elles d’ordinaire fort mal administrées. On aurait peine à compter le nombre de leurs déconfitures. À ce point de vue, l’histoire de l’Opéra, de l’Opéra-Comique et de l’Odéon est curieuse et instructive.
Mais c’est surtout l’histoire du Théâtre-Français qu’il faut consulter, lorsqu’on veut être édifié sur le mérite des subventions.
La subvention du Théâtre-Français date du règne de Louis XIV. Le grand roi accorda une pension de 12 000 livres sur sa cassette à la Comédie-Française. C’est avec ce maigre secours que la Comédie subsista pendant près d’un siècle et demi. Les comédiens s’étaient constitués en société en 1680, sept ans après la mort de Molière, qui était le directeur de la troupe. Les traités d’association datent de 1682 et de 1705 ; enfin, le 18 juin 1757, un édit royal réglementa la société, fixa le chiffre des pensions, etc., etc.
En 1793, la société du Théâtre-Français fut dissoute. Un directeur se chargea alors d’exploiter l’Odéon et la Comédie-Française, mais il succomba dans cette entreprise beaucoup trop vaste. En l’an IX, une société nouvelle se constitua. Napoléon accorda aux sociétaires une dotation de 100 000 livres de rentes, inscrites au grand-livre. Avec 12 000 livres de rentes, Louis XIV avait eu des chefs-d’œuvre ; à plus forte raison, Napoléon en devait-il avoir avec 100 000. Mais on put se convaincre alors que le fumier des subventions ne suffit pas toujours pour faire éclore le génie. Louis XIV avait eu Corneille, Racine et Molière. Napoléon n’eut, quoi qu’il fit, que des Baour, des Roger et des Écouchard-Lebrun. S’apercevant que ses inscriptions de rentes ne suffisaient pas pour faire fleurir l’art, il imagina de réglementer plus étroitement que jamais la Comédie-Française. C’était en 1812, à Moscou. Comme s’il n’avait eu rien de mieux à faire, le chef de l’expédition de Russie compulsa l’édit de 1757, le modifia à sa guise, puis l’expédia, sous forme de décret, à ses comédiens ordinaires. Superbement datée de Moscou, cette charte régit encore la Comédie-Française.
En vertu du décret de Moscou, la société du Théâtre-Français fut placée sous la surveillance et la direction du surintendant des spectacles. Un commissaire impérial était chargé de transmettre aux comédiens les ordres du surintendant. Ce commissaire impérial avait aussi pour mission de surveiller toutes les parties de l’administration et de la comptabilité. L’administration était placée entre les mains d’un comité de six sociétaires, nommés par le surintendant et toujours révocables. Le commissaire impérial était chargé de présider le comité d’administration. L’assemblée générale des sociétaires devait être convoquée au moins une fois par an pour l’examen du budget, ainsi que pour les cas extraordinaires ou imprévus.
Le produit des recettes, tous les frais et dépenses prélevés, était divisé en vingt-quatre parts. Une de ces parts devait être mise en réserve pour servir aux besoins imprévus. Une demi-part devait servir à augmenter le fonds des pensions, et une autre demi-part être employée aux décorations, costumes, réparations de la salle, etc. Les vingt-deux parts restantes étaient acquises aux comédiens-sociétaires, et devaient être réparties entre eux, depuis un huitième de part jusqu’au maximum d’une part entière. Les cent mille livres de rentes accordées au Théâtre-Français étaient spécialement affectées au service des pensions. La société était tenue, en outre, de concourir à ce service pour une somme de 50 000 francs, prise sur ses fonds particuliers. Tout sociétaire, se retirant après vingt ans de service, avait droit à une pension de 4 000 francs.
Telles étaient les dispositions principales du décret de Moscou. Le gouvernement allouait 100 000 francs de subsides au Théâtre-Français ; mais, en échange de cette faveur, il s’attribuait le droit de composer l’administration à sa guise et de gouverner le théâtre conjointement avec les sociétaires. Ceux-ci, qu’on le remarque bien, étaient tenus de faire face à tous les frais de l’entreprise, car le gouvernement ne s’engageait envers eux que pour le payement du subside. Ils devaient solder, avec leurs recettes et leur subside, toutes les dépenses de l’année, puis se partager les bénéfices ou supporter les pertes.
C’était, en résumé, une association de tous points semblable à ces associations d’ouvriers qui se sont formées depuis Février sous le patronage et avec les subsides du gouvernement. Comme les travailleurs de ces associations, les sociétaires du Théâtre-Français dirigeaient leur entreprise avec le concours et sous la surveillance du gouvernement ; comme eux, ils recevaient une subvention annuelle ; comme eux enfin, ils étaient tenus de se contenter des bénéfices éventuels de leur entreprise.
Malheureusement, il n’est pas donné à ces sortes d’associations de prospérer. L’association subventionnée des ouvriers du Théâtre-Français ne tarda guère à se trouver en déficit. Peu disposés à combler eux-mêmes ce déficit, les sociétaires sollicitèrent et obtinrent un supplément de subsides. Aux 100 000 francs de rentes dont les avait gratifiés Napoléon (sur la cassette des contribuables), les chambres de la Restauration ajoutèrent une subvention de 200 000 francs (toujours sur la même cassette). Le gouvernement de Juillet porta cette subvention à 300 000 francs.
Il y eut mieux. Mal satisfaits de n’avoir qu’une part éventuelle dans les produits de l’entreprise, les sociétaires obtinrent que les parts stipulées par le décret de Moscou seraient estimées à 12 000 fr., et touchées par eux, quel que fût le produit de l’année, sur le montant de la subvention. Ils s’allouèrent, en outre, une somme de 10 fr. de feux, chaque fois qu’il leur convenait de jouer, et ils cessèrent d’avoir égard à l’article du décret de Moscou, qui défendait à tout sociétaire de s’attribuer plus d’une part.
Faisons maintenant une simple hypothèse. Supposons que le gouvernement augmentât successivement, jusqu’à les quadrupler, les subventions allouées aux associations ouvrières, et qu’il permît aux associés de s’attribuer un salaire fixe sur la subvention, au lieu d’une part éventuelle dans les bénéfices, qu’arriverait-il ? Il arriverait inévitablement que ces bienheureux associés ne se donneraient plus la moindre peine pour faire prospérer leurs entreprises, qu’ils ne se préoccuperaient plus que du soin de vivre grassement aux dépens du budget, et que leurs associations, nonobstant l’augmentation des subsides, ne tarderaient pas à être criblées de dettes.
Mais que dirait-on si le gouvernement, lassé à la fin de payer ces subventions et de combler ces déficits sans cesse croissants, s’avisait d’exploiter pour son propre compte les industries des associations et de transformer les associés en fonctionnaires publics ?
On crierait, avec raison, au socialisme. M. Louis Blanc applaudirait des deux mains, et M. Proudhon rirait dans sa barbe.
Telle est cependant la solution qu’on a imaginée dans les bureaux, pour mettre fin aux embarras et aux déficits de l’association ouvrière du Théâtre-Français.
À l’avenir, le Théâtre-Français sera dirigé par un administrateur nommé par le ministre de l’intérieur. Les sociétaires passeront à l’état d’employés salariés par le budget. Ils recevront un traitement qui ne pourra dépasser 12 000 francs par an, plus 10 francs de feux par représentation. En revanche, ils n’auront plus aucune part dans les bénéfices. Le gouvernement se chargera de toutes les dépenses d’administration et d’exploitation, etc., etc.
Ainsi, donc, voilà un théâtre qui se trouve réduit à une extrémité telle, qu’on est obligé de le mettre en régie, c’est à dire de charger l’État du fardeau de ses déficits et de ses dettes, pour le sauver.
Voilà où conduit le régime des subventions !
Nous croyons toutefois, n’en déplaise aux socialistes des bureaux, qu’il y aurait une autre manière d’en finir avec les abus du régime actuel de la Comédie-Française. Ce serait :
1° De lui refuser désormais toute subvention ;
2° De ne plus se mêler de ses affaires. De la laisser gouverner librement par des actionnaires, et administrer par un directeur et des employés responsables.
C’est ainsi, du reste, que la Comédie-Française était gouvernée du temps de Molière.
Il est vrai que ce pauvre Molière travaillait dru. Il dirigeait sa troupe, écrivait des chefs-d’œuvre et les jouait. On n’avait pas encore inventé de son temps les subventions de 400 000 francs, les parts assurées et les feux de 10 francs. La Comédie-Française n’était pas alors un chapitre de chanoines. Les comédiens étaient obligés de se tirer d’affaires eux-mêmes ; on ne taxait pas les contribuables à leur profit.
Mais nos conservateurs sont bien capables d’affirmer que ce régime-là ne valait rien, au point de vue de l’art.
______________
[1] Économiste belge, novembre 1849.


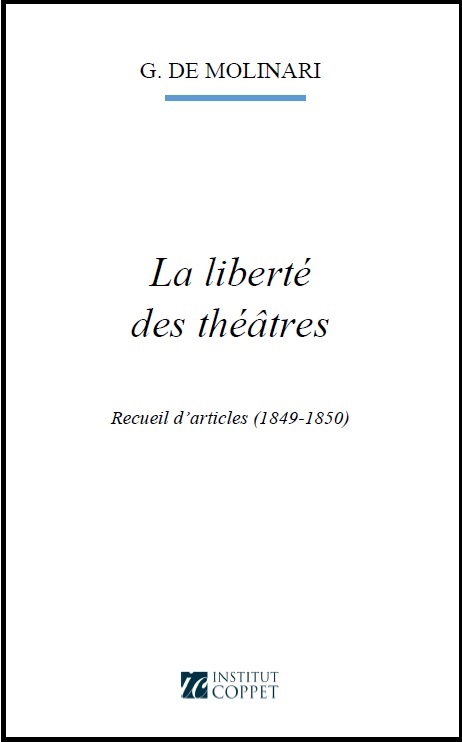
Laisser un commentaire