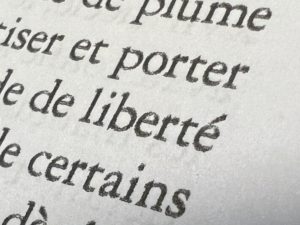 Pour Ambroise Clément, le maintien de la compression des libertés individuelles, et la vogue des théoriciens qui les soutiennent, s’explique avant tout par une méprise grave commise par l’immense majorité du public, et même nombre d’esprits soi-disant libéraux, sur le vrai sens de ces deux notions : liberté et autorité. Contre les timides et les modérés, A. Clément proclame ce qu’est le vrai sens de l’un et de l’autre, en s’appuyant sur les principes posés jadis par Charles Comte et Charles Dunoyer, et que les économistes libéraux du Journal des économistes paraissent encore les seuls à comprendre et à maintenir.
Pour Ambroise Clément, le maintien de la compression des libertés individuelles, et la vogue des théoriciens qui les soutiennent, s’explique avant tout par une méprise grave commise par l’immense majorité du public, et même nombre d’esprits soi-disant libéraux, sur le vrai sens de ces deux notions : liberté et autorité. Contre les timides et les modérés, A. Clément proclame ce qu’est le vrai sens de l’un et de l’autre, en s’appuyant sur les principes posés jadis par Charles Comte et Charles Dunoyer, et que les économistes libéraux du Journal des économistes paraissent encore les seuls à comprendre et à maintenir.
LIBERTÉ ET AUTORITÉ
par Ambroise Clément
(Journal des économistes, avril 1869)
« Nous causerons, et votre faculté pensante aura le plaisir de se communiquer à la mienne par le moyen de la parole, ce qui est une chose merveilleuse que les hommes n’admirent pas assez [1]. »
C’est là, en effet une admirable chose, et il faut bien remarquer que le langage n’est pas seulement le moyen des communications de la pensée, il n’est pas moins nécessaire à la formation de la pensée elle-même, à l’enchaînement de nos idées ; car, au-delà de leurs combinaisons les plus simples, nous ne pourrions, sans son secours, sans la facilité qu’il nous donne pour démêler, distinguer et coordonner nos diverses perceptions, former en nous ni raisonnements, ni jugements.
Il résulte de là que, si cet indispensable instrument de notre esprit est trop imparfait, si, dans le cours de nos investigations, la langue n’est pas assez complète pour fournir, à chacune des idées qu’elles font surgir, un mot qui lui soit propre et ne permette pas de la confondre avec d’autres, ou si, encore, elle n’est pas assez précise pour que les mêmes termes réveillent constamment, chez tous, des idées à peu près identiques, la lumière intellectuelle que cherche notre raison ne se produit guère et ne se communique plus, ou du moins elle reste confuse et incertaine dans la mesure même de ces imperfections du langage.
Parmi les obstacles qui ont empêché ou retardé l’avancement des sciences morales et politiques, restées pour la plupart fort en arrière des sciences physiques ou naturelles, nous n’en connaissons point de plus puissant que les graves et nombreuses défectuosités de leurs nomenclatures.
Dans tout ce qu’embrassent les investigations de cet ordre, la difficulté de s’entendre et la lenteur des progrès tiennent, d’abord, au mélange qu’on y a constamment fait des notions ou propositions vérifiables, avec celles qui ne le sont pas, et, par leur nature, ne sauraient jamais être que conjecturales ou hypothétiques ; ensuite, et surtout, au défaut absolu de précision dans nombre de termes ou de formules plus ou moins généralement adoptés pour l’exposition des doctrines.
On peut, par exemple, aisément reconnaître, — nous en donnerons bientôt la preuve — que la grande diversité des acceptions attribuées aux mots liberté et autorité, est l’une des sources principales des erreurs et des contradictions qui abondent dans les doctrines philosophiques ou sociales. Il est donc probable que, si l’on parvenait à assigner à ces expressions un sens assez précis pour qu’elles ne pussent plus comporter aucun malentendu, les recherches ayant pour objet de constater en quoi consiste réellement notre libre arbitre, ou celles tendant à concilier la liberté et l’autorité, seraient plus fructueuses qu’elles ne l’ont été jusqu’ici, et qu’en même temps bien des discussions stériles sur ces matières seraient désormais évitées. Tel est le but que nous espérons pouvoir atteindre par cet écrit.
Nous eussions préféré, dans un tel sujet, pouvoir faire abstraction des considérations religieuses et philosophiques que l’on y a toujours rattachées ; car ce sont celles qui ont le plus mêlé les conceptions purement hypothétiques, variables d’un esprit à l’autre, et toutes scientifiquement incertaines, aux notions vérifiables, par conséquent, de nature à acquérir les caractères de la certitude, et, dès lors, à devenir identiques pour tous.
Mais ces deux genres de notions sont tellement et si intimement associés dans les esprits, que l’on ne pourrait guère réussir à substituer des convictions basées sur la vérité ou sur de sérieuses probabilités, à celles fondées sur les préjugés ou l’erreur, en s’attachant uniquement aux notions véritables à l’exclusion des autres ; nous avons donc tenté d’élucider même celles-ci, de rendre plus plausibles celles que nous admettons, de ne laisser sans examen aucune des diverses conceptions que peuvent rappeler les mots liberté et autorité, et de les ramener toutes, s’il est possible, à l’identité.
Pour qu’une telle tentative ait chance d’aboutir, il ne suffira pas que nous réussissions à rendre nos propositions difficilement contestables ; il faut encore que le lecteur soit décidé à ne point repousser, sans examen raisonné, des vues ou des opinions nouvelles pouvant heurter des préjugés plus ou moins enracinés, et qu’il veuille bien, à cet effet, s’imposer quelques efforts d’attention ; conditions qui, nous le savons de reste, ne sont ni faciles, ni agréables à observer ; mais auxquelles, en tout cas, il est indispensable de se résigner, chaque fois que l’on aspire à élever réellement, sur d’importants sujets de réflexion, son niveau intellectuel.
I. — LA LIBERTÉ.
Dans les dissertations sur la morale, la philosophie et la politique, le mot liberté est peut-être celui de tous que l’on répète le plus sans s’entendre, sans qu’il réveille dans les esprits des conceptions qui, loin d’être identiques pour tous, sont, le plus souvent, fort dissemblables de l’un à l’autre ; non seulement les acceptions changent avec les diverses divisions admises dans l’étude de l’homme et des sociétés, mais encore il est rare que, dans l’une de ces divisions en particulier, chacun de ceux qui s’en occupent attache au mot dont il s’agit un sens qui soit exactement le même pour tous les autres. C’est ce dont nous allons rappeler de nombreux exemples, avant d’entreprendre d’assigner à ce mot un sens unique et invariable, quelle que soit la nature des investigations poursuivies.
Pour les théologiens chrétiens de la communion romaine, le libre arbitre est un don que l’homme reçoit de Dieu, consistant dans la faculté de se déterminer par lui-même à pratiquer soit le bien, soit le mal — le bien étant tout ce qu’ordonnent les commandements divins, émanés de Dieu même ou de son Église, et le mal, tout ce qu’interdisent ces mêmes commandements, en sorte qu’ici la liberté se réduit à une obéissance passive dans tous les cas où elle ne prend pas le caractère d’une rébellion envers Dieu ou ses ministres.
Pour la grande majorité de nos moralistes non théologiens, la liberté est aussi la faculté de choisir entre le bien et le mal, déterminés, non plus essentiellement par des commandements divins, traditionnels ou écrits, mais par une faculté révélatrice dont Dieu a pourvu chacun de nous — la conscience ou le sens moral —, faculté en puissance de prononcer infailliblement sur le bien et sur le mal. Ici encore la liberté ne comporte la faculté du choix de nos déterminations que dans les cas de révolte contre la conscience, qui est une sorte d’inspiration ou de lumière divine prononçant indépendamment de nos volontés ; dans tous les autres cas, nous ne faisons qu’obéir passivement aux arrêts de la conscience.
Chez les moralistes de l’école expérimentale, la liberté consiste essentiellement dans la faculté de choisir, après délibération et jugement, entre les directions diverses qui peuvent nous solliciter simultanément ; nos déterminations sont dans la voie du bien dès qu’elles servent l’intérêt commun des hommes ; elles sont dans la voie du mal dès qu’elles nuisent à cet intérêt ; pour discerner sûrement ce qui, dans la conduite, se trouve dans l’une ou dans l’autre de ces voies, l’observation ou l’expérience nous sont indispensables, et notre raison, appuyée sur les données qu’elles lui procurent, est la seule faculté révélatrice du bien et du mal dont nous soyions réellement pourvus.
Pour la plupart de nos philosophes spiritualistes, la liberté est encore la faculté de délibérer nos déterminations, mais sans qu’il soit besoin de recourir à d’autres guides que la conscience révélatrice, ou la raison intuitive, qui serait, comme la conscience, une inspiration divine. Selon les doctrines de cette école, rappelées par ce que nous allons citer, la liberté serait soumise à des conditions qui, à notre avis, l’annuleraient entièrement.
« Que se proposent aujourd’hui, dit M. Edouard Laboulaye, la philosophie de l’histoire, l’économie politique, la statistique, sinon de rechercher les lois naturelles et morales qui gouvernent les sociétés ? Entre l’homme et la nature il y a sans doute cette différence, que l’un est libre, tandis que l’autre suit une course inflexible ; mais cette condition nouvelle complique le problème et ne le change pas. Quelle que soit la liberté de l’individu, quelque abus qu’il en fasse, on sent que celui qui nous a créés a dû faire entrer ces diversités dans son plan ; le jeu même de la liberté est prévu et ordonné. En ce sens, il est vrai de dire avec Fénelon, que l’homme s’agite et que Dieu le mène. Nos vertus, nos erreurs, nos malheurs mêmes, tout en décidant de notre sort, n’en servent pas moins à l’accomplissement de la suprême volonté [2]. »
L’existence de lois morales, c’est-à-dire de lois déterminant les conséquences nécessaires de notre conduite et pouvant ainsi agir directement sur nos volontés, ne contredit pas plus notre liberté que l’existence des lois physiques ; nous avons sans doute à tenir compte, parmi les motifs de nos déterminations, des unes et des autres de ces lois, dès qu’elles nous sont connues ; mais une telle condition, au lieu d’infirmer la liberté, en suppose, au contraire, l’exercice, et il est d’expérience que celle-ci, loin d’y trouver un obstacle, grandit en puissance à mesure que nous connaissons et que nous observons mieux les lois au milieu desquelles elle est appelée à s’exercer.
Mais, s’il était vrai que l’homme s’agite tandis que Dieu le mène, ou que le jeu même de la liberté fût prévu et ordonné par la Divinité, il deviendrait évident que l’homme n’est pas plus libre, dans ses déterminations, que le fruit tombant de l’arbre ou l’eau cherchant son niveau, et que tous les actes, tous les mouvements intérieurs ou extérieurs de sa conduite, seraient assimilables aux autres mouvements mécaniques de l’univers. La liberté, dans une doctrine admettant de telles conditions, n’existe pas plus que dans celle du matérialisme absolu. Seulement, la première suppose que toute action a sa cause initiale dans une force unique, intelligente, personnifiée et voulant ce qu’elle fait, tandis que la seconde soutient l’hypothèse que tous les mouvements résultent de propriétés inhérentes à la matière et inconscientes de leur action, qui ne se rattacherait à aucune volonté. Mais la nécessité des évolutions de la vie physique, intellectuelle et morale des hommes est aussi absolue, aussi inflexible, dans le premier système que dans le dernier, et c’est ce que toutes les vieilles et modernes subtilités scolastiques nous paraissent radicalement impuissantes à infirmer [3].
Pour les philosophes matérialistes, ou du moins pour ceux d’entre eux qui restent conséquents avec leurs principes, la négation de la liberté humaine est forcée ; car, si tout ce qui se passe en nous et hors de nous ne résulte jamais que des propriétés inhérentes à la matière, agissant d’après des lois inflexibles dont nos volontés elles-mêmes ne peuvent être que des effets nécessaires, il est évident que nos actes, nos déterminations, nos pensées mêmes, résultats infaillibles du jeu involontaire des forces universelles, ne comportent pas plus de liberté, c’est-à-dire d’initiative et d’action propres à notre personnalité, que n’en comporte le mouvement des aiguilles d’une montre. Il est dès lors assez remarquable que les défenseurs de cette doctrine, ou du moins plusieurs des principaux d’entre eux, professent en morale le culte de la conscience révélatrice du bien et du mal, et déclarent y trouver la règle de leur conduite comme s’il leur était facultatif d’agir autrement, et qu’il y eût à s’inquiéter de règles pour des mouvements nécessaires ! Comme s’ils oubliaient que la ligne de leur conduite est invariablement fixée par les lois inconscientes régissant la matière !
Enfin, le mot liberté prend, en politique, des acceptions indéfiniment variées, et chez le plus grand nombre, la notion de la liberté se confond positivement avec celle de la domination.
Et que l’on ne se hâte pas de penser que nous imaginons une aussi incroyable confusion ; car elle existe incontestablement, non seulement chez les partisans de la souveraineté absolue du peuple, dont le principe soumet les minorités à la domination illimitée des majorités ; mais encore chez tous les autres partis politiques, même chez ceux qui s’intitulent libéraux, attendu qu’à l’exception d’une opinion trop impuissante encore pour avoir pu constituer un parti, tous veulent une action dirigeante du gouvernement sur la société, sur l’enseignement et l’éducation, sur les cultes religieux, sur les beaux-arts, sur les travaux et les administrations d’intérêts locaux, sur l’assistance ou la charité, sur les travaux et les transactions de la production générale, etc. Et ils ne paraissent nullement se douter que tout ce qu’ils livrent de la sorte aux attributions gouvernementales, est inévitablement enlevé à la liberté individuelle, à laquelle ils substituent ainsi, dans une plus ou moins large mesure, les vues, les volontés, en un mot, la DOMINATION des gouvernants.
Cette étrange et funeste erreur, due aux enseignements décevants qui règnent encore, est, nous le répétons, fortement empreinte dans les tendances de tous nos partis politiques actifs : généralement, nos démocrates ou nos républicains sont pour la souveraineté du peuple et le pouvoir, sans limites positives, des majorités. Nos impérialistes veulent un gouvernement fort et respecté, résidant à peu près uniquement dans la personne d’un souverain tout puissant, appuyé sur d’immenses armées de militaires, de marins et de fonctionnaires, sur un clergé, un corps enseignant et un corps judiciaire également obéissants, redouté des étrangers et assurant ainsi la prépondérance de la France, faisant fleurir à l’intérieur, par ses directions, les beaux arts et l’industrie, et absorbant chaque année, pour ses peines, le quart tout au moins des valeurs produites : avec tout cela, et sans y rien changer, la liberté viendra, si elle peut, couronner l’édifice. Nos monarchistes des régimes antérieurs conçoivent la liberté comme ne pouvant subsister que sous une triple autorité directrice : Dieu (ou son clergé), le roi, et la loi. Nombre de ces derniers se croient libéraux, et voudraient joindre à cette trinité de régisseurs sociaux, des pouvoirs ou dénominations aristocratiques, qu’ils considèrent comme les meilleurs garanties de la liberté contre son absorption par un monarque ou un clergé trop puissants, ou par d’ignorantes et versatiles majorités populaires.
Au point de vue religieux, la liberté collective n’est pas jugée moins diversement, ni moins singulièrement. Les uns affirment qu’il n’est point de liberté pour les peuples sans de puissantes croyances religieuses ; les autres soutiennent, au contraire, que la puissance religieuse, concentrée dans les corporations ecclésiastiques, est l’un des plus grands obstacles à la liberté. Pour les croyants catholiques romains, la liberté des peuples est subordonnée aux directions des souverains, soumis eux-mêmes aux directions de l’Église ou du Pape. Pour les catholiques russes et les musulmans, l’autorité religieuse, unie au pouvoir politique, doit diriger toutes les libertés. Pour un grand nombre de protestants chrétiens, la liberté a ses règles limitatives dans les enseignements bibliques et dans les lois civiles qui s’y conforment, etc.
Au point de vue législatif, le mot liberté comporte une aussi grande variété d’acceptions, non moins fausses pour la plupart : les auteurs de notre déclaration des droits de 1791 affirment que les hommes naissent et demeurent libres, ce qui n’est exact ni en fait, ni en droit, et que la liberté est le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas à autrui, définition par trop incomplète, laissant à connaître, parmi tout ce qui, dans la conduite de chacun, est nuisible à autrui, ce qui peut et doit être empêché ou réprimé. Bentham, en critiquant cette définition, fait consister la liberté dans « le pouvoir de faire ce qu’on veut, le mal comme le bien, ce qui rend les lois nécessaires pour la restreindre aux actes qui ne sont pas nuisibles » (Tactique des assemblées représentatives, t. II p. 343), proposition qui opposerait les lois à la liberté. La vérité est, au contraire, que les bonnes lois, loin de contredire ou de restreindre, en somme, la liberté des populations, ont pour effet certain de l’étendre davantage en la garantissant de toute atteinte. La plupart des jurisconsultes tombent dans une erreur ou une inadvertance analogue en affirmant que, « dans l’état de nature, les hommes jouissent d’une liberté illimitée, tandis que, dans l’état de société, ils sont obligés de sacrifier une portion de leur liberté pour conserver l’autre. » Ce qui est vrai, c’est que, dans l’état de société avancée, d’ailleurs tout aussi naturelque l’état sauvage appelé de nature, les hommes, pris individuellement ou collectivement, ont incomparablement plus de liberté, c’est-à-dire de puissance d’agir efficacement, selon leurs volontés, leurs besoins ou leurs désirs, qu’ils n’en ont dans ce dernier état ; on ne peut donc pas dire qu’en s’élevant au premier, ils fassent aucun sacrifice de liberté. Pour en finir avec cette erreur, généralement répandue, disons encore que la renonciation à faire du mal à autrui, et la détermination de respecter et faire respecter les droits égaux de tous, ne sont pas des sacrifices, mais bien d’incontestables et importants progrès de la liberté.
Nos publicistes contemporains, et même ceux animés d’un libéralisme fort éclairé à beaucoup d’égards, ne paraissent pas non plus se faire constamment de la liberté une idée bien nette. Dans son ouvrage sur la liberté, M. Jules Simon professe que les gouvernements ne doivent accorder la liberté aux peuples que dans la mesure où ceux-ci sont capables d’en bien user, ce qui ferait de la liberté une concession de l’autorité, et réserverait aux hommes qui en sont investis la décision sur la réduction ou l’extension de leurs attributions directrices. Dans son volume sur le parti libéral et son avenir, M. Édouard Laboulaye, l’un de nos plus éminents et de nos meilleurs esprits, atteste que, sous le régime actuel, l’enseignement secondaire est libre en France, bien qu’il y soit en réalité des plus enchaînés par la régie directe de l’État sur tous les établissements universitaires, par les programmes d’études et l’autorisation préalable imposés aux autres établissements, et surtout par les titres ou brevets, constatant le degré d’instruction littéraire ou scientifique acquise par le titulaire dans le cadre des programmes officiels, hors duquel un savoir beaucoup plus utile ne ferait acquérir aucun des grades rigoureusement exigés pour l’admission à une multitude de carrières, notamment à celle de professeur.
Il est à remarquer qu’en général on fractionne plus ou moins la liberté, chacun s’attachant de préférence à certaines libertés spéciales et se préoccupant peu des autres : les démocrates et les libéraux de nos partis actifs préconisent surtout les libertés dites politiques, celles des élections, de la tribune, des réunions, de la parole et de la presse ; — toutes les autres, qu’ils qualifient parfois de petites libertés, bien que les premières ne dussent être qu’un moyen de les obtenir et de les garantir, échappent plus ou moins à leur attention. Il en est de même chez tous les partisans actifs des dynasties déchues, en sorte que l’on pourrait croire que les uns et les autres ne considèrent comme véritablement intéressantes que les libertés pouvant les conduire ou les ramener à l’exercice du pouvoir.
Les économistes, enfin, sont pour la liberté générale, garantie à tous également, des travaux et des transactions, laquelle — en y comprenant comme de raison les travaux s’appliquant directement à la culture de nos facultés — est bien près d’être la liberté tout entière. Ils s’évertuent à prêcher cette petite liberté au milieu de populations qui, en somme, ne paraissent guère se douter qu’elles aient à s’inquiéter de semblables questions, et sont disposées à croire qu’il s’agit là de nouveautés utopiques, peut-être dangereuses et, en tout cas, peu intéressantes pour la liberté, telle qu’on les a formées à la concevoir.
Ce qui précède suffira sans doute pour permettre de reconnaître combien les esprits sont loin, en France et ailleurs, d’être prêts à s’entendre sur la liberté.
Deux publicistes français de ce siècle, Charles Comte et Dunoyer, ont consacré leur vie à ramener les sciences morales et politiques aux méthodes qui seules ont pu assurer le progrès des autres sciences et à tirer la philosophie, la morale et la politique de l’impasse où les ont fourvoyées leur langage babélique et leur dogmatisme arbitraire. Jusqu’ici notre siècle n’a guère goûté les enseignements de ces esprits vraiment supérieurs, et il ne les a nullement suivis, ce qui, pour nous, s’explique par la raison qu’ils l’avaient trop devancé ou qu’ils s’étaient tenus trop en dehors de ses illusions.
Mais leurs efforts ont produit des semences, qui, nous en avons du moins le ferme espoir, fructifieront un jour, alors que, corrigés par une longue suite de déceptions, nous serons moins disposés à nous livrer aux poursuites chimériques, alors que la pensée des uns, lasse d’errer dans les régions nébuleuses de la philosophie éclectique ou de la philosophie panthéiste, sera revenue à des objets moins inaccessibles, à des préoccupations plus fécondes et plus urgentes ; alors que l’esprit des autres, enfin guéri des rêveries hallucinées d’Owen, de Fourier, de Saint-Simon, de Cabet, ou des lubies socialistes non moins folles de Fénelon, de Montesquieu, de Rousseau, de Mably, de Raynal, de Robespierre, de Saint-Just, d’Auguste Comte, de Louis Blanc, de Proudhon, etc., etc., et laissant, d’un autre côté, aux anciens Romains toutes les théories césariennes, sera redevenu moins rebelle au bon sens, aux leçons de l’expérience et plus capable de distinguer les véritables lumières intellectuelles de toutes les aberrations mentales.
Dans les travaux de ces deux publicistes, la liberté se trouve étudiée sous deux points de vue différents : Dunoyer la voit dans la puissance progressive de nos facultés, laquelle se développe et grandit à mesure que nous triomphons davantage des obstacles que lui opposent, d’une part, notre ignorance, nos erreurs et nos vices, d’autre part le milieu dans lequel nous vivons [4]. Charles Comte, n’envisageant la liberté qu’au point de vue moral ou social, la considère comme la condition de l’exercice de tous les droits et de l’accomplissement de tous les devoirs, et il la fait consister dans la suppression de toutes les conditions concourant à constituer l’esclavage ou la servitude [5]. Au surplus, la diversité des rapports étudiés n’empêche point leurs observations respectives d’être également vraies et importantes, et nous en userons à l’appui de nos propositions.
Nous allons maintenant rechercher quelle est l’idée précise qu’il convient d’attacher au mot liberté dans son sens le plus général, celui du point de vue philosophique.
L’homme est soumis à une multitude de conditions d’existence qui, à première vue, ne semblent pas permettre de le reconnaître comme un agent libre, car elles sont entièrement indépendantes de sa volonté ; celle-ci n’est pour rien dans sa naissance, dans le sexe, dans la détermination du moment, du lieu, de la famille où elle survient ; elle n’est pour rien non plus dans l’organisation qu’il reçoit, dans la nature des forces qui animent, développent et soutiennent cette organisation ; dans la durée variable, mais limitée, de ses fonctions vitales, et dans un grand nombre des altérations qu’elles subissent pendant cette durée.
S’il lui a été donné d’engendrer, comme aux animaux et aux plantes, ce n’est qu’en obéissant à d’impérieux instincts, et cette mystérieuse production d’une organisation vivante est si réellement étrangère à sa volonté qu’elle est au rang des choses inintelligibles pour lui.
Ce n’est pas davantage à sa volonté que sont dues la nature des choses au milieu desquelles il est placé, ni celle des besoins auxquels il est impérieusement soumis, ni celle des facultés intellectuelles et affectives qu’il a reçues en germe ; mais il peut perfectionner ces facultés, en grandir la puissance, développer ses besoins, en contracter de nouveaux, modifier l’action des êtres et des forces dont il est entouré, et cela dans des limites indéfinies, qui, chez les populations progressives, reculent à mesure que les générations se succèdent, les progrès accomplis par chacune d’elles s’ajoutant à l’héritage de celle qui la suit. C’est ici que se manifeste clairement notre liberté.
Si nous nous demandons, en effet, quels sont les caractères au moyen desquels nous pouvons concevoir et constater sûrement la liberté, nous reconnaîtrons d’abord que le premier, l’un des plus décisifs, est celui que nous avons signalé — une faculté d’initiative attachée à notre personnalité, à notre volonté — et l’on verra plus loin que l’existence en nous d’une telle faculté est tout à fait évidente ; nous reconnaîtrons ensuite d’autres caractères de la liberté dans le pouvoir manifesté par l’être qui en est doué, de développer par lui-même ses facultés natives, d’exercer sur la partie de la création à sa portée une action considérable, une domination progressive, de changer les conditions primitives de son existence ou de modifier ses destinées en ce monde au point d’arriver à des situations qui n’ont plus rien de comparable à son état originaire, et de pourvoir son espèce de milliers de fois plus de moyens d’existence qu’elle n’en avait alors. Or, nous ne saurions douter que l’homme soit investi d’une telle puissance, car, en vue de ses besoins, il a changé la face de la terre et en a fait son domaine ; il a profondément modifié la distribution primitive de la vie sur le globe, multipliant ou restreignant, selon ses volontés, les diverses espèces animales et végétales ; il a donné à ses facultés un développement prodigieux et multiplié ses moyens d’existence deux mille fois plus, tout au moins, relativement à l’étendue du territoire occupé, qu’ils ne le sont dans cette situation, plus ou moins rapprochée de l’état primitif, que nous présentent encore diverses peuplades de sauvages.
Enfin, un autre caractère essentiel de la liberté consiste en ce qu’elle ne comporte, dans ses évolutions ou ses développements chez l’être qui en est pourvu, rien de nécessaire, de fatalement imposé, ni par conséquent d’invariable, de constamment uniforme, comme le sont les existences paraissant entièrement subordonnées à l’instinct, telles, par exemple, que celles des abeilles ou des castors. Or, rien n’est plus divers, plus varié que la marche suivie par les différents peuples dans leurs associations familiales et politiques, dans leurs croyances religieuses ou leurs cultes, dans les développements de leur industrie et de leur savoir, dans leurs institutions et leurs mœurs, en un mot, dans leur civilisation sous tous les rapports ; tout, dans l’extrême diversité de ces civilisations, révèle qu’elles ne résultent pas de lois nécessaires et inflexibles imposées aux développements de l’humanité, mais bien des directions contingentes de nos volontés, et c’est là assurément l’une des preuves les plus saisissantes de la réalité de notre liberté.
Les caractères généraux de la liberté se manifestent donc, chez l’homme, avec une évidence qui ne nous semble plus permettre aux esprits attentifs de conserver aucun doute à cet égard.
Mais comment procède cette liberté, et en quoi consistent essentiellement les conditions de son exercice efficace ? C’est ce que nous allons examiner.
Les plus admirables de nos facultés sont celles dont l’ensemble est désigné par les mots intelligence ou entendement. Notre intelligence ne connaît ou ne comprend pas plus sa propre essence que celle d’aucune des autres forces ou puissances actives dont elle peut observer les effets, telles que la gravitation, l’électricité, la vie, etc. Seulement, elle peut analyser plus ou moins ses diverses fonctions, et y distinguer, par exemple, la sensation, la perception ou l’idée, la mémoire, l’attention, l’observation, la réflexion, les rapprochements, combinaisons ou enchaînements d’idées, donnant lieu à l’imagination, à l’induction, à la déduction, à la connaissance, à la prévoyance, au jugement, et enfin, la détermination ou la volonté.
D’autres facultés, que nous distinguons de l’intelligence proprement dite, mais qui ont avec elle de très intimes rapports, sont nos affections, nos sentiments, nos passions, phénomènes internes plus instinctifs que volontaires, et néanmoins, pouvant être modifiés et de plus en plus guidés par notre intelligence.
Ce que nous nommons la raison n’est pas autre chose que l’ensemble de nos facultés intellectuelles, mises en activité par notre volonté, dans le but d’accroître nos connaissances, nos compréhensions, de distinguer, dans tout ce qui n’est pas inaccessible à notre entendement, la vérité de l’erreur, ce qui nous sert de ce qui nous nuit, ce qui nous perfectionne de ce qui nous dégrade, en un mot, de développer ce que l’on a justement nommé nos lumières, car les conquêtes de la raison sont pour notre esprit ce que la lumière physique est pour nos yeux ; elles nous font voir et comprendre nettement des choses que, sans leur secours, nous n’apercevrions pas, ou dont nous n’aurions que des idées erronées ou confuses.
La raison ne parvient à produire des lumières intellectuelles qu’à l’aide de l’observation ou de l’expérience, aussi bien quand ses investigations portent sur l’homme lui-même ou sur ses facultés, que lorsqu’elles s’appliquent aux objets extérieurs. À défaut de ces moyens et des inductions ou déductions qu’autorisent les données qu’ils fournissent, la raison est sujette à divaguer, à prendre pour la lumière des jeux d’imagination, ou des fantômes pour la réalité. C’est ce qui a été constamment démontré par la marche suivie dans les sciences naturelles, lesquelles n’ont progressé et ne se sont dégagées des erreurs et des illusions, que dans la mesure où elles se sont plus rigoureusement astreintes à ne baser leurs investigations et leurs conclusions que sur l’expérience ou l’observation.
On pourra s’apercevoir ici que nous nous sommes permis d’exposer des notions psychologiques, ne ressemblant guère, quant au fond, ni surtout quant à la forme, à celles généralement enseignées de nos jours ; c’est que nous les avons puisées, non dans ces enseignements — ni même dans d’autres, tels que ceux de Bacon, de Locke, de Condillac, aujourd’hui délaissés, bien qu’à notre avis, ils soient plus souvent vrais que ce qu’on leur a substitué —, mais dans nos propres observations, faites sur nous-même, en évitant d’y mêler aucune conception hypothétique pouvant altérer les résultats ; elles sont d’ailleurs présentées, ce nous semble, dans un langage intelligible pour tous ; chacun peut donc les vérifier en lui, et nous croyons qu’elles seront reconnues exactes par tous ceux qui, sans autre souci que celui de la vérité, voudront comme nous observer par eux-mêmes.
Ces notions, jointes à nos autres observations, nous paraissent suffire pour disposer à concevoir ou à reconnaître que notre liberté n’est qu’un exercice de la raison ; qu’elle consiste essentiellement dans la faculté de substituer aux entraînements, aux instincts ou aux sentiments aveugles qui peuvent nous solliciter, des déterminations délibérées, et dont les lumières intellectuelles peuvent nous montrer la portée ou les conséquences ; en ce sens, elle serait la faculté de prévoir et de conformer nos déterminations à cette prévoyance ; mais plus généralement, elle est la faculté d’exercer notre raison et de subordonner à ses directions, dans toute notre activité, nos mobiles instinctifs.
Nul assurément ne contestera qu’il dépende uniquement de l’initiative ou de la volonté de tout homme pourvu de raison d’exercer ou de ne pas exercer cette faculté ; car, s’il en était autrement, si tout, jusqu’à cette détermination intime, nous était imposé par des lois fatales, la raison, la volonté même, ne seraient plus que de vaines illusions, et l’homme sain d’esprit ne devrait pas plus être considéré comme responsable de ses actes que celui frappé de folie ou de démence ; il est donc hors de discussion, qu’en ce qui concerne l’exercice ou le non exercice de la faculté dont il s’agit, nous sommes bien absolument libres.
Toutefois ce n’est là, pour ainsi dire, qu’un germe, une première condition de la liberté, d’où résulte seulement que notre volonté est indépendante, soit en soumettant ses déterminations à un exercice préalable de la raison, soit en s’y refusant ; mais il importe de bien retenir que c’est uniquement par cet exercice préalable de la raison, que la liberté se développe et grandit. L’expérience et l’observation nous apprennent, en effet, et de manière à ne laisser subsister aucun doute sur ce point, qu’à mesure que notre raison s’exerce davantage, qu’elle gouverne plus entièrement nos mobiles instinctifs, qu’elle prend plus exclusivement la direction de notre conduite, nous étendons notre empire sur la nature extérieure, nous l’assujettissons mieux à servir nos volontés ou nos besoins, et en même temps, nous luttons avec plus de succès contre les obstacles qu’opposent à nos progrès, par conséquent aux développements de notre liberté, toutes les imperfections de notre propre nature.
Nous voudrions bien qu’ici notre pensée fût nettement saisie, et nous insisterons sur son expression, sauf à nous répéter : la liberté n’est point, comme on le dit souvent, la faculté de faire ce qu’on veut, ce qui impliquerait l’omnipotence de la volonté, elle est dans la faculté progressive que nous venons de signaler, de POUVOIR ce que nous voulons ; or, encore une fois, ce pouvoir ne grandit que par l’exercice de la raison et dans la mesure des lumières acquises par celle-ci ; c’est donc bien à la raison que sont dus tous les développements de la liberté, qui, sans un tel secours, resterait aussi impuissante, aussi inféconde et aussi peu manifeste chez l’homme qu’elle l’est chez les animaux.
Ainsi notre liberté n’est, au fond, pas autre chose que l’exercice de notre raison — le seul de nos mobiles perfectible par lui-même— s’appliquant à toutes nos déterminations à toute notre activité, et grandissant le pouvoir de nos volontés dans la mesure de l’énergie et de la persévérance que nous y apportons, dans la mesure aussi où nos mobiles instinctifs lui sont plus entièrement subordonnés.
Telle est, d’après nos convictions, la vraie notion de la liberté, au sens le plus général du mot.
Ce sens n’est-il plus le même, et la liberté change-t-elle de nature ou de caractère, si, cessant de la considérer au point de vue général, nous l’observons dans ses rapports avec l’un ou l’autre des divers ordres de faits qu’embrasse notre activité, et par exemple, dans l’ordre économique ou dans l’ordre moral, ou dans l’ordre politique ? Pas le moins du monde : elle reste toujours et dans tous les cas la même, et c’est ce que nous allons établir.
Dans l’ordre économique, divers mobiles instinctifs que résume le mot intérêt, nous poussent à tirer de nos efforts, de nos travaux, de notre industrie, le parti que nous croyons le plus avantageux pour nous et les nôtres ; mais nous n’y parvenons pas autrement que par l’exercice de la raison, et toujours selon l’abondance et le degré des lumières acquises au moyen de cet exercice ; c’est de là que découlent les découvertes, les inventions, les perfectionnements de procédés et de combinaisons, toutes les aptitudes ou capacités techniques, concourant à rendre notre industrie plus productive, à multiplier nos moyens d’existence, de satisfaction et d’action utile, à grandir ainsi le pouvoir de nos volontés, et par conséquent notre liberté.
De tels résultats ne sont pas dus seulement aux développements progressifs que l’exercice de la raison donne à nos facultés industrielles et à leur pouvoir sur la nature extérieure ; la domination que la raison parvient à établir sur nos mobiles ou nos penchants instinctifs n’y contribue pas moins puissamment : c’est par là, en effet, que se substituent graduellement en nous, et dans la mesure où nous exerçons davantage notre raison, la prévoyance active à l’inertie insouciante de l’avenir, l’habitude des labeurs énergiques et soutenus à l’indolence ou à la paresse, la tempérance et l’économie aux appétits déréglés et dilapidateurs, le respect de la liberté et de la propriété d’autrui aux excitations qui nous disposeraient à y porter atteinte — conditions qui, toutes, sont indispensables à l’essor et à la fécondité des forces productives, et sans lesquelles ne pourraient se former, se renouveler et se multiplier les capitaux, l’un des éléments constitutifs de ces forces, à défaut duquel leurs autres éléments resteraient sans efficacité.
Dans l’ordre moral, la liberté résulte également de la subordination de nos mobiles instinctifs à notre raison, aux lumières et à la prévoyance que son exercice nous permet d’acquérir.
Si les lois morales ne consistaient qu’en des commandements ou préceptes dogmatiques, imposés comme émanant de Dieu même, soit qu’il les ait fait inscrire dans des livres inspirés, soit qu’il les révèle directement à la conscience de chacun de nous — commandements ou préceptes variant d’ailleurs d’une religion ou d’une conscience à l’autre — s’il en était ainsi, disons-nous, il serait clair que l’exercice de notre raison ne pouvant déterminer, dans ces règles surhumaines et immuables, ni changements ni progrès, serait ici sans nulle efficacité, et que de telles règles n’admettant qu’une obéissance passive, ne sauraient se prêter à aucun développement de notre liberté.
Mais s’il en est autrement, si, comme nous en avons la conviction profonde, la raison, appuyée de l’expérience et de l’observation, est le seul guide de notre conduite que nous ayons réellement reçu de l’auteur de notre nature ; si, encore, et comme nul ne le contestera, le véritable but de notre existence en ce monde est le perfectionnement de toutes nos facultés, l’amélioration et l’élévation de la vie humaine sous tous les rapports, la morale peut constituer une science aussi positive et aussi progressive que les autres, devant se développer dans la mesure où, par l’exercice de notre raison, nous connaîtrons mieux toutes les conséquences de nos tendances et de nos actions, et où cette connaissance, rapportée au but de notre existence, nous permettra de discerner plus sûrement ce qui est bien ou mal dans la conduite de chacun et de tous, par conséquent nos devoirs et nos droits, ou les règles normales que nous avons à suivre et à faire observer.
Ainsi que l’a démontré Charles Comte, la liberté est la condition indispensable de l’exercice de ces droits et de l’accomplissement de ces devoirs ; car, si notre conduite ne dépendait en rien de notre volonté, et qu’elle fût réglée par des lois fatales ou par l’action divine, elle ne comporterait pas plus de droits et de devoirs que n’en comporte le mouvement de la pierre qui tombe ; et si, étant libres par nature, nous sommes dépouillés de cette liberté par nos semblables, nous perdons évidemment la faculté d’user de nos droits et de remplir nos véritables devoirs, d’autant plus que notre volonté est plus dominée ou plus enchaînée.
Dire que nous avons à exercer des droits et à remplir des devoirs, c’est ne rien dire tant que ces devoirs et ces droits ne sont point déterminés ; dire que leur détermination se trouve dans la conscience de chacun, c’est une erreur, une hypothèse démentie par tous les faits.
La vérité est que la détermination des droits et des devoirs devient plus exacte et plus complète à mesure que nous exerçons davantage notre raison ; que nous parvenons à mieux connaître toutes les conséquences bonnes ou mauvaises de notre conduite privée et collective, à mieux distinguer celles qui servent et celles qui nuisent à notre amélioration commune, à constater plus sûrement ainsi ce qui est de droit ou de devoir pour tous, enfin, à mieux lutter contre les obstacles qu’opposent à notre amélioration nos mobiles instinctifs, nos passions, notre ignorance, nos erreurs, l’ardeur de la domination chez les uns, l’inertie ou le défaut de courage chez les autres. Et n’est-il pas vrai que, par tout cela, nous augmentons la puissance générale de nos volontés, c’est-à-dire de notre liberté, dans la poursuite du but assigné à l’existence humaine ?
Dans l’ordre politique, enfin, la vraie notion de la liberté, celle qui la fait consister dans l’exercice de notre raison, soumettant de plus en plus à celle-ci toute notre conduite, ne ressort pas avec moins de certitude que dans l’ordre économique ou dans l’ordre moral.
Pour le reconnaître, il faut d’abord se demander quel est, chez les peuples civilisés de notre temps, l’objet réellement nécessaire de l’organisation politique ou de l’institution des gouvernements. La science économique affirme et prouve que cet objet est, essentiellement, de procurer à tous la sécurité indispensable à l’activité et à la fécondité des facultés productives et accumulatrices, en garantissant à chaque famille, à chaque individu, le libre exercice de ces facultés et la libre disposition des propriétés qui en sont le fruit, et cela, dans toute l’étendue des limites où leur activité ne porte aucune atteinte aux mêmes libertés chez d’autres. Elle démontre, ensuite, qu’au moyen de ces garanties, les lois économiques, inhérentes à la nature de l’homme et des choses, suffisent à placer l’activité des populations dans les meilleures directions que puisse comporter leur degré d’avancement industriel, intellectuel et moral. Elle démontre encore que ce degré d’avancement s’élève dans la mesure où le fonctionnement normal des lois économiques, lequel n’est autre que celui de la liberté de tous sous les garanties spécifiées, éprouve le moins de perturbations. Enfin, elle conclut de ces démonstrations que la mission utile et légitime des gouvernements, consistant principalement à instituer et à appliquer les garanties protectrices dont il s’agit, n’est nullement de diriger les développements des facultés et de l’activité des populations, ce qu’ils ne sauraient faire sans violer la liberté et la propriété de celles-ci, sans dénaturer ces développements et les écarter de la voie du perfectionnement général des facultés — celle des civilisations ascendantes. Il n’est pas aujourd’hui d’économistes, au niveau des connaissances acquises dans cet ordre d’investigations, qui ne soient entièrement convaincus de ces grandes et salutaires vérités.
Il faut, ensuite, rechercher quels sont les obstacles qui s’opposent à l’établissement et au maintien de ces garanties de la liberté et de la propriété, que notre imperfection morale rend et rendra probablement toujours indispensables aux sociétés.
Ces obstacles ne peuvent évidemment consister que dans l’insuffisance ou dans l’abus des forces destinées à assurer de telles garanties.
Il ne peut y avoir insuffisance que si les populations renferment une proportion très considérable d’individus disposés à porter atteinte, soit par la violence, soit par la fraude, à la liberté ou à la propriété d’autrui, et si les forces mises à la disposition des gouvernements ne sont pas réellement assez puissantes pour maîtriser ou réprimer ces tendances ou activités perturbatrices ; ou bien encore, si les forces protectrices, suffisantes en elles-mêmes, n’ont pas toute l’efficacité qu’elles pourraient avoir, faute d’une direction assez énergique et assez intelligente pour en tirer le meilleur parti possible.
Il y a abus — et c’est ici le cas de beaucoup le plus fréquent — lorsque les forces destinées à garantir la liberté et la propriété sont détournées de cette destination, en plus ou moins grande partie, par les hommes ou les gouvernements chargés de leur application ; lorsqu’ils s’en servent pour dominer, opprimer, exploiter les populations d’où ils les tirent et qui les entretiennent, ou pour satisfaire les convoitises, l’orgueil, les vanités, l’ambition des gouvernants. Dans de telles voies, ceux-ci ne se trouvent jamais investis d’assez de forces ; ils en accumulent le plus possible, en affaiblissant d’autant les forces productives, en les sacrifiant progressivement à la puissance et à l’action gouvernementales, en absorbant davantage la société dans l’État, et s’évertuant ainsi, qu’ils le sachent ou non, à déterminer autant qu’il dépend d’eux la décadence des civilisations.
Mais où faut-il chercher les moyens efficaces de triompher de ces obstacles à la liberté et à la prospérité des nations, de ces véritables et redoutables fléaux ?
Il est certain que ces moyens ne se trouvent pas ailleurs que dans un exercice énergique et soutenu de la raison individuelle, assurant, avec le temps, la prédominance des tendances qui accroissent la puissance générale de nos volontés et développent ainsi nos libertés, surtout celles qui font obstacle à ces progrès.
Ce n’est pas autrement que les populations — lorsque les obstacles viennent directement d’elles-mêmes, de l’empire exercé sur leur conduite par leurs instincts brutaux, dominateurs, cupides ou spoliateurs — peuvent acquérir les lumières nécessaires pour réfréner ces instincts, et pour bien comprendre cette vérité assez simple, que tous ne sauraient obtenir la libre disposition de leurs facultés et de leurs propriétés et se placer ainsi dans les seules conditions qui puissent assurer leur propriété et leur élévation commune, que si chacun en particulier s’impose le respect absolu de la même liberté chez les autres, ou du moins, si l’immense majorité est prête, au besoin, à imposer ce respect par la force à tous ceux qui seraient tentés de s’en écarter.
Ce n’est pas autrement non plus — lorsque les obstacles viennent des gouvernements, du détournement et de l’abus des forces mises à leur disposition pour garantir la liberté et la propriété — que les populations peuvent parvenir à se soustraire à ce fléau, et à se préserver de son retour. La propagation, généralisée le plus possible, des lumières déjà acquises sur ce sujet, et l’exercice incessant de la raison individuelle, sont les seuls moyens efficaces de dissiper l’ignorance et les erreurs, de maîtriser les instincts cupides ou dominateurs, qui ont favorisé ou provoqué jusqu’ici la persistance ou les développements de ces monstrueux abus.
Ce sont les seuls moyens de réussir à mettre au ban de l’opinion tout ce qui soutient de tels abus, — les ineptes animosités internationales, la gloire ou la fanfaronnade militaire, — les stupides et pernicieuses admirations pour toutes les fausses grandeurs, — pour l’éclat ou le faste dont s’entourent les gouvernements dilapidateurs des ressources communes, pour cette classe d’hommes que les poètes, les historiens, les intérêts pervers et la niaiserie générale ont faits grands, parce qu’ils ont pu faire litière à leur orgueil de la liberté, de la dignité, du sang et des ressources des nations.
Ce sont, enfin, les seuls moyens de parvenir à renfermer les gouvernements dans leur mission nécessaire et légitime, en les dépouillant de toutes les attributions qu’ils ont usurpées aux dépens de la liberté générale.
On peut placer ici la démonstration donnée par Charles Comte, que la liberté collective consiste dans la suppression de toutes les conditions concourant à fonder l’esclavage ou la servitude ; conditions qui, de notre temps, sont surtout celles donnant aux hommes investis du pouvoir politique, en dehors et au-delà de leur mission nécessaire, la domination des volontés et la direction de l’activité des populations.
Mais une vérité qu’il importe de mieux comprendre qu’on ne le fait communément en France, c’est qu’il faut nécessairement que les erreurs que nous venons de rappeler soient dissipées, puis remplacées dans les esprits par les lumières opposées, et qu’un tel changement soit devenu assez général pour fonder une opinion dominante avant que les conséquences de ces progrès de la raison commune puissent se réaliser et se maintenir dans les faits. Jusque-là, le mécontentement public pourra susciter de nouvelles révolutions, renverser des gouvernements, en établir d’autres ; mais à quelque forme ou organisation que l’on arrive, l’abus des forces gouvernementales continuera à se développer, dans une direction ou dans l’autre, tant que l’on n’aura pas arraché les racines qu’il a implantées dans l’ignorance, les erreurs ou les enseignements trompeurs régnant encore dans la pensée du grand nombre :La fréquence de nos révolutions et contre-révolutions depuis 1789, et les résultats qui les ont suivies, suffiraient pour nous édifier à cet égard, si, par une disposition funeste de notre esprit national, nous ne nous étions pas si souvent montrés, en politique, incapables de profiter des enseignements de l’expérience.
Dans tous les cas, nous espérons que l’on reconnaîtra facilement, qu’ici encore, la liberté n’existe et ne se développe que par l’exercice de la raison, dans la mesure des lumières que cet exercice nous fait acquérir, et où ces lumières, dirigeant plus entièrement nos mobiles instinctifs et toute notre conduite, rendent de plus en plus difficilement praticable l’abus des forces gouvernementales, en le montrant clairement aux esprits partout où il se produit, et en soulevant contre lui tous les intérêts légitimes qui en souffrent.
L’expérience donne, d’ailleurs, à cette conception de notre liberté, la confirmation la plus éclatante : De nos jours, les populations les plus libres et les plus prospères sont généralement celles qui ont le plus facilité, encouragé ou provoqué l’exercice de la raison, soit en religion, soit en politique ; ce sont les populations protestantes de l’union américaine, de la Hollande, de l’Angleterre, d’une partie de la Suisse, de la Belgique et de l’Allemagne. Les civilisations les moins libres et les plus arriérées sont celles où l’exercice de la raison a été le plus proscrit, le plus limité ou entravé, par la foi religieuse, l’autorité civile ou ecclésiastique, — celles de la Turquie, de la Russie, de l’Espagne, de l’Amérique espagnole, etc.
Telle est donc bien, tout le démontre, la véritable notion de la liberté, et l’on ne pourrait que s’égarer en cherchant à s’en former une autre.
II. — L’AUTORITÉ.
Il n’y a pas moins de diversités, de disparates et de confusions dans les acceptions données au mot autorité, ou dans les notions qu’il rappelle aux différents esprits, que dans celles rattachées au mot liberté : Si, en général, il réveille à la fois l’idée de droits de commandement chez les uns, et celle de devoirs d’obéissance chez les autres, on cesse de s’entendre ou de s’accorder dès qu’il s’agit de déterminer à qui incombent ces droits et ces devoirs, et quelles en sont la nature, les applications légitimes et les limites.
On peut distinguer trois genres d’autorité :
1° Celle du chef de la famille, nécessitée par les conditions impérieuses de notre existence et de nos premiers développements, autorité que les lois civiles des différents peuples ont sanctionnée en l’étendant ou la limitant plus ou moins, et que nous nous bornerons ici à mentionner, pour ne pas trop étendre le cadre de cette étude.
2° L’autorité religieuse, dans laquelle il importe de distinguer, d’une part celle attachée par la foi, la persuasion — sans aucun emploi de la contrainte — soit à des symboles et à des commandements donnés comme inspirés ou révélés par Dieu même, soit à des conceptions de la raison, où l’on croit reconnaître les seuls rapports vrais, ou vraisemblables, existant entre l’humanité et la suprême intelligence qui régitl’univers, et, d’autre part, l’autorité imposée par les ministres d’une religion à l’aide du mensonge ou de la force.
3° L’autorité politique ou civile, dans laquelle il importe aussi de distinguer l’autorité expressément et constamment conventionnelle, la seule légitime ou fondée sur le droit, sur l’intérêt commun ou social ; et l’autorité imposée par la violence ou la fraude, sans caractère conventionnel ou n’offrant, sous ce rapport, que d’illusoires apparences.
Dans la situation actuelle de la plupart des États de l’Europe, l’autorité religieuse s’associe plus ou moins entièrement à l’autorité politique imposée, afin d’en obtenir, en lui prêtant son appui, les moyens de s’imposer à son tour.
La notion de la liberté, telle que nous l’avons formulée, et celles fournies par la science économique sur ce qui constitue principalement la mission nécessaire des gouvernements, élucident et simplifient singulièrement toutes les questions d’autorité, ce qui n’est pas l’une des moindres preuves de la vérité de ces notions.
S’il est vrai que notre liberté ne se développe que par l’exercice de la raison, et que cet exercice soit notre unique moyen de perfectionner nos facultés, d’en accroître la puissance utile, et par là, d’améliorer et d’élever la vie humaine sous tous les rapports, il sera difficile de voir, dans toute autorité imposée, qu’elle soit religieuse ou politique, autre chose qu’un déplorable obstacle à la poursuite efficace de cet indéniable but de notre existence en ce monde ; car, de semblables autorités ne peuvent s’exercer qu’en sacrifiant, à l’égard de tout ce qu’elles prétendent régir impérativement, la raison et la liberté de ceux qui les subissent, en les privant à cet égard de ce qui est à la fois pour eux un droit et un devoir, de ce qui constitue essentiellement leur qualité d’hommes, c’est-à-dire, d’êtres libres et perfectibles par leurs propres efforts, privations qui sont l’essence, le principe même de l’esclavage, et l’on sait aujourd’hui, par de longues et douloureuses expériences, que l’esclavage place inévitablement ceux qui l’imposent, comme ceux qui le supportent, dans la voie de toutes les dégradations intellectuelles et morales.
Et s’il est vrai encore, que la mission nécessaire des gouvernements consiste principalement à procurer sécurité à tous, en garantissant contre toute atteinte la liberté et la propriété de chacun, et qu’ils ne peuvent s’attribuer la direction du développement des facultés et de l’activité des populations, sans violer positivement la liberté et la propriété qu’ils sont chargés de garantir, il en résulte évidemment qu’ils n’ont à exercer qu’une autorité déléguée et strictement conventionnelle, — s’appliquant à des objets déterminés, — constamment modifiable et révocable par les sociétés qui les concèdent, — ne pouvant, sans usurpation, tirer d’elle-même aucune extension, — telle en un mot que celle confiée, avec les moyens d’exécution nécessaires, à tout mandataire chargé d’une mission spéciale. Toute autorité politique ne se renfermant pas scrupuleusement dans ces conditions, cesse d’être légitime et devient une domination, pouvant se maintenir par la force, mais non s’appuyer sur aucun droit réel ; car, hors de la famille, il n’y a pas d’autorité, de droits de commander ou de gouverner, naturellement attachés à l’homme; s’il y en avait, il faudrait les reconnaître chez tous également, ou justifier pourquoi et à quel titre surhumain, de tels droits se trouveraient chez quelques-uns et non chez les autres ;
Le droit qu’un esprit ferme et vaste en ses desseins
A sur l’esprit grossier des vulgaires humains,
est une force ; mais ce n’est pas un droit ; à moins que l’on ne veuille répudier l’axiome affirmant que force ne fait pas droit.
Ainsi, en droit théorique, il n’y a d’autorité légitime que celle expressément déléguée et conventionnelle.
Quant à l’autorité religieuse, elle ne peut déterminer que des obligations morales et purement volontaires chez les croyants, et si, pour obtenir l’accomplissement de ces obligations chez ceux dont la volonté s’y refuse, des hommes emploient la force ou la contrainte, ce ne peut être que par une autorité usurpée, par une violation manifeste de la liberté et de la raison attachées à notre nature.
L’expérience confirme pleinement que ces notions sur l’autorité sont les seules conformes au droit, à l’intérêt commun des hommes, au véritable but de leur existence en cette vie ; mais l’indication de la masse des faits appuyant cette assertion ne pouvant trouver place ici, nous nous bornerons à reproduire quelques-unes des observations que nous avons présentées ailleurs, en traitant de l’autorité religieuse imposée.
« Encore une fois, l’homme ne vaut que par l’esprit, et l’esprit ne vaut que par l’exercice, par l’activité que nous lui donnons ; comme nos forces physiques, comme la vigueur et l’agilité de nos membres, il est sujet à être frappé par l’inaction d’engourdissement et d’impuissance ; et s’il n’est rien de mieux constaté, est-il possible de méconnaître combien ses développements sont empêchés, arrêtés, par une croyance tendant expressément à rendre son activité purement passive, lui interdisant toute initiative, tout libre examen relativement à l’ensemble des choses qui l’intéressent le plus, lui faisant une loi impérieuse, sacrée, de suivre à cet égard des enseignements stéréotypés, immuables, ou ne pouvant être modifiés que par la volonté de certains hommes s’arrogeant la mission de lui tracer toutes ses voies ? N’est-ce pas là la tendance, la condition principale de l’esclavage, et faut-il s’étonner qu’elle ait produit des résultats analogues, c’est-à-dire la paralysie partielle, l’oblitération des facultés chez les populations qui l’ont subie ? Si la civilisation se montre stationnaire ou rétrograde partout où prévaut l’autorité religieuse, tandis qu’elle est ascendante partout où prévaut la liberté des croyances et des cultes, n’est-ce pas par les mêmes raisons qui font qu’en descendant l’Ohio on voit sur la rive gauche, dans un sol désert, à peine défriché sur quelques points, les résultats de l’esclavage, tandis que sur la rive droite, la richesse des cultures, les signes multipliés d’une industrie active et prospère, montrent les bienfaits de la liberté ? »
« Si nos sociétés du Moyen-âge sont restées pendant des siècles aussi stationnaires à peu près que celles de l’Asie, ne doit-on pas l’attribuer surtout à la compression exercée sur les esprits par le régime de la foi imposée ? Si, depuis trois siècles seulement, les peuples chrétiens, devançant tous les autres, se sont rapidement élevés à un degré de civilisation qui désormais paraît devoir leur assurer l’empire du monde, ce mouvement ascendant n’est-il pas précisément contemporain de l’avènement des doctrines du libre examen ? Et n’est-il pas avéré que, parmi les peuples chrétiens, ceux qui ont le plus contribué à tous les progrès civilisateurs, sont précisément ceux qui, dans cette période de trois siècles, ont le mieux assuré leurs libertés religieuses, civiles et politiques contre les usurpations de l’autorité ? Et s’il n’est pas, dans l’ensemble des enseignements historiques, de faits généraux plus éclatants, plus incontestables que ceux-là, en est-il de plus convaincants [6]. »
Nous osons affirmer que, plus la raison individuelle s’exercera sur ces questions, et plus la vérité des notions que nous avons exposées, tant sur la liberté que sur l’autorité, sera généralement reconnue.
Mais nous ne nous dissimulons point que, dans l’état actuel des esprits façonnés par les enseignements universitaires, ces vérités ont peu de chances d’être accueillies autrement que comme d’insoutenables paradoxes ; tandis que, de leur côté, les esprits qui s’en sont pénétrés ne peuvent plus reconnaître, dans la généralité des théories sur l’autorité, empreintes des méthodes et des doctrines officielles, qu’une phraséologie le plus souvent inintelligible ou vide de sens.
Ce qui prévaut dans ces théories, même quand elles sont exposées par des publicistes distingués et libéraux, c’est que la liberté et l’autorité sont deux conditions également indispensables à la vie sociale, non seulement distinctes, mais séparées et même opposées ou en lutte l’une avec l’autre, dont le rapport normal est dans un juste équilibre, variable dans ses éléments, selon le degré de civilisation atteint par les sociétés, — l’autorité devant s’étendre en restreignant la liberté, en raison de ce que les populations sont moins éclairées, et se restreindre en étendant la liberté, à mesure qu’elles acquièrent plus de lumières.
C’est encore, que l’autorité légitime ne serait pas simplement, comme nous le soutenons, une force instituée et entretenue par les sociétés, pour l’accomplissement de services conventionnellement déterminés ; mais bien une puissance supérieure aux sociétés, une TUTELLE (c’est le mot consacré), puisant en elle-même le droit de les guider, de les régir, en tout ce qu’elles lui paraissent incapables d’accomplir librement, et ne devant se départir d’un tel droit que dans la mesure où les populations deviennent, par le bienfait de cette tutelle, plus aptes à se bien diriger elles-mêmes [7].
Nous ne remonterons pas aux sources de ces notions sur l’autorité, attribuant fort gratuitement aux hommes qui l’exercent une grande supériorité de lumières et de vertus sur la société d’où ils sortent, notions écloses sous un enseignement en tutelle, et qui se ressentent évidemment de la bonne opinion que le tuteur a toujours eue de lui-même. Il nous paraît du reste à peine nécessaire, après tout ce qui a été dit plus haut, de faire ressortir ce que de telles doctrines ont de faux et de contraire au véritable droit.
D’abord il n’est pas vrai qu’il y ait opposition, ni même séparation, entre la liberté et l’autorité légitime ; lorsque celle-ci remplit sa mission nécessaire, sans la dépasser, elle ne restreint nullement la liberté ; elle l’étend, au contraire, d’autant plus sûrement qu’elle parvient à mieux la garantir à tous ; elle est la condition indispensable de la liberté, qui ne pourrait la répudier, ou s’en séparer, sans perdre toute garantie efficace et se détruire elle-même.
Ensuite, rien n’est plus faux et plus décevant que la notion attribuant à l’autorité légitime le caractère d’une tutelle, et lui assignant de la sorte la mission de diriger plus ou moins, selon ses vues, le développement des facultés et de l’activité des populations, ce qu’elle ne peut faire, nous l’avons assez souvent prouvé, sans violer expressément la liberté et la propriété qu’elle est chargée de garantir. Nous répéterons ici que l’autorité légitime ne peut être qu’une force entretenue par les sociétés pour l’accomplissement de services déterminés, services toujours modifiables, ainsi et chaque fois qu’elles le désirent ; et l’on ne dira pas que ce sont là des conditions irréalisables, car depuis quatre-vingts ans, elles n’ont pas cessé d’être régulièrement pratiquées dans tous les États du nord de l’Union américaine. Les citoyens de ce pays ne supporteraient pas du tout qu’on les considérât comme les pupilles des hommes à qui ils confient la mission assignée à leur autorité publique, et c’est ce qui explique l’ouragan de huées déchaîné par la sotte prétention du président Johnson [8], osant leur parler de sa politique.
Nous sommes loin sans doute, en France, d’être arrivés à cette fière appréciation de nos droits. Y parviendrons-nous un jour ? Il faudrait en désespérer si, à l’heure qu’il est, nous étions encore assez naïfs pour attendre notre liberté et notre avancement social de la tutelle exercée sur nous par nos gouvernements.
Au surplus, d’assez vives lumières se sont produites, dans ces derniers temps, sur les sujets qui nous occupent, et les esprits qui ont pu se les assimiler ne doivent pas renoncer à l’espoir de les voir se répandre de plus en plus. Que chacun de ceux qui partageraient les convictions que nous avons exposées s’efforce de les communiquer par tous les moyens en son pouvoir ; elles arriveront certainement un jour à former une opinion assez puissante pour les réaliser dans les faits. En attendant, ayons patience et souvenons-nous que si, par la nature des choses, la lumière intellectuelle met autant de lenteur à se propager que la lumière physique y met de rapidité, elle a l’avantage, une fois acquise, de ne plus se perdre et d’amener, avec le secours du temps, le triomphe des vérités qu’elle signale sur toutes les erreurs en lutte avec elle.
Ambroise CLÉMENT.
_____________
[1] Voltaire, Les oreilles du comte de Chesterfield.
[2] L’État et ses limites, pages 1 et 2.
[3] Nous tentons plus loin d’établir avec précision le sens philosophique du mot liberté ; mais bien des obscurités ont été répandues sur la question par la prétention de concilier la liberté avec la prescience divine, et nous croyons devoir essayer ici de les dissiper.
On a dit, à l’appui de cette prétention, que, devant Dieu, le passé, le présent et l’avenir ne sont qu’un, et que, voyant ainsi tout à la fois, ce n’est pas parce qu’il voit les actes de notre conduite que nous les accomplissons, mais bien parce que nous les accomplissons qu’il les voit. On a dit ensuite : la prescience de Dieu est certaine et s’étend à tout, car il n’y a pas de limite à son pouvoir ; d’un autre côté, nous ne pouvons douter de notre liberté, dont nous usons à chaque instant, et si la chaîne des raisonnements qui lient ces deux vérités échappe à la faiblesse de notre entendement, nous ne saurions être autorisés, pour cela, à nier l’une ou l’autre. On a dit, enfin, que la prescience divine n’est que la prévoyance élevée à son plus haut degré de puissance, et que, si nous prévoyons souvent nous-mêmes la conduite d’un individu, dont les mobiles et le caractère nous sont connus, sans que sa liberté soit en rien altérée par une telle prévision, nous ne saurions valablement contester qu’il en soit de même de la prévoyance infinie, et qu’elle puisse s’étendre à la conduite de tous les hommes, sans qu’il en résulte qu’ils n’aient plus leur liberté.
C’est par de tels sophismes que l’on prétend faire admettre à notre intelligence deux propositions qui s’excluent avec une évidence pour ainsi dire palpable.
Que de prétentieux et vains rabâchages de mots, vides de toute idée nette, sur la durée et l’étendue, sur l’absolu et le relatif, ou le fini et l’infini, aient amené à affirmer que la succession des temps n’existe pas pour l’intelligence divine, c’est là une assertion qui nous a toujours paru aussi téméraire que dépourvue de fondement réel ; mais, en tout cas, ce qui est bien certain, c’est que le passé, le présent et l’avenir ne sauraient se confondre pour nous ; or, si dès avant ma naissance Dieu a vu ce que je ferais durant ma vie, il est parfaitement clair, pour mon entendement et pour celui de tout autre homme, que je ne pourrais faire autre chose sans mettre sa prévision en défaut, et si je ne puis faire autre chose que suivre la ligne prévue, ordonnée, par conséquent immuablement fixée d’avance sans ma participation, il est également clair, et absolument indubitable, que je n’ai pas le pouvoir, que je ne suis pas libre de m’en écarter.
La chaîne des raisonnements qui nous échapperait n’est ici qu’une supposition tout à fait inadmissible ; car, les lois et les notions les plus sûres de notre entendement nous garantissent, précisément avec la même certitude que celle offerte par les vérités géométriques, qu’il n’y a point de chaîne de raisonnements capable de lier deux propositions parfaitement contradictoires et s’excluant absolument l’une l’autre.
Enfin, la prévision divine n’est nullement assimilable à notre prévoyance, non pas seulement parce que celle-ci est faillible, mais parce qu’elle ne peut s’appliquer qu’aux conséquences, expérimentalement connues, de causes déterminées — causes et conséquences que nous n’avons point ordonnées nous-mêmes — ; tandis qu’il ne saurait y avoir, dans la prescience divine, absolument rien qui n’ait été voulu, combiné et arrêté par le suprême Ordonnateur, qui est bien ainsi le véritable et l’unique auteur de tout ce qui n’échappe pas à sa prévision infaillible ; en sorte que, s’il n’eut expressément décidé que notre conduite serait, en partie, soustraite à de telles conditions, cette conduite ne pourrait être autre chose que l’accomplissement de ses propres volontés, et que, dès lors, nous ne saurions plus être, à aucun titre, ni libres, ni responsables.
Mais les arguties dont nous venons de montrer la complète inanité, et dans lesquelles se résument tous les efforts accomplis pour incliner notre esprit à admettre à la fois la liberté et la prescience divine, ou plutôt la prédestination, sont-elles bien dignes de la raison et d’une réfutation sérieuse ? De telles subtilités doivent-elles être qualifiées autrement que comme de blâmables abus de la plus élevée des facultés que nous ayons reçues de Dieu ?
Ce que la raison, ou même le simple bon sens, nous indiquent véritablement ici, c’est que la suprême Intelligence dont le monde est tout empreint — quelque imparfaites que puissent être, sur un tel sujet, les notions accessibles à notre faiblesse — ne saurait avoir des volontés contradictoires ; qu’elle n’a pu vouloir, en même temps, donner la liberté aux hommes et la leur retirer ; qu’en conséquence, en la leur donnant, en leur faisant ainsi une part dans le gouvernement de leur conduite — la part soumise à leur propre intelligence — elle a indubitablement renoncé à ordonner et à prévoir l’usage qu’ils en feraient, puisque le don de la liberté ne saurait être réel sans cette condition, et qu’il suffirait, bien évidemment, que l’usage d’un tel don eût été prévu et invariablement fixé, avant même que nous fussions appelés à la vie, pour l’anéantir complètement.
Un cercle est une circonférence dont tous les points sont également éloignés du centre ; s’il n’en est pas ainsi, ce n’est plus un cercle.
La liberté de l’homme, dans les limites qui lui sont assignées, est une initiative attribuée à sa personnalité, indéterminée d’avance et laissée à sa propre volonté ; s’il en est autrement, ce n’est plus la liberté.
Au surplus, personne assurément ne voudrait soutenir qu’en nous douant de cet attribut merveilleux à un degré incomparablement supérieur, relativement aux traces que nous pouvons en observer chez les animaux, Dieu ait voulu le subordonner à des conditions qui, ne permettant pas que notre volonté fût substituée à la sienne, en rien de ce qui concerne notre conduite, le rendraient parfaitement illusoire et devraient nous affranchir de toute responsabilité à l’égard de cette conduite, puisque, encore une fois, elle serait entièrement et immuablement ordonnée par sa seule volonté.
[4] De la liberté du travail, t. I, p. 23 à 43.
[5] Traité de la propriété, t. I, ch. II et III.
[6] Essai sur la science sociale, 3e partie, t. II, p. 321-322.
[7] Voir dans le Dictionnaire général de la politique, au mot AUTORITÉ, un écrit de M. Jules Simon, exposant cette théorie.
[8] Andrew Johnson, président des États-Unis de 1865 à 1869. (B.M.)


Laisser un commentaire