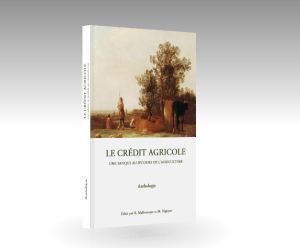 Vers 1850, l’agriculture française restait profondément archaïque, fonctionnant encore dans une logique quasi-autarcique et avec des moyens limités. Manquant de compétitivité, dépassée par les grandes puissances comme l’Angleterre, elle était aussi confrontée à la concurrence croissante de « pays neufs » comme les États-Unis, la Russie ou l’Argentine, qui offraient des productions agricoles à bas prix et s’infiltraient sur les marchés européens. Ce constat, terrible, s’offrait à l’attention de tous les hommes politiques.
Vers 1850, l’agriculture française restait profondément archaïque, fonctionnant encore dans une logique quasi-autarcique et avec des moyens limités. Manquant de compétitivité, dépassée par les grandes puissances comme l’Angleterre, elle était aussi confrontée à la concurrence croissante de « pays neufs » comme les États-Unis, la Russie ou l’Argentine, qui offraient des productions agricoles à bas prix et s’infiltraient sur les marchés européens. Ce constat, terrible, s’offrait à l’attention de tous les hommes politiques.
L’agriculture, reconnaissait-on alors, avait besoin d’être modernisée, d’être poussée par le progrès technique, qui seul pouvait permettre d’accroître les rendements et d’augmenter la production agricole totale. Pour cela, la bonne volonté des cultivateurs ne pourrait suffire : il fallait des financements, des capitaux. Au milieu du siècle, Frédéric Bastiat soulignait que pour dynamiser l’agriculture, « ce qui a manqué, ce qui manque encore, c’est le capital » et précisait que tous les agronomes partageaient cet avis. À la même époque, son collègue Michel Chevalier, professeur d’économie politique au Collège de France, insista dans son cours sur le fait que « l’agriculture est une sorte de manufacture qui exige des capitaux ».
S’il aura fallu attendre 1894 pour aboutir à la mise en place de structures adaptées au crédit agricole en France, la raison est à trouver dans l’opposition insoluble entre les partisans de l’initiative individuelle et les adeptes de l’intervention étatique. Sous le titre de Le crédit agricole : une banque au secours de l’agriculture, une anthologie, reprenant les débats des économistes de l’époque pendant un demi-siècle, présente ces visions concurrentes et offre une illustration de leurs mérites comparés.
Nous en publions ici l’introduction complète, qui couvre les pages 7 à 21. B. M.
INTRODUCTION
Rares sont les mots qui, dans le langage de la science économique, ont déchainé autant de critiques, de sarcasmes et de haines, que celui-ci : capital. Le capital, entend-t-on souvent, appauvrit le travailleur, il participe à sa déshumanisation, le spolie et le meurtrit, bref, il est l’ennemi irréductible des peuples. Cette opinion, ou plutôt ce préjugé, qui subsiste à l’état d’axiome dans une certaine presse et une certaine blogosphère d’extrême gauche, a une origine lointaine. Déjà John Law, au début du XVIIIe siècle, aurait eu l’ambition d’émanciper les travailleurs de la tyrannie du capital, en instituant son système de banque puis de monnaie à cours forcé. [1] Mais le siècle des Lumières resta globalement insensible à cette idée : les Physiocrates célèbreront les vertus du capital, qu’il prenne la forme d’avances foncières, d’avances primitives ou de fonds de salaire, et Turgot ira même plus loin, en attribuant au capital un rôle central dans l’enrichissement des nations. [2] Malgré Jean-Baptiste Say, en début de XIXe siècle, qui poursuivit dans la même voie et soutenait que « tout accroissement de capital prépare un gain annuel et perpétuel, non seulement à celui qui a fait cette accumulation, mais à tous les gens dont l’industrie est mise en mouvement par cette portion du capital »[3], la critique du capital s’est développée vigoureusement au cours du XIXe siècle, se montrant dans tous les débats politiques du temps.
Si c’est naturellement dans la discussion des lois sociales que cette haine fondamentale vis-à-vis du capital apparaîtrait le plus explicitement, elle a également joué un rôle central dans l’émergence des banques agricoles. Nous verrons dans la suite de cette introduction qu’au milieu du XIXe siècle l’agriculture française souffrait dangereusement, n’étant ni assez moderne ni assez productive pour soutenir la concurrence nouvelle de pays comme la Russie ou les États-Unis. La solution qui se présenta naturellement à l’esprit des agronomes et des économistes était simple : l’agriculture ne se modernisera qu’avec du capital, permettant au cultivateur ou au propriétaire d’investir. Seulement, on entendit : le capital, c’est le mal ! c’est la ruine ! c’est la domination des riches sur les pauvres ! Freiné par ces considérations décisives, le crédit agricole mit près d’un siècle à émerger dans notre pays.
Dans la présente introduction, c’est cette histoire que nous tâcherons d’esquisser, avant que l’anthologie d’écrits économiques de l’époque ne vienne l’illustrer plus complètement. Nous verrons successivement pourquoi l’agriculture française avait foncièrement besoin de capital, et non d’autre chose, puis sous quelles formes concurrentes se présentèrent les premiers projets de crédit agricole et quelle fut la position des grands économistes à leur égard. Nous finirons par un bref résumé de chacune des contributions compilées dans notre Anthologie.
1. LE CRÉDIT, UN BESOIN POUR L’AGRICULTURE
Vers le milieu du XIXe siècle, l’agriculture française restait profondément archaïque, fonctionnant encore dans une logique quasi-autarcique et avec des moyens limités. Manquant de compétitivité, dépassée par les grandes puissances comme l’Angleterre, elle était aussi confrontée à la concurrence croissante de « pays neufs » comme les États-Unis, la Russie ou l’Argentine, qui offraient des productions agricoles à bas prix et s’infiltraient sur les marchés européens. Ce constat, terrible, s’offrait à l’attention de tous les hommes politiques.
L’agriculture, reconnaissait-on alors, a besoin d’être modernisée, d’être poussée par le progrès technique, qui seul peut permettre d’accroître les rendements et d’augmenter la production agricole totale. Pour cela, la bonne volonté des cultivateurs ne pourra suffire : il faut des financements, des capitaux.
Sur ce point, l’unanimité des économistes ainsi que des agronomes fut complète, et cela très tôt. Au milieu du siècle, Frédéric Bastiat soulignait que pour dynamiser l’agriculture, « ce qui a manqué, ce qui manque encore, c’est le capital » et précisait que tous les agronomes partageaient cet avis. [4] À la même époque, son collègue Michel Chevalier, professeur d’économie politique au Collège de France, insista dans son cours sur le fait que « l’agriculture est une sorte de manufacture qui exige des
capitaux ». [5]
À partir de 1850, plusieurs enquêtes lancées par les pouvoirs publics vont venir inlassablement prouver la pénurie des capitaux dans l’agriculture, les dommages qu’elle cause à la production agricole française, et la supériorité de plusieurs de nos voisins européens en la matière. Le constat est alors que l’agriculture peine à obtenir des capitaux et que ceux-ci se dirigent vers les villes où le développement industriel leur offre de meilleures perspectives.
Les causes en sont multiples, et avant d’indiquer les réponses des économistes et leurs projets de crédit agricole, nous pouvons rassembler ces causes sous deux grandes catégories.
D’abord, le crédit, tel qu’il était pratiqué alors, ne convenait pas à l’agriculture. Dans son ouvrage classique sur les origines du crédit agricole, Madeleine Degon liste trois principales raisons. [6] La première, c’est que les prêts à court terme sont peu avantageux aux agriculteurs, car l’agriculture se caractérise d’abord par la lenteur de la reconstitution du capital investi. La rotation du capital est trois fois plus lente dans l’agriculture que dans l’industrie. La deuxième, c’est que les emprunts sont chers, les agriculteurs travaillant sur des exploitations de petite taille n’offrant que peu de garanties tangibles. La troisième, enfin, c’est que le banquier doit être nécessairement réticent à prêter à un homme qu’il ne connait pas, ou qu’il connait mal : la banque est loin des terres de l’agriculteur et celui-ci ne considérera pas le banquier comme un partenaire naturel, préférant s’adresser au notaire ou au prêteur local.
Ensuite, des contraintes d’ordre légal s’ajoutent à ces difficultés : la juridiction spéciale appliquée à l’agriculture (absence de mise en faillite ou de contrainte par corps) fait que les prêteurs sont plus intéressés à prêter à l’industrie ou au commerce. Le nantissement était une pratique courante dans l’industrie ou le commerce, mais son application à l’agriculture posait encore problème à l’époque, du fait que le stock mis en garantie prenait la forme de denrées périssables.
En proposant leurs idées sur le crédit agricole, les économistes tâcheront de répondre à ces deux types de difficultés.
2. QUEL CRÉDIT AGRICOLE : LES DÉBATS THÉORIQUES
En France, les débats théoriques sur le crédit agricole remontent à longtemps, puisque c’est à Colbert, au XVIIe siècle, qu’on attribue généralement la primauté en la matière. Dans son Testament politique, il indiqua les mérites et le besoin d’un crédit spécifique pour l’agriculture. Au siècle suivant, la question du crédit agricole continua à être l’objet de réflexions, et comment ne l’aurait-elle pas été, quand une école de pensée, la Physiocratie, faisait de l’agriculture le centre de ses préoccupations ? Les Physiocrates, disciples de François Quesnay, soutinrent que l’agriculture ne peut prospérer qu’avec des avances de capitaux, et qu’elle prospère en fonction du montant de ces capitaux. Credo fondamental de l’école, il est énoncé dès avant sa formation par Quesnay, qui écrit en 1756 qu’ « il n’y a point d’homme qui ne sache que les richesses sont le grand ressort de l’agriculture et qu’il en faut beaucoup pour bien cultiver ». [7] Quelques années plus tard, son bras droit, le marquis de Mirabeau, renchérit : « L’argent est le plus indispensable fumier qu’on puisse répandre sur la terre. » [8] Cette thèse se diffuse ensuite dans toutes les sphères intellectuelles du siècle des Lumières : on la retrouve sous la plume de Diderot, dans l’article « Laboureur » de l’Encyclopédie, ainsi que chez l’abbé Morellet, qui écrit avec conviction que « l’agriculture a besoin de capitaux, et de grands capitaux. » [9] Toutefois, ces prises de positions ne sont accompagnées d’aucune proposition de réforme législative ou de création d’institution spéciale. C’est au XIXe siècle que devait revenir l’honneur de faire émerger la question de la création du crédit agricole.
Il faut attendre les années 1840 pour que les débats deviennent plus sérieux, où la question du crédit agricole intéresse et divise en effet. Des projets sont émis, et le pouvoir n’y reste pas insensible. En 1843, le ministre Cunin-Gridaine envoie un inspecteur en Allemagne pour y étudier le crédit à l’Agriculture. Deux ans plus tard, on organise un Congrès agricole central, dans lequel Louis Wolowski, en particulier, défend le crédit agricole et met en avant le besoin de réformer la législation relative à l’agriculture, pour permettre aux prêteurs de soutenir les agriculteurs en toute confiance. Les oppositions sont cependant déjà nombreuses. André Marie Dupin, ancien président de la Chambre des Députés et désormais procureur général à la Cour de Cassation, s’oppose à l’idée du développement d’un crédit strictement agricole, pour la raison que, selon lui, « le crédit ne se divise pas, il est un ; il n’y a pas le crédit agricole, il y a le crédit. » [10]
Dans ces débats, les partisans de l’intervention de l’État font face aux libéraux plus ou moins radicaux. Les premiers entendent se servir de la puissance publique pour mettre en place le crédit agricole. Adolphe Billette, par exemple, veut faire partager à sa banque agricole le privilège d’émission avec la banque de France. D’Esterno va plus loin en demandant la création d’un banque d’État chargée du crédit agricole. Un contrôle plus léger de l’État est proposé par Léon Say en 1882, mais sans succès. Tous les projets de ce type échouent finalement, parce que la Banque de France n’entend pas partager son monopole et qu’elle possède des défenseurs hauts placés.
Dans les débats, les libéraux offrent quant à eux plusieurs avis dissemblables. Pour certains, le crédit agricole est un non sens car il n’existe que le crédit, le crédit en général, commun pour tous les usages. Selon d’autres, et en fait la majorité, il faut laisser la liberté d’action aux banques existantes et futures, leur permettant d’organiser un crédit agricole sans loi spéciale autres que celles facilitant l’initiative privée, et surtout sans banque publique ou privilégiée.
En 1846, Frédéric Bastiat aborde la question dans un article au Journal des Économistes. Tout en insistant sur le besoin pressant de capital qu’a l’agriculture française et la supériorité de l’Angleterre à cet égard, il entend contrer les propositions récentes d’institutions nouvelles de crédit à l’agriculture. Selon lui, si les banques agricoles sont ordonnées et instituées par la loi, elles seront funestes aux agriculteurs. Il écrit :
« D’autres ont imaginé des banques agricoles, des institutions financières qui auraient pour résultat de mobiliser le sol et de le faire entrer, pour ainsi dire comme un billet au porteur, dans la circulation. — Il y en a qui veulent que le prêt soit fait par l’État, c’est-à-dire par l’impôt, cet éternel et commode point d’appui de toutes les utopies.
[…] Déplacer les capitaux, les détourner d’une voie pour les attirer dans une autre, les pousser alternativement du champ à l’usine et de l’usine au champ, voilà ce que la loi peut faire ; mais il n’est pas en sa puissance d’en augmenter la masse, à un moment donné ; vérité bien simple et constamment négligée. » [11]
Ce que Bastiat reproche donc aux inventeurs de crédit agricole, si l’on ose le mot, c’est de se faire des promoteurs d’institutions factices, énièmes rejetons de la puissance publique dans ses ambitions d’intervention totale dans l’économie. Ces projets sont funestes mais aussi inutiles, en ce qu’ils forcent les capitaux à soutenir l’agriculture, plutôt que de les laisser suivre leur pente naturelle. Bastiat n’en admet pas moins que l’agriculture a besoin de capitaux et qu’il est problématique que l’industrie capte tout le crédit en France. Cependant, employer des moyens artificiels lui apparaissait d’autant plus malavisé que le phénomène avait justement une cause artificielle, à savoir le protectionnisme, qui, sous forme de loi, favorisait l’industrie aux dépens de tout le reste et notamment de l’agriculture.
Personne n’arrivant à se mettre d’accord — les propositions nouvelles étant lancées et aussitôt refusées — des enquêtes sur les pratiques étrangères se poursuivirent. Léonce de Lavergne, économiste libéral et surtout grand connaisseur de l’agriculture, fut chargé de conduire l’une de ces enquêtes en 1853, avec mission précise d’étudier les institutions du crédit agricole de l’Angleterre, de l’Allemagne, du Danemark. Dans un livre reprenant ses conclusions, Lavergne défendit le modèle anglais, fondé sur la liberté et l’immunité du cultivateur. « Depuis cent soixante ans, expliqua-t-il, les nobles institutions qui défendent la liberté et la sécurité des propriétés, ont régné sans interruption, et depuis cent soixante ans la prospérité les accompagne. » [12]
À cette première époque, l’influence des exemples étrangers sur le débat français est palpable. Ces exemples sont surtout mobilisés par le camp des libéraux, puisqu’ils paraissent surtout illustrer le succès de la liberté bancaire. En témoigne notamment l’Écosse, où les banques jouissent d’une parfaite liberté, et où, comme le dira le Sénateur Lourties, le crédit agricole est né pour la première fois. [13] On y proposait du crédit court-terme, forme la plus intéressante pour l’agriculture. En Angleterre, le crédit agricole se mit en place également facilement et rapidement, sans doute du fait de la plus grande taille des exploitations agricoles, qui apportait plus de stabilité et de sécurité aux prêts à l’agriculture, mais aussi parce que le pays disposait d’un réseau bancaire très dense. L’État n’intervenait pas, et cependant les banques y offraient des prêts à court-terme (de trois à six mois) à des conditions de taux relativement avantageuses (4 à 5%). En ce sens, dit André Gueslin, « le modèle britannique a rencontré la sympathie d’une partie des Français s’intéressant à la question. Il a pu justifier aux yeux d’un certain nombre d’auteurs le principe de la non-intervention de l’État en matière de crédit à l’agriculture, le refus de tout établissement spécifique. » [14] Et en effet, dès 1854, Léonce de Lavergne prendra exemple sur l’Écosse pour proposer la création de Comptoirs d’escompte, et l’exemple écossais devait revenir fréquemment dans les écrits des économistes et les discussions de loi.
Dans les premiers temps, deux institutions, créées avec une vue sur la question du crédit agricole, vont monopoliser l’attention et finalement décevoir le public, causant une défiance qui fera beaucoup de mal.
Le crédit foncier, d’abord, apparaît un temps comme la solution pour l’agriculture, surtout après la fondation du Crédit Foncier de France en 1852. Cependant, la durée des prêts et les frais qui leur sont associés empêchent un développement aussi fort qu’espéré et que nécessaire. En outre le prêt hypothécaire n’eut jamais bonne réputation, surtout chez les agriculteurs, qui n’en firent en effet usage que rarement. Ils le réservèrent surtout aux cas particuliers, comme la construction du logement ou d’un bâtiment agricole de quelque envergure, mais non pour l’activité économique à proprement parler.
Une société de crédit agricole, ensuite, fondée en 1861, sombra dans la faillite dès 1878. Mais cette société avait finalement peu à voir avec le crédit agricole tel qu’on l’entendait et qu’on le réclamait. Resté centralisé, elle ignorait les clientèles agricoles qu’elle ne chercha jamais à connaître. Au cours de ses seize années d’existence, elle prêta très peu à l’agriculture, et c’est pour d’autres motifs que l’activité agricole — pour des spéculations et placements malavisés, en France et ailleurs (Égypte notamment) — qu’elle fit faillite. [15]
Les propositions s’enchaînent alors. En 1865, Frémy, Leviez et Delbard réclament la suppression de la fixation d’un taux d’intérêt légal (décidé par la loi du 3 septembre 1807 sur les taux d’intérêt), permettant la fixation libre de l’intérêt et le début de prêts à l’agriculture. D’Esterno et de Beaumont proposent la liberté du contrat de cheptel et la possibilité d’une mise en faillite d’un agriculteur pour défaut de paiement de ses dettes. Le but de ces projets est de faciliter le crédit agricole en supprimant les dispositions légales gênantes. Cependant, chaque projet de loi sur le crédit agricole est repoussé, que ce soit en 1866, 1870, 1876 ou 1878. Chaque fois, des difficultés économiques dans l’agriculture font comprendre le besoin du crédit, mais chaque fois l’absence de consensus, ou des luttes politiques, font échouer tout projet.
Finalement, en 1883, Jules Méline devient ministre de l’agriculture. Le contexte politique est meilleur pour l’introduction du crédit agricole, et en outre des amis du crédit agricole sont désormais aux manettes. Un premier projet est voté le 6 mars 1888 pour faciliter le crédit agricole. Il devient la loi du 19 février 1889. N’étant qu’une demi-solution, ce projet est complété par la loi Méline, en 1894, fondant finalement et véritablement le crédit agricole en France. La France accusait un grand retard par rapport aux autres pays européens, non seulement par rapport à l’Écosse et l’Angleterre, mais aussi par rapport à l’Allemagne, où dès 1860 des projets charitables comme les caisses Raiffeisen ou les caisses Schulze-Delitzsch permettaient aux petits agriculteurs d’obtenir des crédits, ou à l’Iltalie, qui vota une loi organisant le crédit agricole en juin 1869.
Il aura fallu donc fallu près de soixante ans pour aboutir à la mise en place de structures adaptées au crédit agricole en France. Cela était dû, remarque André Gueslin, à « l’ampleur des divergence ». « S’opposaient ceux qui proposaient uniquement des réformes législatives et ceux qui préconisaient la fondation de banques de crédit agricole. » [16] Plus fondamentalement, s’opposaient surtout les partisans de l’initiative individuelle aux partisans de l’intervention étatique.
3. ORGANISATION DE L’ANTHOLOGIE. — RÉSUMÉ DES TEXTES CHOISIS
Dans cette anthologie, nous avons été animés de la même ambition qui a inspiré La Caisse d’épargne : solution à la question sociale, c’est-à-dire le souhait de présenter au lecteur contemporain les écrits des économistes français spécialistes de cette question du crédit agricole. Comme pour le précédent volume, les auteurs sélectionnés ici ne jouissent pas tous de la même notoriété. Si Léon Say, plusieurs fois ministre des finances sous la Troisième République, ou Courcelle-Seneuil, auteur de nombreux écrits influents sur les questions bancaires, peuvent être considérés comme des personnalités de premier plan, d’autres, comme Crisenoy, d’Esterno ou Billette ne sont connus que des spécialistes du crédit à l’agriculture.
Les textes ont été arrangés dans un ordre strictement chronologique, afin de conserver la valeur historique de ces documents, et de leur permettre, ensemble, de raconter à leur façon l’histoire du crédit agricole. Un autre arrangement aurait été profondément défectueux, d’autant que les auteurs empruntent les uns aux autres et se répondent, ou pour critiquer, ou pour abonder dans le sens d’une précédente publication.
Dans le but de présenter et d’introduire la pensée de chacun d’eux, nous allons passer en revue les contributions rassemblées dans cette Anthologie.
- Du crédit agricole et d’une banque agricole, nouveau et puissant moyen d’organisation facilement applicable à toutes les banques de circulation, par Ad. Billette (1854)
Adolphe Billette est l’un des premiers économistes en France à avoir consacré tout son temps à la naissance du crédit agricole. Dans cette brochure, composée dès 1849, il inaugure une défense du crédit à l’agriculture qu’il mènera sa vie durant. Son intention, dans ce texte, est de prouver le mal que provoque à l’agriculture le manque de crédit, et de proposer sa solution, une réforme du système bancaire et l’introduction d’une banque agricole. Billette entend d’abord récuser ceux qui expliquent la décadence de l’agriculture française par l’intervention d’un mauvais hasard ou d’une mauvaise disposition naturelle. « Sous le rapport agricole, dit plutôt l’auteur, la France est incontestablement un des pays les mieux partagés, on est forcé de le reconnaître, soit que l’on considère la fertilité et l’étendue de son territoire, soit que l’on s’attache à l’étude de son climat, qui permet les cultures les plus variées, soit enfin qu’on veuille compter le nombre des bras qu’elle peut consacrer à l’agriculture. » [17] Si l’agriculture française peine à se développer, ce n’est donc pas à cause de dispositions naturelles qui rendraient sa condition irrémédiablement misérable. La véritable raison du problème agricole français vient du fait que le cultivateur est dans l’incapacité d’investir. Ce n’est même pas qu’il ne sache pas investir, ou qu’il ne veuille pas le faire : selon Billette, la plupart des cultivateurs français sont bien conscients de la fortune qu’ils pourraient acquérir en investissant disons 3 000 fr. : le problème est qu’ils n’ont pas ces 3 000 fr. et sont contraints de vivre chichement et de suivre les pratiques agricoles ancestrales. C’est donc de moyens pécuniaires, en un mot de capital, qu’a besoin l’agriculture.
Si elle peine à en obtenir, c’est d’abord et avant tout en raison de la législation, qui, à son égard, est abusivement protectrice, à un degré tel qu’elle en devient mauvaise. Le cultivateur est tellement protégé, dit Billette, que personne ne consent à lui prêter, au risque de ne pas être remboursé. À ce titre, la loi est néfaste, car si c’est un grand bien de ne pas pouvoir être mis en faillite ou en prison, c’en est un plus grand de pouvoir prendre ses responsabilités et se rendre capable d’obtenir du crédit. C’est donc une nécessité, suivant l’auteur, de réformer la législation pour placer les engagements des cultivateurs sur la même ligne que ceux des commerçants et des industriels.
Pour diffuser le crédit à l’agriculture, toutefois, Billette ne se renferme pas dans une attitude de réforme de la loi. Il réclame également la création d’une Banque agricole, formée sur le modèle de la Banque de France, et ayant pour objet principal de venir en aide aux agriculteurs,
en leur octroyant des crédits, de préférence à moyen terme (supérieur à 90 jours, maximum à la Banque de France).
- Étude sur l’organisation du crédit agricole en France (Journal d’agriculture pratique) par J. de Crisenoy (1861)
Les constats sur lesquels Crisenoy base son travail sont les mêmes que pour Billette et les auteurs qui lui succèderont : l’agriculture languit faute de crédit. L’auteur fournit également les mêmes plaintes sur la législation abusivement protectrice, dans des termes qu’il nous est inutile de citer, puisqu’ils sont les mêmes que Billette. Crisenoy ajoute cependant une critique du système général qui a donné naissance à ces lois de protection de l’agriculture malgré elle : c’est un paternalisme excessif, apportant cette croyance que l’agriculteur, laissé à lui-même, ne saurait que se ruiner et se faire du mal. Au contraire, soutient Crisenoy, il faut défendre la liberté et la responsabilité des agriculteurs, et les laisser obtenir du crédit, « que chaque cultivateur puisse dépenser comme il l’entend et sans être mis en tutelle comme un enfant. » [18]
La liberté, Crisenoy lui accorde toutefois une confiance mesurée, puisqu’il refuse la solution proposée par certains, celle d’en finir avec le monopole de la Banque de France et d’autoriser toute banque à émettre des billets. En France, soutient-il, une seule banque a le monopole de l’émission des billets, d’après ce principe que l’État doit contrôler la valeur de tout instrument d’échange : et cette idée lui paraît juste et incontestable. Plus que sur la liberté des banques, Crisenoy entend fonder le crédit agricole sur un système de banques mutualistes, qui autoriserait un
maintien des frais au minimum possible et un gage de sûreté pour les cultivateurs.
Crisenoy connait et insiste sur la résistance qu’offrent les préjugés des agriculteurs, sur la « défiance naturelle et invétérée du paysan, persuadé qu’on ne s’approche de lui que pour le tromper et qu’il doit se mettre en garde contre tout le monde, surtout contre les banques, dont le nom seul est pour lui, non sans raison, un épouvantail. » [19] C’est là selon lui le premier obstacle au crédit agricole. Pour le vaincre, les banques agricoles doivent inspirer la confiance, et la solution tient selon lui dans une constitution mutualiste.
- De la crise agricole et de son remède, le crédit agricole, par M. D’Esterno (1866)
Moins original que Crisenoy, tant dans ses constats que dans ses recommandations, d’Esterno est un auteur de synthèse. Ami de l’agriculture, il est convaincu comme les autres « qu’il faut à l’agriculture de l’argent, et puis de l’argent, et encore de l’argent. » [20] Partisan de la liberté, il est aussi critique envers les réglementations et les lois qui viennent ôter la responsabilité du cultivateur et dicter ses choix. C’est là le fruit d’un vieux dogme, souligne-t-il, qui tire ses origines des premiers rois. « Depuis le règne des Valois jusqu’à nos jours, les gouvernements qui se sont succédé en France ont tous été fermement convaincus que l’industrie agricole n’éprouvait qu’un seul besoin, celui d’être réglementée : l’idée ne leur est jamais venue d’essayer une fois de la laisser faire à sa guise, pour voir ce qui en serait advenu. » [21]
Aujourd’hui, défend d’Esterno, c’est l’expérience même qu’il faut entreprendre : il faut laisser à l’agriculture française le pouvoir de se sauver elle-même. La chose est facile, soutient-il, car la tâche est purement négative : il faut enlever les barrières qu’on a posé sur la voie de l’amélioration agricole. À l’objection qu’on lui opposerait « Si la chose est si facile, comment n’est-elle pas encore faite et pourquoi ne se fait-elle pas d’elle-même ? », il répond : « Parce que le crédit a été systématiquement interdit à l’agriculture. Sous prétexte qu’il devait la ruiner, on lui en a tari les sources. Qu’on lui rende sa liberté, elle ne demandera ni subventions, ni sacrifices. » [22]
- Le crédit agricole par la liberté des banques, extrait de La Banque Libre, par Jean-Gustave Courcelle-Seneuil (1867)
Si c’est bien un partisan de la liberté qui s’exprime dans les quelques extraits que nous avons tiré de La Banque Libre, c’est un partisan hétérodoxe par sa radicalité. Ce n’est pas, encore une fois, par ses constats que Courcelle-Seneuil nous surprendra : lui aussi entonne le même refrain, s’indignant de ce que les cultivateurs ne connaissent pas le service des banques, même par ouï-dire, tandis que les banques agricoles pourraient rendre des services considérables à l’agriculture française ; lui aussi poin-te du doigt les abus de la législation et les préjugés négatifs du peuple des campagnes.
Sa solution, toutefois, est pleinement originale. J.-G. Courcelle-Seneuil soutient que les banques devraient avoir l’autorisation d’émettre librement des billets, c’est-à-dire de la monnaie fiduciaire, et de tenir ces billets en concurrence les uns avec les autres dans la circulation. Il soutient en outre que les banques tireraient profit de ces émissions et s’installeraient jusque dans les campagnes pour capter l’épargne, escompter des traites, faire du crédit, etc.
« Utopie ! dira-t-on. — C’est possible ; mais cette Utopie a été réalisée dans le monde. » [23] Courcelle-Seneuil, en effet, utilise l’exemple écossais pour montrer qu’une parfaite liberté des banques, y compris d’émettre des billets remboursables à vue et au porteur, est une solution praticable et pleine de succès pour répondre aux difficultés de l’agriculture française de l’époque.
- Le crédit agricole (Revue des Deux Mondes), par A. Batbie (1870)
Passant après plusieurs auteurs influents sur cette question du crédit agricole, Batbie entend faire un état des lieux, une revue critique des propositions. Il entend surtout montrer en quoi les différentes solutions mises en avant par ses prédécesseurs sont défectueuses, et indiquer dans les grandes lignes une alternative de son invention, qu’il trouve supérieure.
Beaucoup de solutions tentées, selon lui, se sont révélées infructueuses. D’abord, les petites sociétés coopératives, fondées sur le modèle allemand, lui apparaissent comme d’envergure trop limitée pour avoir une véritable influence. Le montant d’affaires qu’elles peuvent réaliser, le concours qu’elles peuvent offrir à l’agriculture, semblent à ses yeux trop insuffisants. Si ces sociétés coopératives améliorent la situation, ainsi, elles n’en font cependant pas avancer significativement le problème du crédit agricole.
La déception est plus grande et plus amère, toutefois, à l’égard des deux compagnies fondées avec l’ambition de fournir du crédit à l’agriculture. La première, le Crédit foncier, ne s’est lancée que dans des prêts hypothécaires dans les villes. La seconde, la Compagnie du crédit agricole, n’a guère fait mieux, malgré son nom. « La compagnie du Crédit agricole, dit Batbie, n’a que rarement traité avec les fermiers, tant à Paris que dans les succursales de province. Elle a opéré comme une banque ordinaire, et c’est surtout dans les villes où manquaient les établissements de crédit commercial qu’elle a établi des succursales et choisi des correspondants. » [24] Ainsi, tant le Crédit foncier que la Compagnie du crédit agricole se sont détournés de l’agriculture et ont laissé non résolue la question du crédit à l’agriculture.
La solution, selon Batbie, ne se trouve pas dans la fondation d’un quelconque établissement, elle est dans la suppression des lois qui empêchent l’agriculteur de prouver qu’on peut avoir confiance en lui. Elle est aussi dans la fin de l’habitude que peuvent avoir certains propriétaires de vivre loin de leurs terres et de se désintéresser des progrès agricoles qu’on y fait.
- Discussion de la société d’économie politique. Réunion du 5 septembre 1881, sur le crédit agricole
En septembre 1881, la Société d’économie politique se réunit, comme à son habitude, pour discuter une question spéciale. À l’ordre du jour fut alors portée la question du crédit agricole. La société est unanime pour indiquer qu’il faut autoriser l’agriculteur à obtenir du crédit comme les autres. Elle est en outre unanime pour souligner que c’est dans la liberté et la responsabilité que se trouve la réponse au problème. Pour ce qui concerne les recommandations, les membres de la Société d’économie politique en indiquent deux : vulgariser dans les campagnes les bienfaits du crédit, et changer les dispositions légales qui entravent l’apport du crédit à l’agriculture.
- Dix jours dans la Haute Italie, par Léon Say (1883)
Nombreuses sont les enquêtes menées entre le milieu et la fin du XIXe siècle sur le crédit agricole. Si nous n’avons pas voulu les insérer, c’est qu’elles sont souvent d’une lecture difficile, surchargées qu’elles sont de détails, et qu’en outre elles ne sont que rarement d’une réelle solidité
sur le plan des principes. La contribution de Léon Say se distingue à cet égard. Après avoir visité la haute Italie, accompagné du sénateur Émile Labiche, pour enquêter sur ses dispositions en matière de crédit agricole, il a fourni dans cette brochure le bilan de ses observations.
Dans ses conclusions, Léon Say insiste sur les mérites de la décentralisation et de l’initiative privée, qu’il oppose aux volontés centralisatrices et à l’intervention permanente du législateur telles qu’elles sont à la mode en France. « Toutes les merveilles que j’ai vues, écrit-il ainsi, sont les merveilles de l’initiative privée et de la décentralisation. C’est l’initiative privée et la décentralisation du crédit qui sont la raison dominante des progrès de la richesse en Italie. » [25]
Il signale en outre que la loi italienne, contrairement à la loi française, ne sur-protège pas le cultivateur mais lui laisse la responsabilité de ses actes. Les banques italiennes, en outre, ont toute latitude pour émettre des prêts ou escompter le produit d’opérations agricoles, ne faisant même pas mention de l’origine agricole ou industrielle des effets ou des placements.
- La question du crédit agricole, par Ad. Billette (1885)
Près de quarante ans après avoir été l’un des précurseurs du crédit agricole en France, Adolphe Billette revient à la charge en 1885 à la suite d’énièmes discussions au Sénat. Il insiste une dernière fois, et avec les arguments les mieux présentés, sur la nécessité de détruire les barrières qui ferment aux agriculteurs l’accès au crédit ; sur la façon par laquelle la sur-protection de l’agriculteur cause finalement sa ruine ; sur les échecs cuisant qu’ont été les premières expériences de crédit agricole en France, soit par le Crédit foncier soit encore par la Compagnie du crédit agricole.
Quant à la création institutionnelle d’un crédit agricole en France, Billette se range à l’idée qu’il faut recourir plus à l’initiative individuelle qu’à une décision publique. Une fois les barrières abattues et la commercialisation des engagements des agriculteurs autorisée, des banques mutualistes pourraient se fonder librement dans les campagnes sans que l’État ait besoin d’intervenir et de dicter leur conduite.
- Le crédit agricole : ses nouvelles formules (Revue des Deux Mondes), par Henri Baudrillart (1891)
Avec ce texte de Baudrillart paru dans la Revue des Deux Mondes, nous arrivons à l’époque qui a vu émerger la première loi cadre pour le crédit agricole en France. Ce n’est pourtant pas tant la création d’une institution artificielle que l’auteur réclame ici. Après avoir souligné combien, plus que jamais, l’agriculture française avait besoin de capital, Baudrillart prouve tout le bien qui résulterait d’une loi qui laisserait l’agriculteur libre de s’engager dans des contrats de crédit selon son bon vouloir et en suivant son intérêt. En cela, s’il réclame à l’État une intervention, elle est négative : c’est de laisser la liberté aux agriculteurs et aux institutions bancaires. « La législation peut nous aider moins par des secours directs qu’en cessant de faire obstacle » conclut-il — une conclusion qui pourrait bien s’appliquer à de nombreuses autres questions et nous fournit à nous, citoyens du XXIe siècle, une fort bonne leçon.
Benoît Malbranque
Me Nguyen
_____________
[1] C’est du moins ce qu’en pense Louis Blanc, Histoire de la Révolution, Paris, 1847, t. I, p.272. Cette intention de John Law est contestée par André Lichtenberger, Le socialisme au XVIIIe siècle, étude sur les idées socialistes dans les écrivains français du XVIIIe siècle avant la Révolution, Paris, Alcan, 1895, p.64
[2] Cf. Turgot, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, § LII
[3] Jean-Baptiste Say, Traité d’économie politique, tome I, Paris, Economica, 2006, p.199
[4] Œuvres complètes de Frédéric Bastiat, réédition Institut Coppet, tome 2, p.31
[5] Michel Chevalier, Cours d’économie politique fait au Collège de France, Paris, 1842, volume 1, p.123
[6] Madeleine Degon, Le crédit agricole : sources, formes, caractères, fonctionnement en France et dans les principaux pays, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1939, pp.43-46
[7] Article « Fermiers », Œuvres économiques complètes et autres textes, tome 1, Paris, INED, 2005 p.138
[8] Mirabeau, l’Ami des Hommes, 5ème partie, t. III, p.64. Dans la même veine, voir aussi Herbert, Essai sur la police générale des grains, 1755, p. 134 : « L’argent est le meilleur engrais que nous puissions jeter sur nos terres. Il s’étend à l’infini sur tous les revenus ».
[9] Morellet, Réfutation de l’ouvrage qui a pour titre « Dialogue sur le commerce des blés », Paris, 1770, p.212.
[10] Cité par André Gueslin, Les origines du Crédit agricole (1841-1914), Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1978, p.73
[11] Œuvres complètes de Frédéric Bastiat, réédition Institut Coppet, tome 2, p.32
[12] Léonce de Lavergne, L’économie rurale en Angleterre, en Écosse et en Irlande, 3e édition, Paris, 1858, p.160
[13] « Rapport Lourties », Journal Officiel, Documents parlementaires, Annexe n°10, Séance du 19 janvier 1899, p.41
[14] André Gueslin, Les origines du Crédit agricole (1841-1914), Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1978, p.47
[15] On peut mentionner aussi le Crédit rural, fondé en 1866, finançant les grands propriétaires ruraux, qui fit faillite en 1880. Ces faillites n’ont pas aidé à dissiper, loin s’en faut, la méfiance des agriculteurs à l’égard du crédit.
Entre 1840 et 1890, des banques agricoles rurales, limitées en taille, vont aussi voir le jour partout en France. Ce sont d’abord des émules des caisses Raiffeisen allemandes, mais aussi quelques sociétés anonymes et des associations de crédit mutuelles (comme le syndicat de Poligny, par Louis Milcent). La réussite de ces tentatives est indéniable, quoique la méfiance des agriculteurs en a limité le développement.
[16] André Gueslin, Les origines du Crédit agricole (1841-1914), Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1978, p.80
[17] Infra, p.30
[18] Infra, p.81
[19] Infra, p.88
[20] Infra, p.119
[21] Infra, p.102
[22] Infra, p.142
[23] Infra, p.157
[24] Infra, p.166
[25] Infra, p.181


Laisser un commentaire