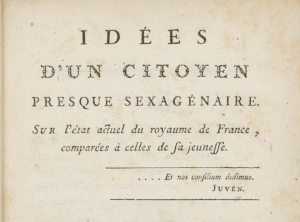 À la veille de la Révolution française, le physiocrate Nicolas Baudeau poursuit sa critique des institutions financières de l’Ancien régime, dont il réclame le renversement ; non toutefois, dans une optique républicaine ou démocratique, mais comme moyen de sauver une monarchie qui lui paraît le fondement naturel d’une économie libre et prospère.
À la veille de la Révolution française, le physiocrate Nicolas Baudeau poursuit sa critique des institutions financières de l’Ancien régime, dont il réclame le renversement ; non toutefois, dans une optique républicaine ou démocratique, mais comme moyen de sauver une monarchie qui lui paraît le fondement naturel d’une économie libre et prospère.
Nicolas Baudeau
Idées d’un citoyen presque sexagénaire sur l’état actuel du royaume de France, comparées à celles de sa jeunesse
1787.
… Et nos consilium dedimus.
JUVEN.
[Et nous aussi avons donné des conseils. — Juvénal, Satires, I.]
Aux Français mes compatriotes
Citoyens, jeunes ou vieux, prêtres ou laïcs, nobles ou roturiers, je vous offre ces idées qui sont le fruit des plus sérieuses méditations, et de cinquante années de travaux assidus, commencés par un des plus profonds génies de la nation française, et continués jusqu’à ce jour par les disciples fidèle d’un grand maître.
La frivolité peut les négliger, l’ignorance présomptueuse les combattre sans les entendre ; la cupidité frauduleuse les décrier, parce qu’elles dévoilent ses attentats contre la société. Mais l’homme de bon sens qui les lit en sent la vérité : l’homme probe y reconnaît la justice, l’homme sensible y trouve les plus sublimes leçons de bienfaisance.
Français ! Français ! Écoutez un écrivain presque sexagénaire sur de grands projets, dont il s’est occupé sans relâche depuis vingt-six ans : écoutez un loyal serviteur du roi votre monarque, un bon patriote, qui ne se glorifie point d’avoir trouvé des vérités utiles, mais qui s’applaudit de les avoir apprises d’un respectable vieillard, et qui croit bien faire de les répandre.
Jeunes gens qui voulez juger juger et endoctriner les anciens, apprenez, par mon exemple, à devenir plus circonspects ; je vais retracer mes erreurs.
En 1760 je rédigeai trois mémoires pour M. B**, ministre des finances[1], qui les accueillit avec bonté : des commis, qu’il a reconnus dans la suite pour ignorants, cupides, et malintentionnés, les traitèrent de vaines spéculations.
Plein de confiance, comme on l’est à trente ans, je résolus de les faire imprimer ; j’exécutai ce dessein en 1763, avec approbation d’un censeur royal et permission, sous le titre d’idées d’un citoyen.
Quelques vérités utiles s’y trouvaient mêlées avec de grandes fautes. J’ai appris, pour la première fois, en 1766, à l’école du respectable docteur Quesnay, à distinguer les bons principes d’avec les paradoxes qui m’avaient séduit.
J’ai travaillé dix ans sous ses yeux, et deux lustres encore après sa mort, à détromper les autres ; si ce n’est pas avec de grands succès, c’est au moins avec bonne foi, zèle et persévérance.
Ce n’est donc plus ma doctrine prétendue, comme en 1760, c’est la sienne que j’expose, depuis vingt ans, que je défends, avec courage, envers et contre tous, que je tâche d’éclaircir et de propager pour le bonheur de l’humanité.
Lisez et jugez ; mais ne décidez pas sans lire, c’est tout ce que je vous demande.
L’abbé Baudeau.
IDÉES SUR LES FINANCES DU ROI.
CHAPITRE PREMIER.
RECETTE
PREMIER PRINCIPAL FONDAMENTAL ÉVIDENT.
« Que le Roi REÇOIVE le plus, et que son peuple paie en même temps le moinsqu’il se peut. »
Première conséquence incontestable.
« Il faut ÉPARGNER, autant qu’il est possible, les frais de perception, les faux frais, et les pertes ; car le peuple PAYANT ET PERDANT ces objets, le Roi ne les REÇOIT pas ».
Seconde conséquence.
« La meilleure des formes de perception est donc celle qui cause moins de frais, point de faux frais, aucunes pertes d’hommes, de travaux utiles, de denrées et marchandises précieuses. »
Troisième conséquence.
« Le plus mauvais système est donc celui qui entraîne beaucoup de frais et faux frais, beaucoup de pertes d’hommes, travaux et denrées ».
APPLICATION DU PREMIER PRINCIPE.
Première classe des revenus du Roi, impositions directes.
Les vingtièmes, tailles et capitations, ainsi que les décimes ecclésiastiques, n’ont que des défauts très faciles à corriger ; ils ont ce précieux avantage, qu’ils coûtent infiniment moins de frais que les impôts affermés ou régis. Aucuns faux frais, aucunes pertes d’hommes, de travaux et denrées.
Seconde classe des revenus du Roi, impôts des ferme et régie.
Les impôts qui forment la forme et la régie générale coûtent énormément de frais, quoiqu’ils rapportent moins que les impositions directes de la première classe.
Suivant M. N*** lui-même[2], qui devait l’écrire à regret, les impositions directes, produisant avec les dons gratuits des pays d’états et du clergé, deux cents vingt millions par an, n’en coûtaient, même avec les abus à réformer, que DOUZE de frais, sans faux frais ni pertes.
Suivant le même, la ferme et la régie générale, qui de son temps ne produisaient pas, à beaucoup près, deux cents millions, en coûtaient TRENTE-TROIS de frais, connus et avoués.
Il convient de plus qu’il y a les faux fraisdes vexations particulières, ceux des procédures, saisies, amendes, confiscations, prisons, supplices, ceux des profits de la contrebande.
Il dissimule les pertes énormes, pertes des journées de travail utile que feraient quarante mille commis ; pertes du sel, du vin, de la viande, des cuirs, et d’autres denrées qui seraient consommées, si elles étaient moins chères, qui ne le sont plus depuis longtemps, d’où résulte que les propriétaires et les cultivateurs n’ont pu continuer de les faire naître.
Ces faux frais avoués coûtent au peuple plus de trente millions, et les pertes plus de cent.
Troisième classe des revenus du Roi, domaines, et droits domaniaux.
Ces droits qui rapportent, y compris les postes, parties casuelles, etc., etc., environ 60 millions, ne coûtent guère que sept ou huit millions de frais, encore qu’il y a beaucoup d’abus à réformer, mais point de faux frais, pertes ni supplices.
Premier résultat de l’observation ci-dessus.
« Les impôts de la ferme et de la régie générale COÛTENT au peuple français, tous les ans, CENT SOIXANTE MILLIONS, en frais, FAUX FRAIS et pertes, dont le Roi ne REÇOIT pas une obole. »
Second résultat également incontestable.
« Ces impôts affermés et régis sont donc évidemment mauvais. Ils le sont jusqu’à concurrence d’environ cent soixante millions, qu’ils font surpayer ou perdretous les ans à la nation, sans aucune recette, sans aucun profit, mais au contraire avec grand préjudice pour le Roi. »
Troisième résultat.
Les impositions directes qui composent la première classe, sont les meilleures, et par conséquent il faut les conserver.
Les impôts indirects, affermés ou régis, qui font la seconde classe, sont les plus mauvais ; il faut les supprimer les premiers, et le plus tôt possible.
Les droits domaniaux, qui forment la troisième classe, sont moins mauvais que ceux de la seconde, mais plus vicieux que ceux de la première ; il faudra les corriger ensuite.
Quatrième résultat.
« Une réforme, également utile au Roi et à la nation, consisterait donc : 1°. à supprimer la gabelle, les aides, les impôts sur la viande, sur les cuirs, etc., et autres des fermes et régies, les plus mauvais de tous.
« 2°. À partager le bénéfice résultant de leur suppression entre le Roi et la nation ; de manière que le Roi eût en accroissement de son revenu les deux tiers des frais connus : le peuple l’autre tiers de ces frais, tous les faux frais, et toute l’épargne des pertes ».
3°. Et pour opérer cet effet, « il faudrait recevoir le remplacement par des revenus de la première classe, qui ne causent que peu de frais, point de faux frais, et aucunes pertes d’hommes, de travaux et de denrées ».
SECOND PRINCIPE FONDAMENTAL ÉVIDENT.
« S’il est de l’intérêt commun du Roi et de ses sujets, que les frais, faux frais et pertes soient épargnés, le plus possible, il est aussi de leur devoir commun d’observer la justice et l’exacte proportion dans la levée des revenus du souverain. »
Première conséquence incontestable.
« Donc l’impôt qui taxe le riche, à proportion de son bien, est légitime et à conserver. »
Seconde conséquence pareille.
« Donc l’impôt, qui TAXE plus celui qui a moins de bien, est souverainement injuste, et à supprimer. »
APPLICATION DU SECOND PRINCIPE.
1°. Les domaines et droits domaniaux sont à corriger par la suite, et doivent être appliqués aux dépenses du Roi, de sa famille et de sa cour.
2°. Les vingtièmes, capitations, décimes, et dons gratuits, corrigés de leurs défauts actuels, ce qui est très facile, seront répartis avec justice, et proportionnellement aux biens des contribuables : il faut donc les conserver et les appliquer aux dépenses annuelles de l’État.
3°. Les impôts indirects de la ferme et de la régie générale sont injustement répartis ; le pauvre en PAIE énormément PLUS que le riche ; il faut donc les supprimer et les remplacer par un droit en argent pour payer les dettes.
4°. Une perception en nature serait également injuste et disproportionnée ; il ne faut donc pas la substituer aux vingtièmes, capitations, décimes et dons gratuits.
Observation simple, mais essentielle.
Tant qu’on laisserait dans la confusion ces classes de revenus et leurs destinations légales, consacrées par nos antiques maximes, on risquerait de tout compromettre en faisant quelque changement ; du moins pourrait-on craindre de ne pas gagner l’entière confiance.
La distinction que je propose une fois rétablie, tout se réduit aux moyens d’acquitter les rentes viagères ou constituées, et de solder en bonnes valeurs toutes les dettes criardes ou exigibles.
On voit, du premier coup-d’œil, qu’à proprement parler, le Roi et ses ministres sont, en quelque sorte neutres, simples spectateurs ; ou, pour mieux dire, arbitres désintéressés, dans la suppression des mauvais impôts, qui forment la ferme et la régie.
Dans le vrai, c’est une portion du peuple qui paye, comme contribuables ; c’est une portion qui reçoit, comme créanciers. La raison, la justice, et l’intérêt général, disent : premièrement au Roi et aux ministres, simples arbitres ; secondement à la noblesse, au clergé, aux propriétaires fonciers, aux cultivateurs, aux manufacturiers, aux négociants, aux artisans, aux rentiers du Roi et des particuliers, aux pensionnaires, gagistes et salariés, qui payent tous les mauvais impôts ; troisièmement, aux créanciers qui reçoivent ; « qu’il serait bon d’épargner tous les ans trente-trois millions de frais, connus et avoués, trente millions au moins de faux frais, également manifestes, et peut-être cent millions de pertes d’hommes, de travaux et de denrées précieuses. »
Les agents mêmes de la ferme et de la régie qui se partagent ces trente-trois millions de frais connus, ne recueillent rien des faux frais ni des profits de la contrebande, ni des choses perdues. À quel titre, sous quel prétexte, et avec quelle pudeur ces gens-là, tirés des classes utilement laborieuses de la société (pour devenir laborieusement préjudiciables au Roi et à son peuple), voudraient-ils persister à faire payer et perdre au souverain, et à tous les autres citoyens, cent trente millions au moins, dont il n’entre pas une obole dans leurs proches à eux-mêmes, pour se conserver trente-trois millions de salaires et profits ?
Car enfin, c’est là tout. Il ne s’agit pas du Roi, si ce n’est pour l’enrichir ; car on peut lui donner de plus en deniers comptant vingt-deux millions tous les ans, qui font les deux tiers des frais connus.
Il ne s’agit pas de la nation qui paie, car on lui ferait gagner tous les ans, 1°. onze millions, qui font l’autre tiers des frais avoués par M. N***, 2°. plus de trente millions de faux frais qu’il avoue, sans les calculer, 3°. plus de cent millions de pertes qu’il a passées sous silence.
Il ne s’agit pas des créanciers qui reçoivent ; car on veut les payer, et augmenter de vingt-deux millions par an les fonds qui leur sont destinés.
De qui s’agit-il donc ? Des agents de la ferme et de la régime générale, de leurs trente-trois millions, qui en font perdre au Roi vingt-deux, et à la nation cent cinquante environ tous les ans.
Français, Français ! Ouvrez donc les yeux, et voyez enfin à qui vous avez affaire.
On vous dira qu’il aurait cent et quelques millions d’avances et cautionnements à rembourser. Oui. Mais cette dette criarde n’est rien, dans l’état où la division des revenus et de leur destination, avec la destruction totale de la ferme et de la régie mettraient les finances du Roi.
Cette dette, les citoyens qui paient les mauvais impôts, s’en chargeraient volontiers, et l’acquitteraient, s’il le fallait, avec facilité.
« Mais vous les chargerez beaucoup », disent, avec une feinte commisération, les part-prenants des trente-trois millions de frais, par eux et par leurs échos, à gage. « Moi ! Point du tout, je les déchargerais infiniment », et rien n’est plus manifeste.
Des trois articles de bénéfice infaillible, que votre suppression va leur procurer ; le premier, qui est le tiers de vos trente-trois millions, et qui fait une rente perpétuelle de onze millions, forme un capital de deux cents vingt, bien supérieur à vos répétitions exigibles. Ils ont en outre les trente millions, et plus de faux frais, que vous occasionnez, sans en profiter, et la totalité des pertes immenses qui les ruinent de même, sans profit pour vous.
Laissez-les donc arranger eux-mêmes leurs propres affaires, sans leur donner des conseils intéressés.
Que le Roi daigne consulter son clergé, sa noblesse et ses bons et fidèles sujets, les propriétaires fonciers, sur cette question précise qui les concerne. « Voulez-vous fournir tous les ans la totalité des rentes viagères et perpétuelles, que je paie et acquitte mes dettes criardes, y compris celles que nécessitera la suppression générale et absolue de la ferme et de la régie générale ? Voulez-vous la fournir par une perception directe en argent, qui sera proportionnelle à la valeur effective de tous vos biens particuliers, au marc la livre ? Voulez-vous avancer seuls tout le remplacement pour vos fermiers, créanciers et rentiers, à condition de recevoir vous-mêmes des uns un vingtième en sus du prix de leurs fermages, et de retenir aux autres un dixième de leurs rentes, pour vous récupérer en partie de cette avance ?… le tout à condition qu’il n’existera plus rien de la gabelle, des aides, des impôts sur la viande, sur les cuirs, sur les huiles, sur les draps, etc., etc. Plus de commis ni de barrières, au dedans ni au dehors, par conséquent plus de contrebandiers : liberté de commerce, immunité de toute consommation ?… Le voulez-vous mes bons et fidèles sujets ? … Oui, Sire, nous le voulons, et par ce seul moyen, grâce à Dieu et au Roi, que nous bénirons à jamais, nous serons tous heureux. Cette réponse est infaillible. » [3]
J’observe que, non seulement les gens de finance, mais tous les agents secondaires de l’administration, principalement ceux qui sont de race financière, sont pis qu’étrangers, dans un conseil, qui traiterait cette grande matière, ils sont manifestement suspects et récusables.
Les propriétaires fonciers, la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, paieront peut-être un centième de la valeur des héritages particuliers, mais seulement par forme d’avances, pour tous leurs fermiers, rentiers et pensionnaires. Ceux-ci, qui seraient exemptés des mauvais impôts, rembourseraient pour leur part les propriétaires ; savoir les fermiers et locataires, en leur payant un vingtième de plus, les rentiers et autres, en recevant un dixième de moins. Tous gagneraient la liberté, l’immunité de la culture et des consommations.
J’ai dit. M’entendra-t-on ? Dieu fait. Au moins emporterai-je dans le tombeau la satisfaction d’avoir exposé de grandes et d’utiles vérités, avec un courage très désintéressé : je crois que l’introduction des formes républicaines et des assemblées de soi-disant représentants électifs, sur-ajoutés aux officiers du Roi dans une monarchie, jointe à la conservation des mauvais impôts, peuvent renverser le royaume de fond en comble.
Di meliora piis, erroremque hostibus illum !
N°II.
IDÉES SUR LES GABELLES.
Un adoucissement qui les laisserait subsister en formerait toujours une véritable capitation, beaucoup plus injuste que l’autre, et surchargée d’accessoires très inutiles, très dispendieux, sans remédier aux grands abus.
Preuves.
Quand même il s’agirait de donner à chaque individu tant de sel par tête, fût-ce le double de ce qu’on en donne aujourd’hui, et de le faire payer beaucoup moins, d’en fournir encore à meilleur marché, tous ceux qui voudraient consommer au-delà de leur taxe, il faudrait toujours faire les observations suivantes.
Première réflexion.
Vous voulez certainement vendre le sel plus cher qu’il ne vous coûte, puisque vous en faites une branche de revenu ; car, pour le livrer au prix marchand, sans y gagner, ce ne serait pas la peine de s’en mêler.
Si le sel vous coûte deux sols, si vous le vendez quatre, si vous exigez que chaque tête vous en achète douze livres, c’est une capitation de vingt-quatre sols par individu.
Seconde réflexion.
Les grandes et petites gabelles étant comprises dans le bail des Fermiers généraux pour plus de soixante millions, il est impossible qu’une capitation, qui porterait même sur toutes les provinces (la Bretagne et la Guyenne comprises, ainsi que l’Auvergne et le Poitou), pût suffire au remplacement, si elle n’était que de vingt-quatre sols par tête.
En effet il ne peut exister qu’environ vingt millions d’habitants taxés au sel (il n’y a pas d’apparence qu’on y compte les enfants à la mamelle, au moment de leur naissance), la capitation de vingt-quatre sols ne produirait que vingt-quatre millions. On en veut probablement soixante-douze, à cause des frais ; c’est donc à trois livres douze sols par tête que se montera l’impôt personnel.
Il n’est pas difficile de prouver que cette autre capitation est infiniment plus onéreuse que celle qui fut imposée par Louis XIV, et qui subsiste.
En effet la capitation de Louis XIV a été rendue proportionnelle aux biens, revenus et conditions des sujets du Roi, autant qu’il a été possible, afin de corriger le vice des taxes personnelles, qui sont de leur nature aveugles et arbitraires.
Dans les campagnes, elle est au marc la livre de la taille, et celle-ci est à peu près proportionnée aux états et facultés des contribuables.
Dans les villes, elle se répartit sur les artisans et marchands, en proportion des apprentis et garçons qu’ils emploient ; sur les simples bourgeois et les nobles, à proportion de leur loyer et du nombre de leurs domestiques.
Cette autre capitation n’est donc pas réellement une taxe par tête, malgré son nom ; c’est une redevance, proportionnée aux états et facultés.
Ce qui achève de le prouver, c’est qu’il n’y a de capité que le chef de famille, point la femme et ses enfants.
Tout au contraire l’impôt du sel taxe les têtes dans toute la force du mot, tant de livres de sel par personnes comptées, y compris les femmes et les enfants. C’est ainsi qu’on l’a toujours pratique pour la gabelle.
Un malheureux manœuvre de campagne, si pauvre, si pauvre, qu’on n’ose pas lui imposer plus de cinq sols de tailles, et autant de capitation, ayant une femme et quatre enfants, paiera donc à cette capitation, appelée gabelle, six fois 3 livres 12 sols, qui font 21 liv. 12 sols. Tandis que le curé, le très riche bourgeois célibataire, n’ayant qu’un domestique, paieront 7 liv. 4 sols à cette nouvelle imposition personnelle.
Plus les ouvriers auront d’enfants en bas âge, plus ils seront surchargés par la capitation. Quelle justice !
« Mais (dira-t-on), l’abus existe dans la gabelle actuelle. Oui, et c’est une des grandes raisons qui en nécessitent la suppression totale. Pourquoi faisant illusion à la bonté et à la justice du Roi, ne proposerait-on qu’une modification mal entendue, qui confirmerait de pis en pis une injustice, avec une foule d’autres abus ? »
Car enfin, et c’est ma seconde proposition, cette autre taxe, vraiment personnelle, qui capite tous les individus par la force du mot, est encore cent fois plus fâcheuse, par les embarras épouvantables qu’elle entraîne, et qui n’existent pas dans la capitation de Louis XIV.
Sans doute l’exaction actuelle emporte des frais de contrainte et des saisies de meubles. C’est son grand inconvénient ; il faudra le corriger, et rien ne sera plus facile. Mais l’autre capitation, nommée gabelle, aura pour le moins ces mêmes surcharges de frais, contraintes et poursuites.
Elle aura de plus tout l’attirail du commerce de sel, fait par monopole au nom du Roi, ce que n’a pas celle de Louis XIV ; elle aura les frais des greniers à sel, directeurs, contrôleurs, etc., etc.
Elle occasionnera les faux frais actuels, qui sont immenses. Le bateau, qui porte le sel en gros sacs entassés, passe devant mon village. Il s’arrête à ma porte ; je ne pourrai, pas plus qu’aujourd’hui, y prendre ma petite provision. Il faudra qu’il remonte une journée plus haut : là mon sel sera déchargé, avec des grandes formalités ; on le fera transporter par terre, à la petite ville où est le grenier : il y sera déposé, avec d’autres formalités également dispendieuses, mais également nécessaires. Là mon pauvre sel sera mélangé de corps étrangers, pour procurer ce qu’on appelle un bon de masse ; c’est-à-dire, un bénéfice, qui résulte « de ce que le grenier vend toujours plus de sel qu’il n’en a reçu ». C’est un fait qu’on n’ose contester, et je serai obligé de faire deux lieues au moins pour aller, et autant pour en revenir, quand je voudrai prendre la provision à laquelle je serai taxé.
Qu’on dise tout ce qu’on voudra, ces faux frais là seront perdus pour le Roi et pour ses fidèles sujets. Au moins l’autre capitation n’entraîne-t-elle pas cet attirail d’un monopole inutilement ruineux, non plus que les vingtièmes et décimes.
Mais, ce qui met le comble à tout, c’est qu’en laissant subsister le reste des impôts désastreux, les aides, les exactions sur les cuirs, sur la viande, sur les vins, cidres, poirés, bières, eau-de-vie, sur les huiles, toiles, draps, et autres marchandises, le monopole du tabac, et les entrées des villes murées : on conserverait l’armée fiscale et l’armée contrebandière, guerroyant l’une contre l’autre à coup de fusils, les visites, les saisies, amendes, confiscations, prisons et supplices, les pertes d’hommes, les pertes de travaux, les pertes de denrées.
Et, ce qui est encore pis, on se mettrait toujours dans la nécessité de violer les privilèges de la noblesse et du clergé d’une part, de confirmer et augmenter les malheureuses prédilections que les agioteurs de papiers et les marchandas de l’argent emprunté par les Rois, ont fait donner aux rentiers oisifs, aux commis, et à eux-mêmes, capitalistes à portefeuilles.
Ceci mérite la plus grande considération, et ne peut jamais trop se répéter, jusqu’à ce qu’on l’ait enfin conçu (car il paraît qu’on s’obstine à l’étouffer), si vous persistez, contre toute raison, à DÉTRUIRE les vingtièmes, la capitation des nobles et les décimes ecclésiastiques, qui sont les moins injustes et les moins injustes des perceptions ; à CONSERVER les fermes et les régies générales, qui sont des impôts injustement répartis et très onéreux. Le remplacement qui vous demandez fût-il pris en argent, ce qui est la seule manière possible, au lieu d’être perçu en nature, comme M. de Vauban le proposait par un système inadmissible, vous ne pouvez y assujettir, outre les bourgeois propriétaires, sous la même forme, et de la même manière, la noblesse et le clergé, sans leur faire injure et violence. Vous ne voulez pas y assujettir les créanciers du Roi, étrangers ou nationaux, les pensionnaires, gagistes et salariés.
Au contraire, si vous conservez les vingtièmes, les capitations des nobles, les décimes des ecclésiastiques, en supprimant la ferme et la régime générales, toutes entières ; la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, propriétaires de terres, les fermiers, les marchands et artisans, les créanciers du Roi, et ceux des particuliers à rentes perpétuelles ou viagères, étrangers ou nationaux, les pensionnaires, gagistes et salariés, payant tous ces droits, et les payant de même ; tous vous devraient le même remplacement, sous la même forme ; aucun ne pourrait s’en plaindre, et vous, en l’exigeant, vous ne violeriez aucune loi, aucun privilège, vous ne contrediriez même aucun préjugé, bien ou mal fondé.
Les étrangers eux-mêmes sont vexés par les mauvais impôts de la ferme et de la régie, gabelles, aides, traites, etc. Ceux qui sont rentiers sur le Roi gagneraient à la suppression, même en payant le remplacement, à proportion de leurs créances.
De ces observations très simples, mais dont la justesse est indubitable, il résulte que la modification des gabelles, qui laisserait subsister une autre capitation, infiniment pire que celle de Louis XIV, n’est ni plus équitable ni plus avantageuse que l’impôt en nature que j’avais admis en 1760, d’après M. de Vauban.
Cette capitation a, comme la perception annuelle d’une quotité des fruits récoltés, les trois inconvénients terribles : 1°. de taxer le pauvre plus que le riche ; 2°. de causer une énormité de frais, faux frais et pertes, qui grèvent les sujets, sans profit pour le Roi ; 3°. de favoriser les classes parasites de la nation, rentiers oisifs, commis, pensionnaires et salariés, aux dépens de la noblesse, du clergé, des propriétaires fonciers, et des autres citoyens, laborieusement utiles.
C’est une vérité fort importante en ce moment que je vais démontrer sur ce droit en nature de fruits récoltés, contre mon propre ouvrage.
Quant aux adoucissements prétendus sur la gabelle, c’est le cas de répondre aux agents de ce mauvais impôt.
… Timeo Danaos & dona ferentes.
VIRGILE.
NUMÉRO II.
EXAMEN DE LA DÎME ROYALE DU MARÉCHAL DE VAUBAN
Dont j’avais adopté le système en 1760.
Quelques personnes, entre autres le sieur Linguet, ont cru qu’il faudrait supprimer les vingtièmes, la capitation des nobles, les décimes ecclésiastiques ; et, pour moyen de remplacement, ils proposaient un droit en nature du vingtième des récoltes pour les bonnes terres, du trentième pour les médiocres, du quarantième pour les mauvaises.
Examinons ce système. En premier lieu, l’impôt en nature ne peut rapporter soixante millions, à moins qu’il n’en coûte aux cultivateurs cent cinquante.
Si le percepteur peut vendre, en 1788, pour douze mille livres de productions, attribuées au Roi, et par lui récoltées en nature cette année, il est physiquement impossible, mais de toute impossibilité, qu’il en paye au Trésor plus de 4 ou 5 mille livres, à cause de ses frais indispensables et de ses risques évidents.
Il lui faut des hommes de confiance, des chevaux, des voitures, pour aller chercher successivement les fourrages, grains, vendanges, légumes et racines… Il lui faut des granges, greniers, celliers et caves très considérables.
Il lui faut battre les gerbes, cribler les blés, arranger les légumes, soigner les vins, avancer les tonneaux, transporter aux marchés, et vendre peu à peu. Frais énormes, outre lesquels il risque de tout perdre, ou du moins une grande partie, n’étant jamais assuré de la bonne quantité, de la bonne qualité, de la bonne vente.
Ainsi, douze mille livres provenant des ventes faites par le percepteur des fruits en nature, ne rapporteront jamais au Roi plus de cinq mille livres. Soixante millions ne peuvent donc revenir quittes au Trésor, sans qu’il soit levé en nature pour plus de cent cinquante millions de fruits.
Comparaison.
1°. Par la gabelle, de bons citoyens ont prouvé que 60 millions net au Roi coûteraient de plus trente millions de frais et faux frais payés par le peuple, et non reçus par le monarque, avec trente millions perdus pour tout le monde ; en tout cent vingt millions.
2°. Les vingtièmes, capitations nobles, et décimes ecclésiastiques, produisant soixante millions net au Trésor royal, n’en coûtent que trois au plus.
3°. L’impôt en nature, cent cinquante millions. En second lieu, le vingtième, capitations des nobles et décimes ecclésiastiques, sont justes et proportionnés aux revenus, à quelques erreurs près faciles à corriger. Au contraire, on a vu que la gabelle taxe le pauvre énormément plus que le riche. Un malheureux ouvrier de campagne, si pauvre, qu’on n’ose pas le mettre à plus de dix sols de taille, ayant une femme et quatre ou cinq enfants, achète à la petite mesure environ cinquante livres de sel (même à six sols), ce sera quinze francs de gabelle.
Un rentier oisif, un procureur, un bourgeois, qui n’a qu’un domestique, n’en achètera que vingt livres au grenier à meilleur marché ; c’est six francs.
L’impôt en nature est aussi disproportionné.
Supposons trois biens, dont la récolte en nature vaut 600 liv., bon an, mal an, tout compensé.
En bonnes terres, le premier fermier peut donner au propriétaire la moitié : c’est trois cents livres, le 1er bien vaut six mille francs. L’impôt en nature prendra le vingtième de la récolte qui vaut six cents livre : c’est trente francs, et tout juste le dixième du revenu, le deux centième du fonds.
En terres médiocres, le second fermier donne à peine le quart du prix des récoltes, à cause des frais et des risques.
Second bien, récolte 600
L’impôt en nature au trentième vaut 20
Le prix de la ferme est de 150
Celui du fonds est de 3 000
L’impôt, pour être proportionné, ne devrait être que de quinze livres, qui font le dixième du revenu, et le deux centième du fonds.
Surcharge disproportionnée, cinq livres sur quinze.
En très mauvaises terres, qui sont en grand nombre, le troisième fermier ne pourrait donner que le huitième ou le dixième de la récolte. Ces fonds peuvent être cultivés par les pauvres paysans, qui vivent des frais mêmes, en travaillant pour eux.
Troisième bien, récolte 600
L’impôt en nature au quarantième vaut 15
Le prix de la ferme est de 60
Celui du fonds est de 1 200
L’impôt, pour être proportionné, devrait être six francs qui sont le dixième du revenu, et le deux centième du fonds. Il est de quinze.
Surcharge disproportionnée, neuf francs.
Il nous reste une troisième comparaison très importante.
Si l’on abolissait les gabelles, et les autres mauvais impôts, en conservant les vingtièmes, les capitations nobles et les décimes, on soulagerait la noblesse, le clergé, les propriétaires des terres déjà tant surchargés, sans faire ni tort ni injustice aux rentiers oisifs, aux pensionnaires, gagistes et salariés du Roi ; au lieu que le système qui consisterait à modérer la gabelle pour la conserver, et à lui substituer un droit en nature sur les productions, soulage les classes parasites, en faisant des préjudices énormes aux fonds de terres.
Non seulement la noblesse, le clergé, les pays d’états contribueraient au remplacement de ces mauvais impôts ; mais encore les rentiers, gagistes et salariés, conviendraient qu’ils doivent également entrer en compensation, puisqu’il est manifeste que tout ce monde-là paie la gabelle, les autres mauvais impôts.
La dette du Roi était avant 1776 d’environ quatre milliards. Pendant les hostilités entre la France, l’Espagne, l’Angleterre et l’Amérique, on a fait pour plus de douze cent millions d’emprunts nouveaux. Le capital de cette masse est donc d’environ cinq milliards, dont les intérêts, partie à rente constituée, partie en simple agiots de banque et finance à 7 ou 8 pour cent par an, partie en viager à 10 ou au-dessus, valent certainement plus de deux cent cinquante millions par an, probablement environ trois cents.
Les rentiers ne paient ni tailles ni capitation, ni vingtièmes sur leurs rentes, à la bonne heure, c’est la convention : il faut la tenir. Mais la gabelle, mais les impôts affermés ou régis, les rançonnent comme tous les autres !
Supposé que le Roi, par forme de remplacement, et de compensation, retienne sans frais, sans pertes, sans procédures, un dixième sur les rentes et intérêts annuels de sa dette, voilà déjà 25 millions, qui ne coûtent rien à lever, et qui sont imposés avec toute raison, toute justice, à chacun dans la proportion la plus exacte avec ses revenus.
2°. Par la même raison, tous les pensionnaires, gagistes et salariés du Roi qui paient la gabelle, les impôts sur la viande et sur les cuirs, devraient et paieraient aussi le remplacement ou équivalent de ces impôts supprimés.
Ils absorbent certainement sur la dépense du Roi une autre somme annuelle de 250 millions ; leur subvention, par simple retenue, vaudrait donc encore 25 millions ; elle serait aussi très juste, très légale, et sans frais.
Ce serait une banqueroute, ont dit quelques personnes timorées ; une banqueroute ! non, puisqu’on ne leur fait rien perdre ; mais au contraire gagner beaucoup.
Car enfin, si le Roi reçoit 200 millions de ces impôts, tous ses sujets, y compris les rentiers, les gagistes, salariés et pensionnaires les paient.
Mais, outre ces 200 millions perçus par le Roi, il y a les bénéfices des fermiers ; il y a de plus les gages et appointements des commis, il y a les faux frais des bureaux : il y a les profits de la contrebande.
Il y a de plus les pertes de journées et de denrées, qui valent autant. Tous ces millions sont sur-payés ou perdus à cause de la gabelle, et autres impôts.
Ni le clergé, ni la noblesse, ni les propriétaires, ni les autres citoyens de tous les ordres qui composent l’état, n’ignorent actuellement combien cette surcharge est considérable ; ils en seraient tous entièrement délivrés à jamais.
Ils auraient donc un immense bénéfice à partager entre eux. Les rentiers, gagistes, pensionnaires et salariés en recueilleraient leur part. La retenue faite sur eux, sans frais, n’étant proportionnelle qu’aux revenus quittes du Roi, et les faux frais ou pertes n’y étant pas compris.
Chacun des chefs de maison épargneraient tous les ans, à proportion de son sel, de sa viande, de ses cuirs, une portion des millions que l’anéantissement des mauvais impôts ferait épargner.
Ainsi tout est clair, tout est juste, tout est avantageux dans cette opération.
Supposez, au contraire, que la suppression tombe sur les vingtièmes, capitations des nobles et décimes ecclésiastiques, la diminution sur les gabelles, et le remplacement sur les productions en nature.
Tout le profit gratuit sera manifestement recueilli par les classes parasites de l’État, par les rentiers oisifs, les commis, les pensionnaires, les gagistes et salariés.
Ils gagneraient six ou huit sols par livre de sel, et ne paieraient rien pour ce bénéfice, n’ayant point de productions en nature.
Mais la noblesse, le clergé, les bourgeois, les agricoles, pour exempter ce monde-là, seraient obligés de donner tous les ans en nature plus de deux cent millions, et d’y contribuer d’autant plus qu’ils seraient moins riches.
Non, jamais un souverain, que le ciel a fait naître avec deux qualités rares et précieuses, la justesse d’esprit et la probité, conseillé par des ministres éclairés, ne peut admettre un pareil projet.
Au lieu de faire prendre en nature pour deux cents millions de fruits, qui n’en voudraient à son Trésor qu’environ soixante, il n’a qu’à demander EN ARGENT aux possesseurs la centième partie de la valeur actuelle, effective et foncière de leurs biens, deux sols par pistole, non pas gratis, et par addition aux autres impôts subsistants, mais à la place de la gabelle, des exactions affermées ou régies, qui coûtent beaucoup plus.
Cette centième partie des biens à recevoir en argent ne coûtera presque aucuns frais; ce supplément juste et proportionnel n’occasionnera ni faux frais, ni procédures et supplices, ni contrebandes. Il vaudra plus au Roi, coûtant moins à son peuple. Profit et bénédictions pour le monarque, profit et prospérité pour son royaume.
Les propriétaires, nobles, ecclésiastiques et bourgeois, qui avanceront au Roi le remplacement, en retrouveront une grande partie dans l’augmentation de leurs fermes et loyers, qui sera d’un vingtième, ainsi que dans la retenue d’un dixième, qu’ils feront à leurs rentiers, gagistes et pensionnaires, indépendamment des autres profits ci-dessus calculés.
Français ! Français ! Ce ne sont point là des systèmes, ni des inventions alambiquées ; ce sont des faits, des comptes très simples, à la portée de tout le monde.
Toujours notre même principe, dont l’évidence est si frappante.
« Les meilleurs moyens sont ceux qui font recevoir au Roi le plus possible, et en même temps payer le moins aux sujets, en épargnant les frais, les faux frais et les pertes ; les hommes, les choses, surtout les délits et les supplices. »
NUMÉRO IV
IDÉES SUR LES AUTRES IMPÔTS DE LA FERME ET DE LA RÉGIE
Tous les impôts réunis doublent et triplent même, pour le pauvre peuple de Paris, des villes et des campagnes, le prix de la bière, du cidre, du vin, de l’eau-de-vie, de la viande, du poisson, des œufs, du beurre et du fromage, du bois, de l’huile, du sucre, du café, des drogues et médicaments, des toiles et des étoffes.
Ils ont les mêmes inconvénients que la gabelle, savoir, de coûter, outre la somme reçue par le Roi, 1°. une énormité de frais en profits ou gages des fermiers et régisseurs généraux, et de leurs quarante mille commis, maisons, bureaux, barrières, feux, chandelles, livres et papiers.
2°. Une énormité de faux frais, pilleries secrètes des commis, saisies, procès-verbaux, procédures, plaidoiries, jugements des premiers sièges, arrêts des cours et du conseil, amendes et confiscations, décrets, prisons et supplices.
3°. Une énormité de pertes, savoir, quatre-vingt milles journées de travail utile que feraient tous les jours quarante mille commis, et autant de contrebandiers ou fraudeurs, car il y en a tout autour du royaume, en dehors, pour y faire entrer, sans payer, les marchandises, ou prohibées, ou sujettes aux droits des traites étrangères. Les frontières, qui forment une ligne de douze cents lieues au moins, sont assiégées par l’armée contrebandière. Il y en a tout autour des nouveaux murs de Paris et des autres villes, ou gros bourgs soumis aux entrées : autres pertes de temps de tous les marchands et voituriers à chacun des dix mille bureaux ; pertes de temps de tous les marchands ; pertes des hommes ruinés, emprisonnés, suppliciés pour fraude ; perte d’une prodigieuse quantité de denrées et marchandises que ces mauvais impôts empêchent de naître, ou de fabriquer dans le royaume.
Par exemple, les aides et les droits aux entrées ayant rendu triple, quadruple dans les villes le prix du vin, le peuple est obligé de s’en passer la majeure partie de l’année ; d’où vient le dépérissement des vignes.
L’impôt sur les cuirs, établi par feu M. de Silhouette, rendu le plus vexatoire et le plus absurde qu’il soit possible, par feu l’abbé Terray, pendant la dispersion des magistrats, détruit les tanneries, et fait monter toutes les peaux façonnées à des prix exorbitants et ruine les nourrisseurs de bétail, étant joint à la cherté de la viande, qui ne permet plus au pauvre peuple d’en faire son aliment journalier.
Répétons, car les personnes intéressés aux fermes et régimes, qui se partagent entre eux seuls les trente-trois millions de frais tous les ans, font des efforts incroyables de tous les genres pour étouffer cette lumière précieuse.
Répétons, que le Roi ne retire pas un dernier de tous ces frais, dont la masse connue et avouée est de trente-trois millions ; de tous ces faux frais, qui en coûtent plus de trente autres, ni de ces pertes, qui se montent probablement à plus de cent millions.
Toutes les raisons palliatives, tous les motifs controuvés des agents de la ferme et de la régie générale, co-partageants des trente-trois millions, sont misérables et absurdes, quand on les compare à cent soixante millions de surcharge que la nation paie ou perd, sans aucun profit pour son Roi.
« Mais que fera-t-on des quarante mille commis ? » Vous me le demandez ! Mais je vous demande à mon tour ce qu’on fait en temps de réforme de cent mille braves soldats qu’on licencie ? Ce qu’on va faire de ceux que le Roi congédie pour épargner ? On les renvoie à la charrue et aux métiers. Observez, quant aux commis, que nous laissons leurs soldes dans la poche des citoyens, d’où les impôts la faisaient sortir au double et au triple ; étant là, ils n’ont qu’à la gagner en travaillant pour les bourgeois, au lieu de roder, espionner et fusiller contre les fraudeurs.
« Mais ces impôts ont un grand avantage, on les paie peu à peu et sans s’en apercevoir, ce qui est un grand bien. »
Sans s’en apercevoir, dites-vous ! Qui dont est assez aveugle pour ne pas voir la surcharge ? Allez demander aux hommes, aux femmes, aux petits enfants, pourquoi le sel, le vin, la viande, les œufs, le beurre, les souliers, les habits sont si chers à Paris ? Il n’y a pas un seul qui ne vous réponde, « parce que les impôts augmentent tous les jours ».
Peu à peu, dites-vous ! Mais quand je fais entrer une barrique de vin, il m’en coûte environ trois louis d’or à la fois, et autant quand je prends un minot de sel au grenier.
Peu à peu. Mais, qui empêche de payer peu à peu les vingtièmes ? Qui empêcherait de s’acquitter par petites portions du droit de remplacement substitué aux mauvais impôts ?
« Mais, le montant serait connu, et il était bon de le cacher à la nation. » Bon ! Pourquoi ? Un Roi juste et bienfaisant ne veut ni ne doit tromper son peuple. D’ailleurs cette fraude est-elle possible à présent ? Le voile est déchiré. Dieu a voulu que la lumière fût faite, et elle a paru.
On sait, 1°. ce que les fermiers et régisseurs rendent au Roi, 2°. ce qu’ils partagent entre eux et leurs commis (savoir trente-trois millions par an), 3°. ce qu’ils causent de faux frais et de pertes, savoir : plus de cent-trente millions tous le sans, dont eux-mêmes ne reçoivent rien.
« Mais on propose d’adoucir la gabelle et quelques autres droits de traites ! » Adoucir, dites-vous ? Non, non, la gabelle comme on la propose en impôt forcé et solidaire, est un fléau pire que ci-devant ; car il y a plus de la moitié du royaume qui n’est forcé ni solidaire. Ce projet qu’on avait voulu exécuter il y a deux siècles, fut trouvé si vexatoire et si pernicieux, que le Roi le révoqua sur-le-champ. Cet adoucissement prétendu ne serait profitable qu’aux fermiers généraux, pour les défendre mieux des contrebandiers ; qu’aux rentiers oisifs qui ont mis leur bien à fond perdu ; qu’aux commis et aux marchands d’argent.
Adoucir, pourquoi ? N’est-il pas plus simple et plus avantageux et plus sûr de supprimer tout à fait ? Vous voulez mettre le sel à dix sols et un liard la livre, au lieu de quatorze sols ; mais nous l’avons tous vu à ce prix, et monter de sols en sols, rien n’est plus facile, ni plus expéditif en cas de besoin réel ou supposé.
L’embarras était de former deux machines aussi compliquées, aussi coûteuses que la ferme et la régie générale ; on n’a pu s’exposer à ces difficultés que dans un temps de troubles, de malheur, et surtout de la plus profonde ignorance, comme la prison du Roi Jean en Angleterre.
Cet édifice de ruines une fois démoli jusqu’aux fondements, il n’y aura plus moyen de le rétablir. L’expérience des maux qu’il a causés, et ceux des biens que procurerait sa destruction totale s’y opposeraient.
Au contraire s’il subsistait, si la réforme se bornait à quelques diminutions, bientôt les sols pour livre reviendraient les uns après les autres.
Ce n’est pas la tige des mauvaises plantes qu’on doit raccourcir, mais les racines qu’il faut arracher jusqu’à la dernière.
Non potest arbor mala bonos fructus facere.
Evang.
[Il n’est pas possible à un mauvais arbre de produire de bons fruits. — Évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 7, verset 7.]
IDÉES D’UN CITOYEN SUR L’ÉTAT ACTUEL DU ROYAUME DE FRANCE.
SECONDE PARTIE
NUMÉRO V.
IDÉES sur les pièges que les ennemis du bonheur public tendent aux citoyens bien intentionnés.
La désastreuse imposition de la gabelle, dont le nom fait horreur au Roi et à tous les citoyens bien intentionnés ; les exactions non moins funestes sur la bière, le cidre, le vin et l’eau-de-vie ; sur la viande et sur les cuirs ; sur le bois, l’huile et la chandelle ; sur les œufs, le beurre, le fromage, le poisson, les légumes ; sur les toiles, les étoffes, les drogues et médicaments, qui rendent la vie du pauvre peuple, son strict nécessaire, quatre ou cinq fois plus cher qu’il ne serait sans toutes les exactions, hautement détestées par le souverain, probe et bienfaisant, que Dieu, dans sa miséricorde infinie, donne enfin au meilleur des peuples. Ces impôts injustes dans la répartition, qui ruinent par l’énormité des frais avoués, par des faux frais manifestes, et surtout par des pertes énormes, le monarque et la nation ; ces impôts, qui ne se sont introduits que peu à peu par des systèmes nouveaux ; dans les siècles d’ignorance, de désordres et de calamités publiques. Ces impôts qui ne sont profitables qu’aux seuls fermiers et régisseurs, à leurs quarante mille commis de tous grades, et qui valent tous les ans trente-trois millions à cette armée financière. Ces impôts ont nécessairement des partisans connus et secrets. Ils doivent en ce moment réunir leurs efforts pour étouffer la voix des bons citoyens, des zélés serviteurs du Roi, des vrais amis de l’humanité, qui travaillent à répandre la lumière, en démontrant le vice fondamental et les terribles effets de ces fléaux destructeurs.
Je réduits à trois points les manœuvres des ennemis publics en pareille circonstance. 1°. Dissimulation des vérités utiles, qu’ils s’efforcent de faire oublier et perdre de vue. 2° Propositions d’autres procédés, qu’ils conseillent avantla réformation des mauvais impôts, quoique la justice et le bon sens disent qu’ils ne doivent être qu’après. 3° Objections fausses et frauduleuses contre cette restauration salutaire, ses circonstances et ses effets. Je vais confondre en peu de mots ces trois artifices de la cupidité dévorante. Que les critiques répondent librement à mes démonstrations.
1°. Vérités utiles qu’on veut étouffer.
Les mauvais impôts de la ferme et de la régie ne produisent au Roi, de recette effective, qu’environ la valeur de trois dixièmes, ou six vingtièmes actuels ; mais ils coûtent à la nation tous les ans plus de sept dixièmes, ou plus de quatorze vingtièmes actuels, sans compter les vexations horribles, saisies, confiscations, amendes, prisons et supplices. C’est ce qu’il faut démontrer.
Oui, Français ! oui, mes compatriotes ! Oui, prince ami des hommes, béni de Dieu, de votre peuple, de votre siècle, de la postérité ; béni à jamais, vous, votre auguste épouse, et tous vos descendants, pour avoir dit : anathème à la gabelle ; oui, c’est la valeur de quatorze vingtièmes, qu’il en coûte tous les ans aux contribuables, sans qu’il en revienne plus de six au Roi.
Je le prouve. Un dixième actuel vaut environ cinquante millions, suivant M. Necker et tous les autres : un vingtième, environ vingt-cinq millions ; premier fait connu.
La ferme et la régie générale paraissent produire deux cents millions environ ; mais ils n’en produisent que cent cinquante de recette effective pour le Roi ; second fait à établir fort aisément par un mot.
Si le Roi supprimait, suivant son désir, tous ces mauvais impôts de la ferme et la régie, les rentiers, pensionnaires, gagistes et salariés, qui sont vexés comme tout le monde par ces exactions, en étant délivrés par la bienfaisance à jamais mémorable de Louis auguste, le restaurateur de son empire, seraient infiniment plus riches et plus heureux, quoiqu’on prélevât sur leurs pensions, gages et rentes, une retenue de cinquante millions au total.
Recevoir aujourd’hui deux cents millions d’une main, mais payer de l’autre tous les ans cinquante millions de redevance, qu’on ne paierait plus à l’instant même de la réformation, c’est évidemment n’en avoir que cent cinquante de recette réelle. Il y en a cinquante fictifs et illusoires. Le vrai produit de la ferme et de la régie, n’est donc pour le Roi que cent cinquante millions, c’est-à-dire, la valeur de trois dixièmes, ou six vingtièmes actuels ; ce qu’il fallait démontrer.
Troisième fait. Il en coûte à la nation tous les ans au moins la valeur de sept dixièmes actuels, ou quatorze vingtièmes ; c’est ce que je vais établir.
Outre les deux cents millions qui entrent au Trésor royal, il y a, comme l’assure, en grande connaissance de cause, M. N***, dix fois très explicitement dans ses trois gros volumes in-8°, trente-trois millions de frais ordinaires, par lui calculés et avoués. Il y a les faux frais, qu’il reconnaît, y compris ce que survendent les contrebandiers, jusqu’à ce qu’ils soient exterminés par les quarante mille commis ; ces faux frais valent encore trente-trois millions, en tout soixante-six au moins.
Mais il y a les pertes annuelles qu’il a dissimulées. Ces pertes sont énormes : quarante mille commis guerroyant, à coup de fusil, contre quarante mille contrebandiers, font tous les jours vingt-quatre mille journées de travail utile perdu, sans compter celles que perdent les particuliers, les marchands, les voituriers, pour aller chercher les buralistes et les attendre. Du sel, du bétail, des légumes, du vin, des récoltes, des marchandises de tout genre, combien n’en font pas perdre tous les ans la gabelle, les aides, l’impôt sur les cuirs et sur la viande, les traites du dedans et du dehors ? Je les estime cent millions pour caver au plus bas possible.
Voilà donc évidemment cent soixante et quelques millions de surcharge, dont il n’y a pas un sol pour le Roi : elle surpasse annuellement la valeur de trois dixièmes ou six vingtièmes actuels.
Ainsi trois dixièmes seulement sont produits au Trésor royal par le service des fermiers et régisseurs. Mais il en coûte à la nation, en frais ordinaires connus, en faux frais avoués par M. N*** lui-même, et en pertes évidentes, plus de trois autres dixièmes ; en tout quatorze vingtièmes payés ou perdus, dont six seulement de recette effective pour le Roi ; ce qu’il fallait démontrer.
La voilà, princes, prélats, magistrats, citoyens notables, cette vérité salutaire, incontestable que les ennemis publics veulent étouffer par tous les moyens possibles, qu’ils tâchent de vous faire oublier, et qu’on devrait au contraire vous rappeler vingt fois par jour. Quiconque veut vous en distraire, pour vous occuper plus essentiellement d’autres minces objets, est le partisan et le fauteur des vampires politiques.
2°. Procédés conseillés avant la réformation des mauvais impôts, et qui ne doivent venir qu’après.
Ces procédés se réduisent à deux, malheureusement très connus, imposer et emprunter, créer de nouvelles taxes et contracter de nouvelles dettes pour mettre la recette au niveau des dépenses.
Je ne discute point encore ici la prétendue nécessité d’imposer pour emprunter, et de faire un nouvel emprunt pour payer la dette criarde, énorme à la vérité, mais non fondée en titres légalement reconnus, usuraire, et qui peut-être, si la justice réglée s’en occupait, serait trouvée frauduleuse en grande partie. Je l’admets pour le moment.
Je fais plus, j’y joins le remboursement des avances faites par les régisseurs, fermiers et leurs commis cautionnés, qui se regardaient comme très heureux de ne pas les recevoir, et d’être, au contraire, préposés à la perception du droit de remplacement.
J’ajoute enfin, s’il le faut, six mois d’aréages des rentes de l’Hôtel-de-Ville de Paris, qu’on doit payer, avant d’avoir assis et perçu le remplacement.
Je me réserve d’expliquer en détail tous ces objets, dans mon second chapitre, sur la dépense du Roi. Mais en attendant, je vais m’occuper du moyen de les recevoir.
Supposez la somme qu’il vous plaira, je conviens avec vous, pour le moment, qu’il faut un emprunt, et par conséquent un impôt qui paie les nouvelles rentes.
Mais si vous y procédez avant la réformation de la gabelle, et des autres exactions de la ferme et de la régie, vous serez obligé d’imposer plus et d’emprunter moins. Tout au contraire, si vous n’y procédez qu’après, vous pourrez imposer beaucoup moins, et cependant emprunter beaucoup plus en cas de nécessité ; c’est ce que je vais prouver.
Pour les seuls frais ordinaires, calculés pas M. N***, la gabelle et les autres mauvais impôts de la ferme et de la régie générales, coûtent à la nation, tous les ans, trente-trois millions effectifs, dont il n’entre pas un denier dans les coffres du Roi. J’ai dit, je répète, et je répèterai jusqu’à mon dernier soupir, avec tous les honnêtes gens du monde entier, qu’il vaut mieux en donner au Roi les deux tiers, valant vingt-deux millions, et en laisser l’autre tiers, valant onze millions tous les ans, dans la poche de tous les citoyens.
J’observe encore qu’en donnant ce bénéfice de vingt-deux millions au Roi, d’onze millions tous les ans à son peuple, je détruis entièrement, et à perpétuité, une autre surcharge épouvantable de trente et quelques millions de faux frais, et de cent millions de pertes annuelles, dont ne profitent pas les fermiers et régisseurs eux-mêmes, qui les font perdre par le vice essentiel des mauvais impôts.
Ces vingt-deux millions réels, effectifs, tout prêts et indubitables, partageons-les en deux parties de onze millions chacun. À quelque somme que se montent les besoins auxquels il faut subvenir, les onze millions de la première partie vous dispensent d’imposer, par une taxe nouvelle, ce même objet de onze millions, et dans le même temps, par la même raison, les onze millions de la secondepartie, vous serviront à payer la rente d’environ deux cent millions de nouvelles rentes créées par un emprunt.
Réfléchissez-donc, et voyez que ces vingt-deux millions ne font pas une charge nouvelle pour le peuple, quoiqu’ils soient une recette nouvelle pour le Roi. Nous les passons tous depuis très longtemps ; mais le souverain n’en reçoit rien. Ils sont mangés par les quarante mille agents de la ferme et de la régie : par eux seuls.
Réfléchissez donc, et voyez, qu’outre les vingt-deux millions que nous payons à l’armée financière, et qu’il vaudrait mieux payer au Roi notre insigne bienfaiteur, nous payons encore tous les ans, et depuis longtemps, onze autres millions, pour les frais ordinaires seulement, sans les faux frais et les pertes.
S’il faut assurer au Roi plus de vingt-deux millions, pour payer la rente du nouvel emprunt, nous aurons de quoi payer après la suppression des mauvais impôts, qui nous ruinent ; après, mais non pas auparavant.
Que diriez-vous du créancier d’une rente, qui, pouvant faire lui-même un gros bénéfice personnel et augmenter en même temps le revenu de son débiteur, s’obstinerait à n’en rien faire, et cependant exigerait d’être payé d’une redevance encore plus forte ! Voilà précisément ce que conseillent les ennemis du bien public.
Leur espoir, quel est-il ? De tromper les bonnes intentions du souverain, de sauver la gabelle et tous les mauvais impôts de l’anathème prononcé si solennellement ; de multiplier les difficultés, et d’empêcher qu’il ne luise jamais, ni pour le Roi, ni pour aucun de ses successeurs, ce jour si beau, qui ferait sa gloire, son bonheur et le nôtre.
Princes, prélats, seigneurs, magistrats, citoyens notables, c’est le piège abominable qu’on tend au mortel bienfaisant qui vous appelle auprès du trône ; à vous, dont le zèle et l’amour excitent dans son cœur généreux une si douce sensibilité.
On exagérera ces difficultés, on les éternisera. Que dis-je, on les exagérera ! Non, dès à présent, on tâche de les rendre insurmontables en apparence.
Je les sais, je les ai entendues, je les ai lues, toutes ces objections des ennemis du bien public, des vautours de l’État. Je vais les exposer et les réfuter. Je les défie de répliquer.
3°. Fausses objections des ennemis du bien public, réfutées par des faits incontestables.
Première objection fausse.
« Quand il s’agit de tout culbuter, on ne saurait agir avec trop de précaution et de lenteur. »
Tout culbuter, dites-vous ! … Qui vous parle de rien culbuter, ni rien compromettre, si ce n’est vos parts et portions des trente et quelques millions que vous dévorez tous les ans ?
S’agit-il de rien culbuter dans l’administration des domaines et droits domaniaux, qui rapportent cinquante-et-un millions tous les ans, et qui sont destinés plus spécialement, par l’antique usage de la monarchie, aux dépenses du Roi, de sa maison et de sa cour ? Non… non… je ne suis point complice de ceux qui voulaient violer sans nécessité les lois du royaume, ni de leur plan frauduleusement absurde. Je ne compromets donc aucun des objets de la dépense du Roi, en ce premier département.
S’agit-il de culbuter les receveurs généraux des finances, et la perception qu’ils font des tailles, capitations et vingtièmes, valant près de deux cents millions ? Non… non… je ne compromets donc point les dépenses de la guerre, de la marine et des affaires étrangères, les pensions et autres objets qui sont affectés sur leur produit.
S’agit-il de suspendre les rentes de l’Hôtel-de-Ville et autres ? … Non, non, il s’agit de les payer mieux que jamais, d’y consacrer tous les ans une partie des trente-trois millions, dilapidés par les quarante mille exacteurs des mauvais impôts.
« Mais les anticipations, les dettes arriérées, les avances à restituer, les six mois de rentes acquittables tous les jours, avant le moyen de recevoir les remplacements. Comment proposez-vos d’y pourvoir sans rien culbuter ? » Moi ! … comme vous, précisément comme vous, c’est-à-dire, par un emprunt et un impôt, si d’autres moyens, que je crois praticables, ne l’étaient pas… À toute extrémité, ceux d’imposer et d’emprunter, après votre suppression, seront infiniment plus faciles, plus profitables au Roi et à son peuple.
Qu’est-ce donc qu’il faut bouleverser et mettre en danger ? Rien que vos fortunes.
Seconde objection fausse.
« Mais vous mettrez donc, sur les biens-fonds, douze ou quinze vingtièmes au-delà de ceux qui existent déjà ! »
Moi mettre des vingtièmes ! … Non, j’en ôterait, et beaucoup. La gabelle, et autres mauvais impôts de la ferme et de la régie, coûtent à la nation, tous les ans, quatorze vingtièmes, outre ceux qui sont levés par les receveurs généraux des finances… Oui, quatorze vingtièmes, je l’ai démontré, dont il n’y en a que six de recette effective pour le Roi. J’en ôte six, et je propose de n’en conserver que huit ; je n’en mets donc point, comme vous dites avec tant de perfidie, et de fausseté pour tromper le public honnête.
Troisième objection fausse.
« Mais au moins conservez-vous huit vingtièmes sur les propriétaires des biens réels. » … Non… des deux cents vingt-cinq millions auxquels j’évalue le remplacement (au lieu de deux cents un que rapportent la ferme et la régie), il y en aura cinquante millions payés, avec toute justice, par les rentiers, pensionnaires, commis et gagistes de tous les départements. Reste cent soixante-quinze millions seulement, que les propriétaires avanceront.
Mais ils en recevront la majeure partie de plusieurs manières. Premièrement, il est juste de les autoriser à recevoir de leurs fermiers, locataires, et autres débiteurs annuels, au moins dix-huit deniers pour livre au-delà de leur bail ordinaire, à cause de l’affranchissement des mauvais impôts. Les fermiers y gagneront beaucoup et tant mieux ; car c’est la classe souffrante de l’État.
Secondement, il est encore juste que, pour prix du même affranchissement, ils retiennent un dixième sur les rentes qu’ils paient à leurs créanciers.
Troisièmement, ils auront eux-mêmes à meilleur marché tout ce qu’ils consomment, les journées des ouvriers, leurs nécessités de toute espèce.
Car enfin, eux, les manufacturiers, les marchands, les artisans, ne payant plus les mauvais impôts sur le sel, le vin, la viande, les cuirs, le bois et les autres denrées, ouvrages et marchandises, les vendront moins. La libre concurrence et l’immunité les y forceront, quand même ils ne le voudraient pas.
Cessez donc de témoigner une fausse pitié sur le sort des citoyens qui composent les premières classes de l’État : de la noblesse, du clergé, de la magistrature et des bourgeois propriétaires. Ils vous en dispensent, et savent bien leur compte.
Fallût-il encore payer les quatorze vingtièmes qui vous faisiez dilapider, vous fermiers et régisseurs généraux, et vos quarante mille commis, par les frais, faux frais et pertes qu’entraînent vos malheureux systèmes modernes, la plupart nés d’hier. Comme le tabac, la formule, le contrôle, les impôts sur la viande, les cuirs, l’amidon, etc., etc., etc., qui datent tous de Louis XIV et de Louis XV ; encore aimerions-nous mieux les donner au Roi qu’à vous et à vos quarante mille suppôts.
Mais vos calculs ne sont évidemment qu’erreurs et illusions, car des quatorze vingtièmes que vous coûtez depuis longtemps à la nation, il n’en sera plus avancé que sept par les propriétaires, qui s’en dédommageront encore de vingt façons très utiles et très agréables.
Dernière objection fausse.
« Mais il faut beaucoup de temps pour établir le remplacement, et il y aura des embarras et des difficultés sans nombre ». … Non… non, et je vais le démontrer par le plan même de cette opération.
Tu quid ego & mecum populus desideret audi.
HORACE.
[Écoutez ce que moi, et avec moi le public, nous voulons. — Horace, Art poétique, 153]
NUMÉRO VI.
IDÉES sur les facilités que le Roi trouverait à la réformation des mauvais impôts.
Premièrement, je ne propose point de laisser tout à coup, sans aucunes fonctions, les deux compagnies des fermiers et des régisseurs généraux en chef. Ce n’est pas de leurs personnes que je suis ennemi ; c’est du mal que causent nécessairement les systèmes des impôts modernes. Fussent-ils administrés par des anges du ciel, ils n’en serait pas moins des fléaux destructeurs; l’esprit envoyé de Dieu qui vint proposer au Roi David la guerre, la peste ou la famine, était pur et respectable, mais le moins mauvais des partis qu’il offrait, n’en était pas moins ruineux pour le peuple d’Israël.
Malgré la suppression si désirée des exactions désastreuses, il resterait toujours du sel et du tabac à vendre librement par commissionau compte du Roi, à un prix modéré, en attendant que le commerce libre en eût apporté.
Il restera toujours des comptes à rendre, des édifices dont il faudra disposer, des précautions de sagesse et d’humanité pour licencier les soldats et les officiers de l’armée fiscale.
D’ailleurs, ces deux compagnies sont exercées au travail, et bien cautionnées envers le Roi par de fortes avances.
Mon idée serait donc de les réunir en un seul corps, et de leur donner la perception du remplacement, pendant les six ans que devait durer leur bail, comme simples régisseurs comptables de clerc à maître, avec tant pour livre, comme il se pratique pour les recettes des finances.
Par eux l’opération devient extrêmement facile. Ils ont des receveurs, tels que ceux du tabac, des cuirs et autres objets qui sont dans tout le royaume.
À proprement parler, c’est un abonnement général de la ferme et de la régie, que je propose tout simplement : je prie qu’on y fasse attention, car je crois que l’objet le mérite.
La ferme et la régie, ne produisant au Roi que deux cent un million, je propose qu’on ajoute à la part du souverain les deux tiers des frais connus, qui se monte à vingt-deux.
J’ai fait ci-dessus la répartition de ceux deux cent vingt-trois millions à lever pour remplacement : savoir, cinquante sur les rentiers, pensionnaires, gagistes et salariés du Roi, au marc la livre de leurs recettes ; cent soixante-treize sur les propriétaires des biens réels, au marc la livre de leurs biens ; les cinquante premiers n’obligent à rien, et le Roi les gagne sans frais ni embarras, en ne les payant pas.
Rappelons-nous que la gabelle, les aides, la marque des cuirs, l’impôt sur la viande, etc., etc., coûtent beaucoup plus aux rentiers, pensionnaires, gagistes et salariés, que le remplacement, car ils supportent leur part des frais, faux frais et pertes, que nous faisons cesser.
Les cent soixante-treize millions à prendre sur les biens réels, au marc la livre de leur valeur, seraient donc le seul objet du travailà faire par ses deux compagnies financières unieset par leurs préposés.
Il faudra commencer la première année par une fausse position, comme on dit en arithmétique, et dès la seconde vous serez en règle.
Prenez donc cette année une nouveau dixième des rentes, pensions, gages et salaires, et un centième de la valeur des biens réels, j’entends valeur ordinaire effective (non valeur d’opinion et de convenance), opérés sur cette proportion. Il en arrivera que les produits seront au juste les deux cent vingt-trois millions, ou plus ou moins.
Si le dixième de remplacement réparti sur les paiements à faire par le Roi produit plus de cinquante millions, vous diminuerez au marc la livre, et vous imputerez le trop payé de cette année sur l’année prochaine ; si c’est le contraire, vous augmenterez au marc la livre, et vous ajouterez l’année prochaine un double supplément pour compenser le déficit de celle-ci. C’est précisément la même chose pour le remplacement de cent soixante-treize millions annuels, répartis sur la valeur effective des biens réels.
« Mais comment connaît-on cette valeur ? » Très aisément : c’est un fait connu dans chaque paroisse. Les percepteurs auront leur préposé. Ce ne sera pas un juge, mais au contraire la partie adverse de chaque propriétaire, pour estimer pièce à pièce, toute portion de bien séparément, sans aucun rapport avec une autre.
« Mais si le préposé n’est pas d’accord avec le propriétaire ? » Eh bien, ils feront comme tous les honnêtes gens en pareil cas. Ils nommeront chacun leur arbitre. Qu’un tiers par eux nommé, départagera s’il est besoin.
« Mais si les arbitres me condamnent mal à propos ? » Eh bien, vous en appellerez au bureau des finances, où présidera l’Intendant, où le Roi fera siéger comme honoraires trois anciens chevaliers de Saint-Louis et trois ecclésiastiques notables, outre les membres actuels, présidents, trésoriers, procureurs et avocats de Sa Majesté.
« Mais si j’y souffre injustice notable ? » Eh, vous aurez encore le recours au Conseil, sauf toujours néanmoins l’exécution provisoire.
Où sont donc les embarras et les difficultés de ce plan ? Il y en a dix mille fois moins que dans les machines si compliquées de la ferme et de la régie. C’est la limpidité du cristal.
« Mais en attendant, qui fera le service des rentes de l’Hôtel-de-Ville et autres, assignées sur le service des gabelles ? » … Qui ? … les deux compagnies de finances unies… ; par les moyens très simples, qui seront pris de concert avec elles, pour leur sûreté, leur indemnité parfaites. C’est en faisant ainsi le service nécessaire qu’elles mériteront la confiance de la nation et du Roi, qu’elles partageront même avec leur souverain les bénédictions du peuple français. Grande et belle révolution à tous égards !
Je ne culbute donc rien au monde, au lieu de tout renverser, comme on voulait m’en accuser avant de m’entendre.
La dépense du Roi, de son auguste épouse, de sa famille, de sa cour, de la guerre, de la marine, des affaires étrangères et des pensions en dépendantes, je n’y dérange rien, je n’y mets pas en péril la plus petite partie, elles sont assignées sur la régie des domaines, sur les recettes générales des finances, auxquelles je ne touche pas.
Les rentes, je n’y dérange rien ; les deux compagnies financières qui auront à recevoir le remplacement, feront le service.
Reste quoi ? La dette criarde ou exigible, les anticipations, etc. Mais j’ai réservé au Roi : 1°. les épargnes des quatre secrétaires d’État auxquels nous avons assigné des fonds qui surpassent leurs dépenses, que le Roi réforme actuellement ; 2°. les postes ; 3°. les loteries ; 4°. les parties casuelles ; 5° l’extinction des rentes viagères, et les décimes du clergé, dont jusqu’à présent je n’avais point annoncé la destination. Eh bien ! le voilà tout naturellement le fonds nécessaire à l’extinction de la dette criarde ou non fondée, des anticipations et dettes arriérées. Un comité des finances n’aura plus qu’à régler la manière d’appliquer ces revenus à l’entière liquidation des créances exigibles. Mais si vous empruntez, que ce soit pour la dernière fois ; car je vais vous démontrer les effets du crédit.
Notables ! notables ! Souvenez-vous de l’ancien apologue : « Qui regarde au ciel, tombe dans les fossés » ; ou de l’œuf de Christophe Colomb : peuple excellent, mais léger. Français ! Français !
… Mutato nomine de te
Fabula narratur…
HORACE
(Changez le nom, et l’histoire qu’on raconte, c’est la vôtre.)
NUMÉRO VII.
IDÉES sur le crédit et ses effets, d’après le dernier mémoire de M. N***
En 1776, feu M. de V*** [5], excité par d’autres ministres, et par des particuliers à vues peu désintéressées, préparait la guerre contre l’Angleterre. M. de M*** [6]y répugnait, et les gens sages annonçaient d’avance qu’il en coûterait plus de deux cent mille hommes perdus, plus de douze cent millions de dépenses extraordinaires, outre les revenus courants, et de plus de soixante millions de nouvelles rentes à payer pour des succès douteux, probablement très médiocres.
Ces prédictions, calculées sur la dépense de la dernière guerre faite par Louis XV, furent traitées de chimères et d’exagérations. Je fis imprimer alors, avec censure, approbation et privilège, dans les Éphémérides du mois de juillet, l’état des dépenses extraordinaires du feu Roi pendant sa dernière guerre, qui passaient douze cent millions, suivant les édits ou arrêts du Conseil, imprimés et publiés successivement lors de chaque emprunt.
Ce rapprochement très innocent me valut, après une scène très vive de la part du magistrat qui régissait alors, comme tout le monde sait, la police et la librairie, une suppression des Éphémérides, etc.
Dès lors M. N*** [7], encore simple particulier, fournissait des mémoires pour déterminer les hostilités. Il promettait « de procurer enfin l’étendue de crédit que la France mérite, et qui lui est, dit-il, si nécessaire. » Il vient même d’en donner un petit extrait dans son nouvel écrit (page 26). [8]
C’est donc à ce fameux banquier genevois, et à ses idées sur son art, que la nation française est redevable de la dernière guerre. Il nous donne aussi le résultat de ce fameux crédit, qu’il annonçait comme nécessaire.
Ses partisans ont dit qu’un seul homme en était le créateur, qu’il possédait le secret des emprunts exclusivement à tout autre, ou du moins qu’il excellait dans la science de faire des dettes.
Lui-même vient de les détromper dans ses derniers mémoires : il est vrai que depuis le mois d’octobre 1776, jusqu’en mai 1781, ce qui fait près de cinq ans, il sut emprunter cinq cent trente millions, qui chargeaient l’État d’environ quarante-cinq millions de rentes, comme il le dit avec complaisance dans son nouveau mémoire (pag. 34 et 35).
Son successeur immédiat[9], qui ne s’en glorifie pas, emprunta, dans l’espace de deux ans, plus de trois cents millions, et le dernier contrôleur-général[10], en trois années seulement, plus de huit cents millions, suivant l’état qui se trouve au bas des pages 88 et 89 du nouveau mémoire.
L’art d’emprunter à 8,5%, l’un portant l’autre, n’est donc pas un de ces talents rares, que Dieu dispense à peu d’hommes privilégiés, comme on l’a tant dit et répété depuis 1776.
L’effet de ce crédit si merveilleux et si nécessaire, quel est-il donc aujourd’hui ? D’avoir consommé dans l’espace de dix ans, un milliard six cent quarante-cinq millions, qui font payer à l’État au moins cent trente millions de nouvelles rentes annuelles.
Si les mémoires fournis en 1776 n’avaient pas établi la confiance qu’un banquier étranger s’efforçait d’inspirer, et n’avaient pas déterminé la guerre, qui seule pouvait rendre le crédit nécessaire, quel grand malheur serait-il donc arrivé au royaume de France ? Quels sont donc pour le Roi, pour ses bons et fidèles sujets, les grands avantages qui compensent la dilapidation de seize cents millions, avoués aujourd’hui par ceux-mêmes qui m’accusaient avant tant d’humeur, d’exagérer, quand je leur disais qu’il en faudrait douze cents ?
Cent trente millions au moins de nouvelles charges annuelles sur le Roi, sur son peuple, c’est là ce qu’il faudrait compenser, par les avantages que je demande à connaître. Où sont-ils, et combien valent-ils ? Ce serait à l’auteur des mémoires secrets de 1776 à nous les indiquer s’il pouvait.
Des profits! il y en a eu sans doute, et je vais les indiquer. 1°. Ceux des entrepreneurs, fournisseurs, viviers et part-prenants. 2°. Ceux des rentiers oisifs, classe parasite des États policés. Le patrimoine que dévorent ces insectes politiques, s’est accru pendant la guerre de plus de quatre cents millions, par les emprunts de toutes les puissances belligérantes.
Des profits ! il y en a eu d’énormes pour les banquiers négociateurs des emprunts, qui ne sont d’aucun pays (comme le disait M. N*** lui-même dans ses gros volumes in-8°).
La totalité des dettes contractées par tous les États européens pendant la dernière guerre, étant d’environ cinq milliards, les banquiers qui les ont négociés n’eussent-ils gagné, l’un portant l’autre, que 4 à 5% sur les emprunts, il en résulterait néanmoins un bénéfice réel, évident de plus de deux cents millions de capital, recueillis par ces banquiers, agents et négociateurs.
Ils sont réels, ils sont clairs, ils sont immenses ces profits des trois classes dévorantes. Mais les souverains, mais les sujets, que leur reste-t-il ? Des hommes de moins, on les a tués ; des choses précieuses de moins, on les a consommées sous les deux hémisphères ; des revenus de moins, ils sont absorbés par les dettes, et ne servent plus qu’aux jouissances des célibataires, des parvenus et des patricotteurs d’emprunts.
En France, il faut que toutes les classes utiles et laborieuses de la nation paient tous les ans plus de cent trente millions pour tribut aux rentiers, au-delà de ce qu’elles leur donnaient autrefois ; c’est là ce qu’ont opéré les mémoires secrets de 1776, dont les fragments viennent d’être publiés (pag. 26 et suiv.)
Dès 1777, on avait augmenté sourdement les impôts de plusieurs manières, avouées enfin dans le nouveau mémoire (page 41, n°9 ; page 42, 43 et 44, nos12, 13, 14 et 15 ; page 46, n°18 ; page 49, n°25) et l’on avait supprimé pour plus de sept millions d’actes de justice annoncés, promis, effectués jusqu’alors par le Roi, depuis son avènement au trône, page 42, n°11. Les emprunts ont fait le reste.
Imposer plus fort les contribuables, se dispenser de paiements promis, et emprunter, c’est une science, comme on voit, très commune et très facile.
D’ailleurs, on avait emprunté à rente viagère à 10%, sur trente ou quarante têtes genevoises, avec gros agios de banque ; on avait employé cet argent si cher à rembourser des capitaux qui ne coûtaient que moins pour cent d’intérêt, et qu’on aurait fort bien reconstitués en perpétuel à cinq ; par là, plus de dix millions annuels de charges du moment, assignées en remboursements, avaient disparu, pour y substituer d’autres charges plus lourdes pour l’État, plus durables, mais plus avantageuses aux banquiers négociateurs.
Joignez à ce tableau l’accroissement naturel du prix des fermes et régies, qui s’est trouvé de même à toutes les rénovations de baux, soit avant, soit après 1780 (quelque régisseur qu’il y eût alors en place), et pour dernier objet, toutes les extinctions annuelles des rentes viagères.
De ces articles, qui viennent d’eux-mêmes, il résultait naturellement en 1780, sans efforts, ni bonheur, ni mérite, un accroissement de quatre-vingts millions dans les revenus ordinaires du Roi.
Si la paix eût duré jusqu’à cette époque, ces revenus, améliorés d’une somme si considérable, auraient excédé de beaucoup les dépenses ordinaires, et le monarque aurait pu commencer dès 1780 l’opération qu’il désire avec une ardeur si louable : le remboursement de ses dettes.
Car enfin, s’il est vrai qu’en janvier 1781, il y eût déjà dix millions de recette plus que de dépense, quoiqu’on eût créé depuis la fin de 1776 pour trente-cinq millions et demi de nouvelles rentes, comme on l’avoue dans le nouveau mémoire (page 35), il y aurait donc eu quarante-cinq millions d’épargnes sans les emprunts ?
Le ministre des finances[11] n’aurait donc pas été forcé de mettre, en 1782, les nouveaux sous pour livre et le troisième vingtième. Lui et son successeur[12] n’auraient pas été obligés d’emprunter onze cents millions, qui coûtent maintenant au Roi quatre-vingt-dix millions par an, indépendamment des quarante-cinq millions de charges annuelles, créées depuis 1776 jusqu’en mars 1781, et avouées enfin avec le sang froid le plus merveilleux (page 35).
Tels sont les fruits de ce fameux crédit, si vanté, comme nécessaire, dans les mémoires clandestins de 1776, et des hostilités qu’ils ont déterminées. Ils ont été fort doux aux viviers, entrepreneurs et fournisseurs, à leurs protecteurs et part-prenants ; fort doux aux rentiers oisifs et aux autres vampires de cette espèce ; fort doux principalement aux banquiers négociateurs des emprunts.
À qui sont-ils amers? Au Roi et à la nation. Car enfin, sans le crédit et les emprunts, il y aurait tous les ans cent trente millions de moins à prendre dans la poche des citoyens utilement laborieux de l’État, pour les verser dans celle des rentiers parasites.
Le Roi pourrait lever soixante millions de moins, ce qui rendrait son peuple très heureux, et néanmoins avoir soixante millions de plus pour sa dépense, et pour l’acquittement des emprunts de son prédécesseur.
Français ! Français ! Regardez au moins une fois derrière vous. Le temps du fol enthousiasme doit être passé. Calculez ce qu’a produit ce beau crédit, cet art si trivial de faire des dettes. Vous avez un Roi probe et désireux de faire le bien. Il peut encore soutenir, mieux que jamais, les intérêts de son état et la majesté de son trône, payer ses créanciers et n’en plus faire. Il le peut et le veut. Mais que son peuple ne se laisse plus abuser par les prestiges des vampires politiques, entrepreneurs, fournisseurs, viviers, rentiers oisifs et banquiers agioteurs d’emprunts ; qu’il regrette ses anciennes erreurs et se précautionne contre celles de l’avenir. C’est le cas de dire comme Virgile, aux classes dévorantes, qui ruinent les nations et les souverains :
Claudite jam rivos, pueri, sat prata biberunt.
[Fermez les ruisseaux, mes enfants, car les prés ont passé bu. — Virgile, Églogues, III, 111.]
ÉCLAIRCISSEMENTS sur le déficit de l’année 1781.
Existait-il un déficit en 1781 ? Était-il supérieur à celui de 1777 ?
Les uns ont assuré le fait ; ils ont cru le prouver : les autres l’ont nié, soutenant que la preuve était fausse.
Lesquels avaient raison, lesquels avaient tort ? ……. À mon avis, tous avaient raison et tous avaient tort ; je crois fermement que le fait est vrai, mais que les preuves alléguéesétaient réellement fausses.
Voici le mot de l’énigme et l’explication de l’A, B, C, D, qu’il faut savoir.
A… Anticipations, ce sont des mandatstirés sur les revenus ordinaires de l’année future; mandats acceptéspar les receveurs ou fermiers du Roi. Les porteurs en ont fourni les fonds, cette année, pour une dépense extraordinaire qui les a consommés d’avance.
B. Balance ; c’est le résultat d’une comparaison qui se fait tous les ans, entre les revenus ordinaires à recevoir l’année future, et les dépenses ordinaires du Roi, pendant cette année.
Niveau, c’est quand la dépense ordinaireest égale aux recettes ; excédent, c’est quand elle est inférieur. D. Déficit, c’est quand elle est supérieure aux revenus ordinaires.
Un exemple fera mieux comprendre. Vous jouissez de vingt mille livres de rentes disponibles à Paris ; vous avez dépensé jusqu’à présent vingt mille livres par an, c’est niveau : vous voulez dépenser, cette année, vingt-et-un mille livres, c’est cent pistoles de dépense extraordinaire. Vous ne pouvez y fournir qu’en faisant une anticipation sur vos revenus à venir.
Deux manières se présentent, l’une d’emprunter par contrat de rentes perpétuelles ou viagères ; l’autre par obligation à termes fixes, par billets, ou par mandats tirés sur vos fermiers qui les accepteront.
Mais de quelque façon que ce soit, vous opérez une diminution de vos revenus ordinaires, et si vous voulez, en 1788, continuer vos dépenses courantes sur le pied de vingt mille livres par an, il y aura dans la balance un déficit.
Si vous avez emprunté à rentes constituées, le déficit sera de cinquante livres ; si c’est à rente viagère il sera de cent livres. Au contraire si vous avez donné des billets ou des mandats acceptés sur vos fermiers, pour le total de mille livres, le déficit sera de cent pistoles, car vous n’aurez plus à recevoir par vous-même que dix-neuf mille livres.
Déficit est donc l’effet nécessaire d’anticipation, lorsque la dépense ordinaire n’est pas diminuée d’autant. Suivant notre exemple, pour n’avoir point de déficit dans votre balance de 1788, il faudrait vous réduire à ne dépenser que dix-neuf mille livres, ayant mangé d’avance les cent pistoles que votre fermier ne paiera plus à vous, mais au porteur de votre mandat.
Ces notions préliminaires une fois acquises, il ne s’agit plus que de savoir : 1°. s’il existait à la fin de 1780 des anticipations sur les revenus ordinaires de l’année suivante, en forme de mandats au porteur, acceptés par les fermiers ou receveurs des deniers du Roi ; 2°. pour quelle somme il en existait alors ; 3°. combien étaient de la création du ministre qui gouvernait à cette époque.
S’il avait été fait pour cent millions de mandats, au porteur, acceptés et payables sur les revenus ordinaires de l’année suivante.
Si cependant le total de ces revenus ordinaires n’était pas au-dessus mais seulement un peu au-dessous des dépenses ordinaires, les cent millions de mandats acceptés opéraient nécessairement un déficit, de cette somme dans la balance à faire en 1781 pour 1782.
Ouvrons donc à présent le compte rendu de janvier 1781 ; la balance porte que les revenus ordinaires surpassent la dépense ordinaire de dix millions deux cents mille livres, le nouveau mémoire du même auteur confirme ce fait (page 73).
Mais premièrement, en 1781, le droit sur les marchandises des colonies appelé domaine d’Occident, produisait à cause de la guerre, un ou deux millions de moins que ne portait le compte rendu, on en conviant dans l’appendis (page 93).
Secondement, dès le mois de février et de mars, on avait crééneuf millions et demide nouvelles rentes viagères (nouveau mémoire, page 85).
L’excédent des revenus, annoncé pour dix millions en janvier, n’existait donc plus dès le mois de mars 1781, parce qu’on avait fait les fonds extraordinaires de la campagne, par deux emprunts à rentes viagères. La recette totale ordinaire était donc alors un peu inférieure aux dépenses ordinaires.
Mais existait-il une anticipation d’environ cent millions sur cette recette totale ordinaire : anticipation sous la forme de mandats au porteur acceptés et payables non plus au Roi, mais aux porteurs qui en avaient fourni les fonds, déjà mangés d’avance ? … Voilà toute la question.
Dans l’appendix du nouveau mémoire (page 97, vers le milieu), on convient que les intérêts et frais de ces anticipations ont été calculés dans le compte rendu à raison de 5,5%. Premier fait.
Maintenant consultons le compte rendu, état des dépenses. Art. XVI, on y lit : « intérêts et frais des anticipations, cinq millions et demi ». Second fait. Il y en avait donc pour cent millions. La conséquence me paraît juste.
Observez que ce ne sont pas les intérêts seulement de ces anticipations qui sont assignés sur les receveurs ou fermiers, pour être acquittés sur les revenus ordinaires de l’année suivante (ces intérêts se paient d’avance lors de la négociation). C’est le capital tout entier qui est exigible, et qui est rendu en vertu du mandat.
Les revenus ordinaires qui se trouvent détaillés dans le premier état du compte dressé pour 1781, étaient donc diminués pour celui de l’année suivante, de cent millions qui n’appartenaient plus au Roi, mais aux porteurs des mandats.
La dépense ordinaire ayant toujours subsisté sur le même pied qu’elle se trouve énoncée dans ce compte rendu, le ministre[13] qui vint vers le milieu de 1781, voulant comparer cette dépense du Roi avec la recette effective, trouva donc « qu’il s’en manquait environ cent millions, qu’il n’eût à recevoir des revenus ordinaires, de quoi payer les dépenses ordinaires en 1782 » ; c’est là, je crois, ce qu’on appelle le déficit annuel.
Depuis 1776, chacun des ministres paraît en avoir trouvé, et en avoir laissé; l’opération est très simple. Mon prédécesseur avait mangé d’avance cinquante millions des revenus ordinaires de cette année, qui ne seront pas comptés au Roi, mais aux porteurs des anciens mandats. Je vais créer, cette année, des mandats nouveaux sur l’année prochaine, j’en recevrai d’avance la valeur, par ce moyen je couvrirai le déficit, et je serai au pair ; mais à la fin de 1776 il n’y en avait que pour soixante millions, et depuis cette époque, non seulement on les avait renouvelées d’année en année, mais encore on les avait augmentées de quarante millions pour les porter à cent. Qui nous l’a dit formellement ? C’est le directeur général d’alors lui-même dans son nouveau mémoire (page 34).
Le fait est donc vrai, mais, pour l’établir, on n’avait donné réellement que des mauvaises preuves. Le nouveau mémoire de l’ancien régisseur a démontré la fausseté de ces preuves.
Si je me suis trompé dans la mienne, il est le maître de m’éclairer, c’est dans ses propres écrits que j’en ai pris de bonne fois tous les éléments.
J’y trouve 1°. qu’en 1781, il y avait des arrangements faits pour consommer d’avance environ cent millions des revenus ordinaires de 1782, compris dans le premier état du compte rendu. 2° Que dès le mois de mars le total de ces revenus ordinaires était un peu au-dessous des dépenses ordinaires portées dans le second état du compte rendu. J’en tire (sans partialité ni malin vouloir) cette conséquence, que le nouveau ministre des finances, faisant sa comparaison ou balance entre les revenus ordinaires qu’il aurait à recevoir en 1782 pour le Roi et les dépenses ordinaires, devait trouver un déficit de cent millions. Ce Q. F. D.
ÉCLAIRCISSEMENTS SUR LES OBJETS PROPOSÉS À L’ASSEMBLÉE DES NOTABLES.
Jusqu’à présent les notables n’ont reçu que deux plans généraux, l’un est proposé dans les mémoires adoptés par le ministre, imprimés in-4° chez Pierre à Versailles, l’autre est contenu dans un écrit, intitulé Charles V, Louis XII et Henri IV aux Français, in-8°.
Les objets dont il s’agit dans ces plans, peuvent se réduire à deux espèces, dont l’une regarde plus directement le pauvre peuple de Paris, des autres villes et des campagnes ; l’autre ne le concerne que d’une manière indirecte. On va les comparer sous ces points de vue.
PREMIERS OBJETS, Qui concernent directement le pauvre peuple.
Ces objets sont la gabelle ; elle vend au peuple quatorze sols la livre de sel, qui, suivant les fermiers généraux eux-mêmes, n’en vaut que deux.
Les Aides. Elles font qu’un tonneau de vin qui coûte en Languedoc quarante francs, paie près de cent écus de droits aux régisseurs avant d’entrer dans la cave du marchand de Paris.
Les impôts sur la viande, qui obligent de la vendre au peuple de Paris plus de douze sols la livre à cause de la réjouissance, pendant qu’elle ne coûte pas sept sols dans les campagnes de province.
L’impôt sur les cuirs, qui détruit les tanneries du royaume, et qui a fait presque doubler le prix des souliers et autres marchandises en peaux de toute espèce.
Le monopole du tabac vendu cinq sols l’once par les fermiers généraux, pendant qu’elle ne vaut pas un sol.
Les droits sur l’huile et les suifs, qui, joints à d’autres causes, font monter la chandelle et la consommation des lampes à des prix excessifs.
Les impôts sur les poissons, les légumes, les œufs, le beurre et le fromage, sur la toile et sur les étoffes de laine, qui augmentent sans cesse le prix de la nourriture et des plus pauvres vêtements.
Ce qui rend toutes ces marchandises plus chères, c’est qu’il y a quarante mille commis qui coûtent trente-trois millions de gages et frais connus ; sans compter ce que le vulgaire appelle le tour du bâton, c’est-à-dire ce que pillent sourdement les commis particuliers, sans compter les frais des saisies, des procureurs, avocats, greffiers, juges, contrôles et papier marqué, pour des millions de procès ; sans compter les pertes de temps et de marchandises.
De ces quarante mill commis, il y en a autour du royaume pour défendre qu’on apporte des pays étrangers les marchandises dont les fermiers font le monopole, ou pour faire payer de gros droits à toutes les autres.
Il y en a, dans le dedans même de la France, un second cercle qui sépare la moitié des provinces d’avec les autres, et notamment d’avec la généralité de Paris.
Il y en a dans toutes les villes et gros bourgs, pour faire payer aux portes et barrières.
Ces quarante mille commis ne font rien que des visites, des rondes, des recettes forcées ; il y a partout des fraudeurs et contrebandiers, qui sont peut-être aussi quarante mille autour du royaume et de chaque muraille ou barrière pour éviter les droits.
Mais ces fraudeurs vendent toujours les marchandises qu’ils ont passées plus cher qu’elles ne vaudraient, s’il n’y avait pas de taxe, quoiqu’ils fassent un peu de bon marché.
D’ailleurs comme il y a beaucoup de temps perdu par les marchands et voituriers, comme on les oblige à payer les impôts en argent comptant, longtemps avant de les vendre, ils sont forcés de les renchérir d’autant.
Il résulte de tout cet embarras, que d’un écu par le pauvre peuple, il n’en revient pas trente-six sols au Roi à beaucoup près, il y en a plus de vingt-quatre sols perdus en chemin.
Les fermiers généraux et les régisseurs, ni leurs premiers employés, ne profitent pas eux-mêmes de la dixième partie de ce gaspillage ; les appointements des quarante mille commis, les profits des quarante mille fraudeurs, la perte de quatre-vingt mille journées de bon travail, que feraient ces gens-là tous les jours, celle des marchands et autres, n’entrent point dans la poche des gros financiers, pas plus que dans celle du Roi, quoiqu’ils surchargent tous les bons citoyens français, surtout les pauvres.
Car tout le monde paie ces impôts là, et les paie de même, depuis les frères du Roi et les princes du sang, les ducs et seigneurs, les archevêques, les évêques et les prêtres, jusqu’au dernier des malheureux.
Mais ils sont bien plus fâcheux pour le pauvre peuple que pour les riches. Un gros rentier, qui a cinq ou six mille livres de revenus viagers sur le Roi, ni femme, ni enfants, mais un seul laquais, ne mange que quinze ou vingt livres de sel par an ; un ouvrier qui a sa femme avec cinq ou six enfants, en mange cinquante ou soixante, le double ou le triple du riche.
Le plus grand seigneur, et le plus opulent financier, ne paient pas plus aux entrées de Paris, pour le meilleur vin de Champagne et de Bourgogne, et la plus excellente eau-de-vie, que le dernier manœuvre, pour du vin de Surêne ou du mauvais brandevin.
Sur ces impôts si coûteux et si injustement perçus, que disent les deux plans ?
Celui des mémoires in-4° les laisse subsister en y faisant quelques changements.
Celui des idées d’un citoyen les supprime tout à fait.
Suivant le premier projet, que les notables n’ont point voulu adopter :
Le sel qui ne coûte aux fermiers généraux que deux sols, serait payé dix sols et quelques deniers par le pauvre peuple, et on le forcerait solidairement à prendre tant de livres par tête, y compris les femmes et les enfants.
Le vin, l’eau-de-vie et le tabac ne coûterait pas une obole de moins à Paris, ni dans les autres villes du royaume. La viande, les cuirs, le poisson, les légumes, les œufs, le fromage et le beurre, tout autant, sans nul soulagement.
Il n’y aurait de même que peu ou point de diminution sur le sucre, le café, les épiceries, et les autres marchandises qui viennent par mer ou par les pays étrangers.
On laisserait subsister tous les commis et tous les contrebandiers qui sont autour du royaume, tous ceux qui sont au-dedans et au-dehors des murailles et barrières de Paris, et des autres villes du royaume, sans exception : toujours des rondes, visites, saisies, amendes, confiscations, emprisonnements et supplices.
Dans le second plan proposé par un simple citoyen, mais vers lequel on a vu plusieurs des notables témoigner quelque inclination :
Le sel se vendrait librement comme toute autre marchandise, et ne coûterait que deux sols la livre ; le tabac environ quinze sols ; le vin diminuerait de six sols au moins par bouteille ; la viande de plus de quatre sols : le reste à proportion, notamment les souliers, le poisson, les légumes, les œufs, le beurre et le fromage.
Il n’y aurait plus de barrières, de commis, de contrebandiers, de visites, de procédures, de prisons, de galères, ni de gibets.
Qui paierait à la place des deux cents millions que le Roi reçoit de son peuple entier, y compris les pauvres ? … Qui ? les riches, c’est-à-dire les rentiers, à proportion de leurs rentes ; les pensionnaires, les commis et gagistes, à proportion de leurs gages… Les ecclésiastiques, les nobles, les bourgeois, propriétaires des fonds, à proportion de la valeur de leurs terres.
Et le pauvre ouvrier, l’artisan, le marchand, le manufacturier, combien en paieraient-ils, et de quelle manière, suivant ces idées ? Rien sous aucune forme ; rien du tout, si ce n’est qu’ils vendraient eux-mêmes à meilleur marché leurs denrées, pour lesquelles ils n’auraient point payé d’impôts et leur travail journalier ; parce qu’ils auraient eux-mêmes presqu’à moitié prix tout leur nécessaire : ces diminutions seraient au profit du bourgeois, des ecclésiastiques et des nobles, des rentiers et gagistes, qui se récupéreraient ainsi de l’avance qu’ils auraient faite au Roi.
Il est possible qu’on fasse d’autres difficultés spécieuses contre ce dernier plan ; mais vouloir persuader au pauvre peuple qu’il lui est préjudiciable, ce serait une absurdité manifeste.
Les princes, les seigneurs, les magistrats, qui composent l’assemblée des notables, ont examiné directement que la gabelle, n’ayant été consultés, jusqu’à présent, que sur cet article des fermes et régies.
On leur proposait de mettre le sel à dix sols un liard, au lieu de quatorze sols ; mais, en forçant tout le monde solidairement d’en prendre tant par tête, ils ont dit : « Il vaut mieux ôter la gabelle en entier, rendre le sel libre, et qu’il ne coûte que deux sols. » Cette réponse a décidé ce qu’ils diraient, quand on leur parlerait des impôts sur la bière, le cidre, le vin et l’eau-de-vie ; sur la viande, le poisson, les œufs, les légumes, le beurre et le fromage ; sur les cuirs, les toiles et les étoffes.
« Mais, a-t-on dit, la gabelle rapporte au Roi soixante-et-un millions. Qui les paiera ? » Qu’ont répondu les notables ?
« Nous, les riches. Les rentiers, les commis, les gagistes, en premier lieu. Ces gens-là ne paient ni tailles, ni vingtièmes, ni capitation sur leurs rentes ; mais ils y paient la gabelle. Si notre bon Roi la supprime, il n’est pas juste qu’ils en profitent seuls pour rien. »
Les notables ont ajouté : « Tout le reste nous le paierons sur nos biens et fonds, nous princes, seigneurs, nobles, ecclésiastiques, magistrats et bourgeois. Nous en retrouverons une partie, en augmentation de nos fermes ; une autre, en retenant un dixième à nos créanciers sur leurs rentes ; une autre partie, par la diminution des marchandises et salaires que la gabellerenchérit nécessairement pour nous tous. »
SECONDS OBJETS, Qui ne concernent pas si directement le pauvre peuple.
Il s’agit des vingtièmes de la capitation des nobles, et des décimes des ecclésiastiques.
Les rédacteurs du plan contenu dans les mémoires imprimés chez Pierre, ont fort institué sur des faits très connus ; savoir, 1°. que les seigneurs ne payaient pas à beaucoup près au Roi, ce qu’ils devaient pour les vingtièmes.
2°. Que les décimes des ecclésiastiques ne rapportaient pas au Trésor royal le tiers de ce que paient les bénéficiers, quoique plusieurs donnent six vingtièmes effectifs de leurs revenus ; parce que le clergé a été obligé d’emprunter, et doit tous les ans une forte somme à ses créanciers pour intérêts et remboursement.
Ils ont conclu de ces faits, qu’il fallait supprimer totalement les vingtièmes actuels, la capitation des nobles, les décimes des ecclésiastiques.
Pour suppléer aux revenus que le Roi tire de ces trois objets, ils proposaient un impôt en nature, pris sur les terres, au moment de la récolte ; et cet impôt devait leur servir en outre à deux objets considérables : savoir, à remplacer ce qu’ils voulaient perdre sur la gabelle et autres petits droits adoucis, et à remplir une grande quantité de millions qu’ils dépensaient au-delà des revenus, d’où naissait le prétendu besoin d’emprunter sans cesse.
L’auteur du second plan a démontré d’abord que la perception des fruits en nature coûterait aux possesseurs et fermiers beaucoup plus du double des sommes qui seraient portées au Trésor royal ; 2°. qu’elle serait aussi injuste, que la gabelle, les aides, les impôts sur la viande, le poisson et les cuirs ; 3°. qu’elle entraînerait des vexations, difficultés, embarras et monopoles sans nombre.
Il a remarqué d’ailleurs qu’il était bien facile de corriger les défauts évidents des vingtièmes et décimes ; qu’il s’agissait de faire payer à chacun ce qu’il doit, et de ne plus obliger le clergé à faire des emprunts.
« Pourquoi, dira-t-on, conserverles vingtièmes et les décimes », plutôt que tous les impôts de la ferme et de la régie ? Pourquoi ? ……
1°. Parce qu’ils coûtent le moins de frais possible ; trois vingtièmes et deux décimes, qui vaudraient environ cent millions, n’en coûteraient pas quatre de frais : de mais de plus ils ne coûteraient aucuns faux frais, aucune contrebande ; il n’y a point de pilleries secrètes, point d’armées, de commis et de fraudeurs, point de pertes de journées et marchandises, point de visites, saisies, confiscations, cachots et supplices.
2°. Parce qu’ils ne sont point payés par le pauvre peuple, qui n’a point de terres ni de biens-fonds, ni de rentes.
« Mais on s’oppose au Roi, quand il veut corriger les défauts, c’est-à-dire faire payer à chacun ce qu’il doit. » Vous le dites ! Mais vous avez vous-même assuré le contraire dans votre premier mémoire, pages onzième et douzième. Dès 1772, il fut ordonné « qu’on ferait une vérification » ; elle a été faite, sans oppositions, sur près de cinq mille paroisses.
« Mais elle a duré dix ans, et a cessé tout à coup en 1782. » Ces deux faits sont vrais ; mais ils viennent l’un et l’autre de l’administration : c’est elle qui a usé de lenteurs ; c’est elle qui a consenti sans peine à cesser les vérifications, pour faciliter l’imposition d’un troisième vingtième.
« Mais les questions de détails sont immenses ; elles font jugées par les Intendants seuls. » Immenses ! Non, et vous le prouvez par l’exemple des cinq mille paroisses ; les lenteurs ne sont pas venues de l’ouvrage, mais des ouvriers : quant aux jugements, qui empêche de donner pour assesseurs aux Intendants, quand ils jugent, le Bureau des finances, qui est plus ancien qu’eux dans la monarchie, et compétent, composé de magistrats, d’un président très notable, d’un procureur, d’un avocat du Roi, de greffiers et autres officiers nécessaires à des jugements, et qui en a le loisir ?
« Mais quelques-uns de ces sièges sont mal composés. » Eh bien ! composez-les tous mieux ; il devrait, suivant leur institution, y siéger des chevaliers d’honneur : on en a fait des charges sans fonctions. Invitez de bons gentilshommes, officiers supérieurs retirés du service, de vrais chevaliers de Saint-Louis, à y siéger comme honoraires, sans charges vénales et sans gages. Appelez-y des ecclésiastiques distingués, comme les chefs des chapitres, et les abbés commendataires de la généralité, que le Roi en trouvera capables ; ils y seront des juges éclairés et désintéressés.
Cet arrangement légal, qui remédie à tout, n’est point une innovation dangereuse ; c’est l’antique et véritable esprit de la monarchie.
Les notables n’ont encore pris aucun parti définitif, parce qu’on ne leur a pas donné les connaissances qu’ils ont demandées ; mais, en parlant de la gabelle, ils ont témoigné qu’ils conseilleraient de la détruire absolument, comme injuste et ruineuse pour le pauvre peuple, pour les riches et pour le Roi lui-même : on a prévu qu’ils en diraient autant des autres impôts payés par la partie la plus indigente de la nation.
Qui est-ce qui perdrait, si le Roi, plein d’amour pour le bien de son peuple, embrassait ce parti ? … Qui ! les employés de la ferme et de la régie générale, et leur part prenant : Eux tous seuls… Combien perdraient-ils ? Trente-mois millions tous les ans, sans compter les pilleries sourdes et les profits clandestins.
Qui gagnerait ? … Qui ! le pauvre peuple tout le premier, car il aurait le sel à deux sols, au lieu de quatorze ; la bière, le cidre, le vin, l’eau-de-vie, la viande, les légumes, le poisson, les œufs, le beurre, le fromage, les cuirs, la toile et l’étoffe à meilleur marché, sans impôts.
Qui gagnerait ensuite ? le Roi, la noblesse, le clergé, les propriétaires et toute la nation. Ainsi soit-il.
IDÉES D’UN CITOYEN.
SUPPLÉMENT À LA SECONDE PARTIE.
NUMÉRO VII.
ANALYSE DES ÉTATS DE RECETTES ET DÉPENSES communiquées aux notables.
Plus on examine la situation actuelle, mieux on reconnaît cette grande et consolante vérité, si mal à propos couverte des plus épaisses ténèbres : « que le Roi peut soutenir mieux que jamais les droits de sa couronne et la splendeur de sa cour ; payer ses dettes et n’en plus faire. » Je vais la démontrer par les états même qu’on a produits pour l’obscurcir.
Remettons d’abord l’ordre antique de la monarchie dans la distribution des recettes et des dépenses du Roi, qu’on affecte de confondre.
Premier département.
L’administration des domaines et droits domaniaux rapporte actuellement cinquante millions.
Les maisons de Sa Majesté, de son auguste épouse, de la famille royale entière, le conseil et les bâtiments du Roi, n’absorbent pas cette somme à beaucoup près. Le ministre et les divers ordinateurs de ce département doivent donc rendre tous les ans, à l’épargne, un honnête résidu, le Roi s’occupant avec un zèle admirable de la réformation des dépenses de cette espèce, qui peuvent en être susceptibles.
Second département.
Le produit annuel des tailles et capitations passe, tous frais faits, cent vingt-cinq millions.
La guerre, la marine, les affaires étrangères administrées sous M. le cardinal de Bernis, M. d’Argenson et M. de Machault, ne coûteront pas cette somme : il y aura de l’épargne.
Troisième département.
Les deux vingtièmes et sous pour livre, après la réforme des abus, produiront, frais faits, au moins environ soixante-cinq millions. Ces revenus annuels suffisent pour faire face aux dépenses courantes, ordonnées immédiatement par l’administrateur des finances. Il y aura de l’épargne.
Quatrième département.
La ferme et la régie générales produisent ensemble deux cents un millions tous les ans.
On a vu que le Roi pourrait en tirer deux cents vingt-trois, en prenant pour lui-même les deux tiers des frais ordinaires et connus, que coûtent les mauvais impôts.
La nation profiterait d’onze millions, qui sont le dernier tiers de ces frais de trente millions, au moins de faux frais, et de cent millions de pertes qu’occasionnent la désastreuse gabelle, les aides, les impôts sur la viande, les cuirs, le poisson, les œufs, le beurre, le fromage, le bois, la chandelle, l’huile, etc., etc., etc., qui ne peuvent plus subsister, quoi que fassent les ennemis du bien public.
Il y a là de quoi payer toutes les rentes fondées en contrats, même les intérêts des dettes exigibles, quoiqu’usuraires aux yeux de la loi, et incapables d’obtenir l’approbation des tribunaux.
Suivant les états communiqués aux notables, les rentes payées à l’Hôtel-de-Ville ne se montent qu’à cent cinquante-et-un millions ; il reste donc de disponible, sur le remplacement des fermes et des régies, plus de soixante millions tous les ans, pour les autres dettes et une épargne.
Conclusion très intéressante.
Les vrais dépenses ordinaires du Roi sont donc infiniment au-dessous de ses recettes ordinaires.
Par quel motif et pour quel intérêt certains personnages ont-ils mis tant d’art et de persévérance à persuader le contraire au monarque, à la nation et à l’univers entier ? C’est ce que je ne puis concevoir. Voici la seule clef qui se présente.
Explication sur la dette criarde ou non fondée.
Par des procédés clandestins, que réprouvent les ordonnances du royaume et les principes de toute sage administration, depuis 1776 on a multiplié les papiers agiotables, usuraires et illégaux jusqu’à l’excès le plus effrayant ; c’est aux seuls porteurs et particoteurs de ces papiers qu’on sacrifie toutes les classes de l’État.
Sans aucun acte législatif enregistré dans les cours, on reçoit des sommes, la plupart en vieux papiers ; on paie d’avance un intérêt usuraire, et l’on délivre un titre agiotable, en vertu duquel tout le capital doit être restitué à des époques fixes, ordinairement rapprochées.
Entre particuliers majeurs, sur des biens et revenus parfaitement libres, ce procédé serait condamné comme illégal, usuraire et frauduleux. Dans les tuteurs et administrateurs d’une minorité ou d’une substitution (ce qui est le cas des revenus de la couronne) il occasionnerait une flétrissure.
Il n’est pas moins vrai que les états communiqués aux notables, d’accord avec les anciens et nouveaux mémoires de M. N***, nous annoncent pour plus de six cents millions de ces papiers agiotables, illégaux et usuraires, dont les trois quarts au moins ont été créés depuis 1776.
Ces dettes criardes, totalement réprouvées par les lois, sont les seules causes de ce monstre effrayant, qu’on appelle déficit, qui trouve toutes les imaginations.
C’est pour opérer les remboursements à époques, promis aux patricoteurs des papiers, qui composent cette masse, qu’ils demandent à grands cris de nouveaux emprunts et de nouveaux impôts.
C’est une dette sacrée, disent-ils. … Non … C’est un traité nul, frauduleux et illégal… Ce qui est sacré, c’est la promesse faite par le Roi à ses tribunaux et à son peuple, de ne plus emprunter sous une forme ruineuse pour les souverains, et utile aux seuls banquiers agioteurs.
Ce qui est sacré, c’est la loi du royaume, qui ne permet de recevoir intérêt qu’en passant un contrat de constitution.
Ce qui est sacré, c’est la règle fondamentale que le Roi et sa couronne sont toujours en minorité ; qu’ils peuvent toujours user des avantages que les lois universelles donnent aux biens et revenus pupillaires.
Tous les porteurs de papiers agiotantes, ayant reçu des intérêts, même usuraires, par anticipation, au-delà de 5%, et sans retenue, leur fond est aliéné à titre de constitution, l’État ne leur en doit que la rente au taux de la loi.
La voilà, princes, magistrats, citoyens, la vérité, l’auguste et salutaire vérité qu’on vous dissimule.
Ces intérêts au taux de la loi, il y a de quoi les payer, car outre les épargnes des autres départements, il reste plus de soixante millions tous les ans du produit des remplacements à substituer aux fermes et régies. Il reste les postes, les parties casuelles, les loteries, les dons gratuits du clergé.
Mais en faisant ainsi des agioteurs de papiers un exemple sévère, vous ruinez le crédit. Oui : et tant mieux. Le Roi n’est plus obligé de faire de dettes.
Mais s’il est attaqué, comment fera-t-on la guerre ? … Comment ? Par un moyen bien plus simple, bien plus efficace, et moins ruineux que vos emprunts, qui n’aboutissent, enfin, qu’à multiplier les profits des rentiers et des négociateurs. Dès lors on doublera les vingtièmes, les capitations, ou bien les droits de remplacement ; et la loi la plus précise, la plus salutaire l’ordonnera d’avance, afin que les nations rivales le sachent dès aujourd’hui, afin que le peuple de Paris et des provinces ne soit plus la dupe des vivriers fournisseurs et entrepreneurs, de leurs fauteurs et adhérents, protecteurs et protectrices, ni des autres sangsues publiques, rentiers oisifs, capitalistes avides, négociateurs et patricoteurs d’emprunts et d’impôts.
On la connaît aujourd’hui cette vérité qu’on me contestait en 1776 avec tant de violence, qu’une guerre coûte un milliard et demi de dépenses extraordinaires.
Le Roi veut, le Roi peut très bien payer les rentes fondées légalement en contrats sur l’Hôtel-de-Ville, même l’intérêt ordinaire à ceux de ses créanciers, dont les titres sont illégitimes ; mais il ne doit rien au-delà.
Français, Français. Justice des impôts désastreux. Justice des traités clandestins et illégaux. Justice des agioteurs et de leurs procédés usuraires. Voilà tout ce qu’il faut pour la restauration de l’État. Si de nouveaux emprunts, de nouveaux impôts étaient capables de l’opérer, tout serait au mieux depuis longtemps.
Quo usque eadem ?
Tacite
(Quand les choses cesseront-elles d’être les mêmes ?)
NOTA BENÉ.
Si le Roi ne prenait pas le parti de constituer en rentes remboursables toute la dette criarde et illégale, il y aurait pour 1788 un déficit immense.
Mais en faisant justice des papiers agiotables et usuraires que les lois condamnent, il n’y en aura point.
IDÉES D’UN CITOYEN Sur l’état actuel du royaume de France.
TROISIÈME PARTIE
NUMÉRO VIII.
IDÉES sur le syndicat des paroisses du royaume, et sur sa correspondance immédiate avec le Comité des finances.
La nation française est redevable aux frères de Sa Majesté, aux princes du sang, aux seigneurs, aux évêques, aux magistrats, aux citoyens qui composent l’assemblée des notables, d’un établissement qui rendra prompte, solide et durable à jamais la restauration du royaume.
Un Comité des finances, présidé par le chef de cette administration, sera composé du Contrôleur général chargé de rapporter toutes les affaires, et de cinq membres choisis par le Roi dans les trois premiers ordres de l’État, mais étrangers à toute autre juridiction ; leur solde sera la plus précieuse qu’on puisse offrir à des Français : l’honneur, le plaisir de servir gratuitement le Roi, la Patrie.
Ils examineront, avant, tous les projets relatifs aux recettes et aux dépenses. Ils en diront au Roi et à son Conseil leur avis motivé, par écrit ; ils vérifieront après, l’exécution de tous ceux que le Monarque aura sanctionnés par son approbation ; ils en instruiront le public, tous les ans, par la voie de l’impression.
Levons tous au Ciel nos yeux et nos mains ! Oh, mes chers compatriotes ! Unissons nos cœurs et nos voix pour bénir le monarque, son auguste épouse, ses enfants, sa famille entière, et tous les citoyens, à jamais vénérables, qu’il a rassemblés aux pieds de son trône pour le salut du peuple français ! Que leurs noms soient à jamais consacrés dans nos fastes ; qu’ils passent à la postérité la plus reculée, avec un caractère indélébile, qui soit le monument de leur gloire et de notre reconnaissance.
Oui, Français, le comité des finances, sa composition, ses procédés, la publicité de ses opérations sont le garant perpétuel de la puissance du Roi, de la prospérité de son empire.
C’est désormais à ce foyer de lumières et de bonnes intentions patriotiques qu’il faut s’empresser de faire aboutir toutes les connaissances ; c’est de là qu’il faut les réfléchir sur la surface entière du Royaume.
Je demande qu’il me soit permis de développer cette idée ; je la crois d’une extrême importance ; elle fera le complètement de l’ordre qui doit assurer notre bonheur.
Je propose, ici comme l’objet désormais le plus essentiel, qu’il soit établi 1°. dans chaque paroisse de campagne et de ville un syndicat, 2°. une correspondance continuelle et immédiate, entre tous les syndicats et le comité des finances. Je m’explique.
Le seigneur ou son représentant ; le curé ou son vicaire à sa place ; le syndic, nommé par le Roi, et les quatre plus âgés des propriétaires de fonds, dans la paroisse, qui n’en seront pas notoirement incapables par défaut de lumières et de mœurs ; voilà ce que j’appelle syndicat paroissial.
Dans toutes les grandes villes, on substituera les quatre plus anciens ex-marguilliers ou syndics des fabriques, propriétaires de maisons dans la paroisse même.
Ce syndicat peut réunir plusieurs fonctions très importantes que je détaillerai dans la suite, à mesure que j’exposera mes idées sur chacune des parties d’administration publique, dont je crois qu’il faudrait lui confier la surveillance.
Le principe fondamental, c’est qu’il comprenne tous les mandataires de l’autorité souveraine, tutélaire et bienfaisante, avec les vrais chefs naturels des deux classes qui les suivent immédiatement dans l’harmonie hiérarchique des sociétés policées, c’est-à-dire, des propriétaires fonciers et cultivateurs.
Les seigneurs et leurs représentants dans l’ordre de la protection; les curés dans celui de l’instruction ; le syndic royal, dans celui de l’administration publique, sont les délégués et représentants de la souveraineté ; les quatre anciens sont admis par le Roi pour conseils de ses mandataires ; leur titre particulier est l’expérience, et leur titre général est l’unité manifeste d’intérêts entre la propriété foncière et la souveraineté.
Vérité capitale qu’il faut répéter sans cesse, puisqu’on fait tant d’efforts pour l’obscurcir. La doctrine sophistique des modernes, dont le fameux Genevois, M. N***, est aujourd’hui le coriphée, ne tend qu’à faire prendre le change à tous les souverains sur cet objet important, et à leur faire sacrifier leur vrais sujets, les propriétaires fonciers, les cultivateurs, qui sont tout pour eux, aux capitalistes, aux banquiers, aux marchands, aux fabricateurs des objets curieux et recherchés, du trafic purement extérieur, qui ne sont d’aucun pays (comme ils s’en glorifient très ouvertement eux-mêmes), et comme ils le prouvent sans cesse par tous les procédés.
L’éloge de Colbert, l’essai sur la législation, les trois gros in-8° de M. N*** ne contiennent rien que ce système très clairement énoncé, qu’il faut « sacrifier la noblesse, le clergé, la bourgeoisie propriétaire et les cultivateurs à tous les patricotteurs d’argent et de papiers agiotables, gens à caisses, à portefeuilles, à manufactures recherchées, à magasins et à boutiques. »
Parce qu’il plaît aux docteurs modernes d’appeler pompeusement du nom d’états quelques petits nids d’artisans et de marchands, sans territoire capable de nourrir leurs habitants, qui sont un état comme la loge du Suisse est un hôtel ; parce qu’ils n’ont aucune idée de la propriété foncière, de la culture, de l’organisation d’un grand Empire agricole ; parce qu’ils ont réussi à mettre aux grandes nations le fer et les flambeaux à la main, pour se détruire mutuellement à grands frais ; parce qu’il en résulte beaucoup d’emprunts, et par une suite infaillible beaucoup d’impôts qui enrichissent les marchands d’argent à proportion que le genre humain est désolé par les fléaux de la guerre, et par ceux de la paix, qu’entraîne le désordre fiscal ; ils veulent encore qu’on admette leurs paradoxes, qu’on révère leurs procédés qui ne sont que ceux de l’agiotage et de l’usure, que l’art abominable de faire des dettes écrasantes pour les souverains et pour les nations ; de faire des dettes, pourquoi ? « Pour soudoyer au dehors des armées, ravager la terre, égorger les pauvres humains », dit M. N***, avec un sang-froid merveilleux, dans l’introduction de ses gros livres (page LXXXIII) ; le tout pour aboutir à quoi ? En réalité, à faire gagner deux cents ou trois cent millions de capital aux banquiers, deux ou trois cents millions de revenus annuels aux capitalistes et aux célibataires oisifs, vautours des empires agricoles.
Ils le veulent ; mais en vain : il est passé le temps du fol enthousiasme, excité par une cabale, et fomenté par de prôneurs à gages ; ils sont passés les jours de ténèbres et d’illusions ; la lumière a été faite. Tout le monde connaît aujourd’hui quelles sont les parties premières essentielles d’un grand empire agricole comme la France. Premièrement, le Roi, son auguste famille, son clergé, sa noblesse, sa magistrature ; secondement, les propriétaires fonciers, les hommes ruraux qui recueillent des mains de la nature les productions propres à nos besoins ; les agents de l’agriculture, du pâturage, de la pêche, des exploitations métallurgiques ; troisièmement, les manufacturiers, les marchands, les artisans nationaux qui fabriquent, négocient ou façonnent pour nous tous, dans l’intérieur de la nation même. Eux seuls sont inhérents au sol, eux seuls sont membres individus de la nation.
Quant aux fabricateurs de futilités brillantes, destinées au faste de quelques étrangers, dont les matières viennent du dehors, ils ne sont qu’un hors-d’œuvre fugitif ; cette industrie sur-ajoutée, qui n’a point de racines, se promène de climats en climats. M. N*** en convient lui-même.
Quant aux capitalistes, leur numéraire est une semence qui peut, comme tant d’autres, produire des biens précieux ou des poisons funestes. Confiée aux propriétaires fonciers, aux cultivateurs, aux arts utiles qui remplissent nos besoins, c’est un bon arbre qui donne de bons fruits. Semée en prêts usuraires pour produire des rentiers oisifs, et des guerres aussi sanglantes qu’inutiles, et des profits d’agioteurs ; c’est une mauvaise plante, et des fruits qui donnent la mort aux États.
Des fermes, des métairies, des verges, des prés, des vignobles, des bois, des mines, des carrières enrichies de grandes et fortes avances souveraines par le monarque ; de grandes et fortes avances foncières par les gentilshommes, les ecclésiastiques, les bourgeois, propriétaires ; de grandes et fortes avances d’exploitation par les entrepreneurs de travaux agricoles, qui produisent les subsistances et les matières : voilà le royaume.
Quand le gouvernement, les propriétaires, les cultivateurs font bien leurs fonctions, il y a des manufactures, du commerce, des métiers autant qu’il en faut. Tous ces effets naissent d’eux-mêmes, et suivent, sans aucun effort, sans aucune sollicitude, la prospérité du territoire qui est leur cause. Toute fabrique, tout négoce, tout art, qui ne vient pas ainsi spontanément, ne vaut rien. C’est une plante parasite qui pompe mal à propos le suc nourricier.
Mais de toutes les espèces dévorantes, les pires sont les agents des impôts désastreux, de la gabelle, des aides, des taxes sur les cuirs, sur le bois, sur la viande, sur l’huile, sur la chandelle, etc., etc., etc. ; les banquiers agioteurs d’emprunts, et promoteurs d’hostilités, les rentiers oisifs qui corrompent la génération présente, et anéantissent les générations futures.
Assez et trop longtemps depuis Colbert, jusqu’à M. N***, a-t-on voulu fixer tous les regards, toutes les attentions, toutes les faveurs du gouvernement sur ces classes qui ne sont au vrai que les vampires de l’État ; l’excès de leurs pillages a fait enfin ouvrir les yeux, et il faut les tourner sur les vrais citoyens, sur les vraies sources de richesse et de puissance pour le Roi, de splendeur et de félicité pour son empire.
C’est vers le syndicat des paroisses, et surtout des paroisses de campagne, qu’il faut les porter ; c’est là qu’il faut les attacher sans cesse.
Après avoir dit anathème à la désastreuse gabelle, et à tous les impôts de pareille espèce ; après avoir établi son comité des finances, Louis-Auguste, le restaurateur de son empire, n’a plus qu’à fonder une correspondance continuelle et immédiate des syndicats de paroisse avec ce comité. Les bases seront posées, le bien général en sera le résultat le plus infaillible. L’assemblée des notables deviendra, par ces révolutions salutaires, une époque à jamais mémorable dans l’histoire de l’humanité.
« Mais cette correspondance sera difficile, dispendieuse, et peu profitable… » Vous le dites… Vous vous trompez.
Difficile ? … Non… Le royaume de France contient certainement mille et mille citoyens plus habiles que moi… Eh bien… Je serais incapable de la tenir, sous les ordres d’un comité, moi seul, et je n’y croirais pas un travail excessif… point de grands embarras, surtout point d’obstacles véritables.
« Mais on écrirait donc quarante mille lettres par semaine. » … Non… une seule… générale et circulaire… Il ne s’agit que de la bien rédiger ; l’imprimerie ferait le reste.
« Mais on recevrait au moins quarante mille réponses » ? … Non… à peine cent vingt mille mots, qui ne font que quelques pages de lecture.
Tous les faits étant classés avec méthode ; tous les cas étant réduits à la circonstance ordinaire du juste milieu ; le syndicat, qui recevrait un double exemplaire imprimé de questions claires, précises et détaillées, n’aurait que des blancs à remplir, lorsqu’il serait arrivé dans la paroisse des cas extraordinaires. De ces deux exemplaires, il garderait l’un et renverrait l’autre.
C’est par cette méthode d’originaux imprimés et uniformes, qui n’ont que des blancs à remplir, que toutes les parties de la finance peuvent être administrées : s’il fallait que les employés fissent de leur tête les bulletins, les quittances et les registres, il serait impossible de s’en tirer.
« Au moins la correspondance coûtera-t-elle énormément de frais au Trésor royal, déjà surchargé » ? … Non… il en sera comme du comité même. Tout homme de lettre s’en chargera pour mériter la plus précieuse de toutes les récompenses, la satisfaction de servir son prince et son pays. La franchise du port n’est pas une charge ; le moindre employé des postes les occupe davantage très gratuitement.
Quant au papier et à l’impression des feuilles hebdomadaires, chaque syndicat paiera les siens : premièrement il en aura les moyens ; car, pour le rendre utile, il sera nécessaire de lui confier plusieurs fonctions de petit détail, importantes, mais totalement négligées ou mal remplies, qui produiront, avec grand avantage pour le public, un petit revenu plus que suffisant, pour tous les frais de ce syndicat.
Je ne puis ici les indiquer qu’en partie et sommairement. D’abord on peut charger le syndicat de constater civilement le fait de chaque naissance, chaque mort, et chaque mariage ; je dis le fait qui précède les cérémonies ecclésiastiques. Secondement, il serait utile de l’établir dépositaire d’un bureau d’hypothèques, qui porterait spécialement sur les biens réels situés dans la paroisse ; les propriétaires fonciers auraient besoin de cette institution pour le rétablissement du crédit qui leur serait si nécessaire, et qu’on a ruiné par tous les artifices possibles, pour ne donner confiance qu’aux propres agiotables. Troisièmement, le syndicat serait naturellement, dans la paroisse, le gardien et l’inspecteur des droits et domaines appartenant en propre à la couronne, ou de ceux des mains-mortes qui sont sous sa tutelle et sauvegarde, notamment de ceux des pauvres. Quatrièmement enfin, il y aurait une grande utilité à lui confier la revendication, l’inventaire et la garde des titres, papiers et documents épars, délaissés après décès chez les particuliers qu’ils ne concernent pas, et qui se perdent journellement : notamment chez les simples usufruitiers et leurs gens d’affaires.
Ces objets sont indépendants des recettes à faire pour les administrateurs des domaines ; pour les receveurs généraux des finances, et les percepteurs du remplacement à substituer aux impôts désastreux, recettes qui seraient, je crois, infiniment mieux à plusieurs égards entre les mains du syndicat, que de tous autres.
Ces fonctions produiront nécessairement un revenu proportionnel aux services vraiment utiles que rendrait le syndicat. Eh bien, moyennant vingt sols par mois, ou douze francs par an, le syndicat aurait, chaque semaine, un recueil imprimé d’instructions très utiles sur tous les objets de l’économie politique, et tous les quinze jours y serait joint un double exemplaire imprimé d’une lettre de questions, rédigées en tables très détaillées, questions à répondre par un mot qui remplirait les blancs dans les cas extraordinaires seulement ; le silence étant seul requis lorsque les circonstances à vérifier ne s’éloigneraient ni en plus ni en moins de la règle commune.
Les réponses aux questions, et les éclaircissements fournis par les bons citoyens, ou recueillis dans les meilleurs ouvrages, formeraient la correspondance hebdomadaire, très instructive, très agréable aux seigneurs et à leurs officiers, aux curés et aux vicaires, aux syndics et principaux habitants.
Ainsi les lumières iraient sans cesse de la circonférence au centre, et du centre à la circonférence. Le comité royal apprendrait de chaque syndicat tout ce qui peut intéresser l’administration, les propriétés foncières, les exploitations rurales, et les arts vraiment utiles qui servent aux jouissances des nationaux. Tous les syndicats apprendraient du comité les résultats les mieux vérifiés, les plus intéressants, les plus analogues aux circonstances.
Les connaissances de détail qui ne seront nécessaires qu’au comité des finances, lui seront réservées ; les autres composeront la feuille hebdomadaire de correspondance.
J’ose croire et prédire que cette communication intime immédiate et continuelle des citoyens les plus notables, fixés dans toutes les paroisses du royaume, avec un comité qui répond sans cesse et direction au Roi et à son Conseil, rétablira promptement le véritable esprit de l’empire français, l’amour, le respect, et le zèle des sujets pour le monarque leur père ; la tendresse et confiance du Roi pour de fidèles sujets qui sont ses enfants. C’est toujours le fruit des lumières qui se répandent sur les chefs des nations.
Erudimini qui judicatis terram.
DAVID.
[Instruisez-vous, juges de la terre. — Psaume, II, 10.]
NUMÉRO IX.
IDÉES SUR LES INNOVATIONS ANTI-MONARCHIQUES, PROPOSÉES AUX NOTABLES.
Il existe en France, depuis longtemps, un projet anti-monarchique fondé sur les idées absolument fausses du républicain Genevois, Jean-Jacques Rousseau, développées dans l’ouvrage intitulé Contrat social.
Parmi ceux qui s’étaient enthousiasmés de ce système, non moins absurde en théorie que pernicieux en pratique, on ne peut s’empêcher de ranger feu M. Tu*** [14], ministre d’ailleurs fort bien intentionné, qui, pourtant, n’a rien opéré de bon pendant son administration, le peu de bien qu’il eût tenté de faire, dans les parties les moins pressées, ayant été mal digéré, par la faute des subalternes.
Les éloges de cet ex-ministre, publiés par M. de *** [15] et le sieur Du *** [16], ses confidents, détaillent avec complaisance tous ses principes sur les petites républiques de paroisses pelotonnées par des confédérations de districts, de provinces et d’États généraux.
C’est précisément en ce point qu’il s’écartait essentiellement de la doctrine des premiers et vrais disciples du docteur Quesnay et de l’ami des hommes, tous deux partisans déclarés de l’état monarchique, de l’autorité des Rois, de la souveraineté patrimoniale héréditaire à titre de primogéniture. C’est par cette raison qu’il n’a cessé, pendant son ministère, de protester qu’il n’était point de cette école : vérité que ses deux panégyristes ont imprimée depuis sa mort ; que tous ses amis et toutes ses amies avaient tant répétée pendant son administration, à laquelle nul des vrais économistes n’eut aucune part depuis le mois de décembre 1774 jusqu’à son renvoi. C’est ce système républicain, dont je détruirai toutes les bases dans la suite de cet ouvrage, par les maximes évidentes de mon respectable maître, le docteur Quesnay ; c’est la chimère des petites républiques unies, qui nous rend inconciliables et qui leur a toujours fait regarder comme une injure la qualité distinctive qui nous honore. Elle occupa longtemps d’après l’invitation spéciale du chef et de ses confidents, feu M. le Tr***[17], avocat du Roi au présidial d’Orléans.
Le fruit de ses travaux assidus fut un volume in-8° de six cents pages, sous le titre d’Administration provinciale, qui contient les excellentes idées de la philosophie rurale, de la théorie de l’impôt, et des auteurs qui, de mon temps, enrichissaient les Éphémérides ; mais très bizarrement amalgamées avec la doctrine hétérodoxe et anti-monarchique, dont les preneurs de M. Tu*** veulent faire honneur à sa mémoire.
C’est dans ce gros livre que le dernier ministre et ses collaborateurs ont pris le plan d’une innovation anti-monarchique, inutile et pernicieuse, contre laquelle j’ai réclamé, pour la conservation du royaume, et pour le bien de l’humanité. Le premier des mémoires imprimés chez Pierre, à Versailles, distribués d’abord aux notables, puis répandu avec affectation dans le public, dont le préambule était remarquable, n’est que l’extrait des idées de M. Tu***.
En voici le premier fondement, qui mérite les plus grandes attentions.
Pour concilier en apparence les principes du docteur Quesnay, qui mettait les propriétaires fonciers au-dessus des manufacturiers, des marchands et des artisans, avec ceux de M. N***[18], et des autres partisans de la doctrine genevoise, qui ne connaissent dans les nations que deux classes, les riches et les pauvres, sans autre distinctions de rang, d’état, ni de conditions, les nouveaux législateurs avaient pris pour taux fixe et invariable d’un représentant du peuple, une certaine somme de richesse, précisément douze mille livres de bien, ou six cents livres de rente.
Celui qui n’aurait eu que six mille livres de bien, et cent écus de rente, n’auraient été qu’un demi-votant, cinquante écus auraient donné un quart de suffrage : par la loi de réciprocité, douze cents livres auraient donné deux voix, cent louis quatre, etc.
Il fallait être plus richepour être député de son village au congrès du district, plus riche pour l’être du district à l’assemblée provinciale, et par le même principe encore plus riche pour être envoyé par sa province au congrès général, que M. le Tr*** appelait conseil national, étant composé, comme il écrit (page 339), des vrais représentants du peuple, qui devaient absorber toute espèce d’administration, en sorte, disait-il formellement (page 341) : « que presque toute autre voie d’acquérir de l’autorité fût fermée. »
Par cette coalition fort singulière s’évanouissaient les distinctions et prérogatives de la noblesse, du clergé, de la haute bourgeoisie, qui remplit les fonctions de la magistrature et de la jurisprudence dans les sièges de province ; de la médecine, de la chirurgie, de la pharmacie, celles des sciences et des beaux-arts, distinctions qui ne plaisent point à l’esprit d’indépendance et de la soi-disant égalité républicaine.
Les revenus, plus ou moins considérables, auraient donc fait la seule différence capitale, ils auraient décidé du nombre des voix actives qu’aurait eu chacun des riches, et des qualités ou degrés dont il aurait été susceptible, depuis celle de membre assistant et votant dans le congrès de sa paroisse jusqu’à celle de « conseiller du congrès national, logé et meublé au Louvre, avec dix mille francs d’appointements, un habit uniforme de distinction, un beau cordon pour lui et pour sa femme, un carrosse entretenu aux armes du Roi. »
On va croire que ces articles sont imaginés à plaisir, que je les mets ici pour tourner en ridicule le projet adopté par le dernier ministre et ses conseillers, pour dénigrer par ce persiflage un livre dont l’extrait a été présenté aux notables. Rien de plus vrai ni de plus sérieux ; je ne fais que copier cet ouvrage, commandé par M. Tu*** et les siens, qui l’avaient fait adopter cette année. Qu’on lise les pages 342 et 343, livre V, chapitre XII.
Au reste, comme il ne fallait être ni noble ni ecclésiastique, comme il suffisait d’avoir dix mille livres de revenus et des voix, plusieurs de ses coopérateurs aspiraient sans doute à ces nouveaux honneurs du Louvre et du cordon.
Laissons à part de telles inepties et revenons aux points essentiels.
Les élections des soi-disant représentants du peuple ne pourraient engendrer que des brigues, des factions, des rivalités, des vengeances ; le caractère français les rendrait plus vives et plus tumultueuses que partout ailleurs.
L’honneur éphémère de cette prétendue représentation ne manquerait pas d’exalter les imaginations, et d’enflammer la sotte vanité bourgeoise. Qui sait jusqu’où se porterait le délire de la nouveauté, dans quelles bornes on pourrait contenir un million au moins de votants et quelque cent mille éligibles ?
Mais je vous demande pourquoi cet attirait anti-constitutionnel ? « Pour régler l’impôt… ». Le régler ! Le Roi ne le veut-il pas ? N’en a-t-il pas le pouvoir et les moyens ? … « Mais pour juger des détails… ». Pour juger ! … Le monarque n’a-t-il pas ses tribunaux de première instance, ses cours de dernier ressort et son Conseil ?… « Mais pour faire les chemins, les ponts, les canaux, les édifices publics !… » Mais ne sont-ils pas au Roi ? N’a-t-il pas le plus grand et le premier intérêt à leur amélioration ? … N’a-t-il pas une administration ? … Doit-il se mêler des édifices particuliers et régler vos maisons, vos cours, les routes de vos parcs, les allées de vos jardins ? Non… Laissez donc aux officiers du Roi le soin du pavé du Roi… Citadins ! occupez-vous de votre patrimoine, le monarque s’occupe du sien.
« Mais n’est-il pas utile que le souverain puisse avoir partout un œil, une oreille, une bouche ? » Oui… mais c’est précisément ce qui condamne votre système si compliqué d’assemblées bavardes et difficulteuses à grands frais.
Dans chaque paroisse de son royaume, le Roi n’a-t-il pas ses mandataires ? Les seigneurs le sont dans l’ordre de la protection ; les curés le sont dans l’ordre de l’instruction ; les syndics et les plus âgés des propriétaires le sont dans l’ordre de l’administration ; que son ministère corresponde avec eux, rien n’est plus facile ni plus avantageux à tous égards. Les renvois aux congrès de district et de province ne peuvent que retarder l’instruction réciproque, l’embarrasser et l’altérer. On ne peut jamais trop tôt savoir et agir, quand il s’agit d’exercer la bienfaisance du souverain.
Ce n’est point le despotisme arbitraire que je prêche à mes citoyens, c’est la monarchie réglée par les lois.
Notre histoire des Gaulois se divise en quatre époques, suivant les quatre formes de leur gouvernement.
Les Grecs et les Romains, toujours menacés, très souvent subjugués et pillés par eux, nous ont conservé la mémoire de leurs conquêtes. Ils possédaient les arts et les sciences. Leurs druides étaient astronomes, naturalistes, jurisconsultes, poètes et musiciens : les Gaulois savaient non seulement labourer la terre avec les grandes charrues à roues, mais encore l’engraisser pour vingt ans avec de la marne, inventions qui leur étaient propres, et qui supposent une agriculture perfectionnée par de grandes recherches. Non seulement ils savaient filer le chanvre, le lin et la laine ; les teindre en belles couleurs, particulièrement en écarlate, qu’ils avaient inventées, et qui supposaient évidemment tous les arts les plus ingénieux ; mais encore ils connaissaient la métallurgie la plus savante, jusqu’au point d’avoir trouvé des procédés pour étamer, argenter et dorer le cuivre pour émailler l’or et l’argent.
Alors ils avaient des rois héréditaires, dont l’empire s’étendait beaucoup au-delà des limites de notre France actuelle. Le centre de leurs provinces, et le siège le plus ordinaire de leur Cour, était dans le Berry, dans la Limagne d’Auvergne, et sur les bords de la Loire.
Alors ils avaient une noblesse, un clergé, des propriétaires fonciers, qui formaient les premières classes de l’État. Alors les marchands et le reste du peuple, retenus à leur place, ne s’élevaient point au niveau des chevaliers ni des druides ; contents d’être gouvernés paternellement, ils ne pensaient point à tenir les rênes de l’administration.
Quand Jules César vint subjuguer les Gaules c’était une autre époque ; il n’y avait plus de monarchie, mais des républiques, des confédérations, des partis, des guerres civiles. C’est lui-même qui nous l’apprend.
Pour dompter nos rois, les Romains semèrent la Gaule de républiques. Les Autunois se révoltèrent sous leurs auspices, ainsi que les provinces belgiques, qui forment le nord de la France : il en fut autant des pays maritimes, comme l’observe Jules César.
Un des grands appas que les brigands républicains employèrent dans les Gaules, fut la remarque répétée par Jules César avec une affectation très marquée, que la noblesse et le clergé, c’est-à-dire les chevaliers et les druides, avaient en main toute l’autorité ; que le reste, sans être esclave néanmoins, se trouvait obligé de s’assujettir à une clientèle qui les retenait dans la dépendance.
Les premiers empereurs bercèrent les bourgeois enorgueillis, les marchands, et le reste du tiers-état, par l’espoir de participer au gouvernement, dans les assemblées municipales, avec le titre de citoyens romains, qui fut prodigué sans mesure, et qui mettait les parvenus au niveau de leurs anciens maîtres, les druides, les chevaliers et les propriétaires fonciers.
À cette république succéda tout à coup le despotisme arbitraire du bas-empire. En moins de cinq cents ans, les deux gouvernements extrêmes de l’anarchie démocratique et de la tyrannie la plus absolue, se signalèrent dans notre pays, dont ils causèrent la dévastation.
Après les révoltes, les massacres, les incendies, les pillages, les insurrections, les dépositions, les assassinats de quarante ou cinquante tyrans, Pharamond vint rétablir en France la monarchie, la noblesse, le clergé, les droits de propriétés foncières. Depuis son règne, cet état a déjà duré treize cents ans, et promet de se maintenir encore longtemps. L’Asie, l’Afrique et l’Amérique possèdent en ce moment des colonies gauloises, comme aux siècles qui précédèrent et suivirent celui de Cirus, jusqu’aux républiques introduites par les négociants de Marseille et les brigands de Rome.
Nous n’avons pas encore des factions à fomenter, ni des guerres à déplorer, de famille à famille, de ville à ville, de district à district, de province à province, de confédération à confédération.
Nous n’avons plus à redouter le despotisme absurde et barbare des proconsuls, des sénateurs, des questeurs, des tribuns et des édiles étrangers, avides et féroces.
Mais nous avons des voisins jaloux, marchands, et républicains par essence ; chez eux s’est formé, depuis longtemps, une doctrine anti-monarchique ; non seulement elle a fermenté dans la théorie, mais encore elle a produit, dans la pratique, les modernes constitutions démocratiques, notamment les petites républiques confédérées de l’Amérique, jadis anglaises.
Son principe fondamental est, comme il fut, et sera dans tous les temps et dans tous les lieux, de confondre toutes les classes des sociétés policées, pour élever le négoce essentiellement républicain, au niveau de la noblesse, du clergé, et des propriétaires fonciers, qui lui sont très supérieurs dans une bonne monarchie, suivant les règles éternelles et imprescriptibles de la nature. Ces faux systèmes dénaturent l’autorité royale, son origine, ses devoirs et ses droits ; ils rendent odieuses les fonctions des trois premières classes de citoyens qui sont ses délégués, après les avoir avilies par l’élévation de leurs subalternes ; ils vexent le souverain et la nation par deux procédés également ruineux, savoir, de faire la recette de ses revenus par une forme pernicieuse, qui oblige le peuple à payer et à perdre tous les ans une somme immense de millions, dont il n’entre pas une obole dans le Trésor royal, et de faire sa dépensepar des emprunts, qui mettent les sujets dans la nécessité de payer trois ou quatre fois les mêmes objets au profit des agioteurs.
Oh, mes compatriotes ! cet esprit mercantile et républicain fait chaque jour parmi vous les plus grands progrès ; il est tout prêt à bouleverser une seconde fois votre antique monarchie, à vous infecter des principes et des formes républicaines, à vous rejeter dans les factions intérieures, de famille à famille, de district à district, de province à province, et dans toutes les horreurs qu’entraînent les divisions entre les hommes, dont la nature fonda le bonheur sur l’union la plus intime.
Si jamais ils étaient parvenus jusqu’aux pieds du trône, les oracles de la cabale anti-monarchique se signaleraient probablement à la face du monde entier, par des maximes et des projets, évidemment destructifs de toute royauté.
Vous les verriez annoncer publiquement dans leurs gros livres, célébrés par des prôneurs à gages, que les principes d’un bon gouvernement, sont premièrement la confusion de tous les rangs, de tous les états civils, dont la distinction fait la base des monarchies. Secondement, la conservation des impôts destructeurs, qui ruinent à la fois le souverain, les propriétaires fonciers et les cultivateurs, pour enrichir à millions des hommes tirés des dernières classes du peuple. Troisièmement la louange, ridiculement exigée du crédit et des emprunts, qui achèvent la dévastation d’un empire agricole, et qui ne peuvent qu’abîmer les rois, leur noblesse, leur clergé, leurs bons et premiers sujets les propriétaires fonciers.
En 1760 je n’étais point républicain ; je n’ai jamais conseillé les innovations anti-monarchiques. Même avant de connaître l’enchaînement des vrais principes, je ne confondais pas les délires du despotisme arbitraire, qui domine par la force des esclaves, toujours soumis jusqu’au dernier avilissement lorsqu’ils sont les plus faibles ; insolents et féroces à leur tour quand ils deviennent les plus fors ; avec l’autorité paternelle, tutélaire et bienfaisante d’un roi, souverain héréditaire, qui regarde son État comme son patrimoine et celui de sa famille, ses droits, comme la suite de ses devoirs, et ses sujets comme ses enfants.
L’un ne connaît d’autres règles que ses fantaisies de l’instant actuel, même les plus déraisonnables et les plus funestes ; point de propriétés que la sienne, qu’il croit pouvoir étendre jusqu’à la vie des hommes soumis à sa puissance, jusqu’à leurs facultés personnelles, à plus forte raison sur la totalité des leurs effets mobiliers, et sur leurs héritages réels, au seul gré de ses caprices.
L’autre respecte des lois, imposées à tous les souverains, par le roi des rois, le maître suprême de la nature. Ces lois sont la justice éternelle, qui vient de Dieu, et la raison, qui distingue l’homme des brutes. La justice et la raison, que nul mortel quelconque n’a droit de violer ; le privilège d’être injuste et déraisonnable ne pouvant appartenir à personne.
Les causes étant nécessairement antérieures aux effets, les travaux et les avances du souverain, premier père commun de la grande famille, par lui-même et par ses officiers ou délégués, dans les départements de l’instruction, à la tête de laquelle est le clergé; dans celui de la protection militaire et civile que dirige la noblesse ; et dans celui de la bonne administration, forment une première classe, dont la vanité des bourgeois citadins ne peut méconnaître et calomnier les fonctions augustes, que dans les phrases de quelques littérateurs élégamment absurdes, qui prennent la malheureuse facilité d’entasser des grands mots vides de sens, pour le talent de bien écrire, oubliant le principe du bon Horace, qu’avant tout il faut savoir ce qu’on dit, scribdendi rectè sapere est principium & fons.[19]
S’ils consultaient la nature même dans nos champs, au lieu de compiler des figures oratoires, des idées romanesques, des extraits indigestes pris dans les poètes, ou dans les journaux, ils verraient bien qu’immédiatement après les mandataires du souverain, après sa noblesse et son clergé, l’ordre essentiel de la nature place la bourgeoisie, propriétaire des terres, et tous les cultivateurs dans la classe des causesqui font renaître les subsistances et les matières premières.
L’esprit républicain, dont j’ai toujours évité la contagion, a pour base d’effacer ces distinctions naturelles des états et des fonctions, de confondre ainsi tous les citoyens, en mettant sur la même ligne les manufacturiers, les marchands, et les autres, dont les travaux et les avances ne sont que les effets subordonnés aux premières, par la plus claire et la plus entière dépendance.
Il fait plus, sous le nom liberté, très mal entendu, ce même esprit d’indépendance et d’orgueil usurpe l’autorité suprême des monarques, pour la transporter sans titre et malgré l’ordre même de la nature, à la collection des sujets, pelotonnés en conventicules.
Cette doctrine genevoise, britannique ou batâve, fermente aujourd’hui dans les têtes exaltées ; elle n’en est pas moins aussi fausse que pernicieuse ; je l’attaque ouvertement, je vais la poursuivre à toute outrance, intimement persuadé qu’elle inonderait bientôt ma patrie d’un déluge de maux, qu’elle nous mettrait incessamment, comme aux Américains, le fer et les flambeaux à la main, qu’elle inonderait nos provinces de sang et de larmes, les couvrirait de cendres et de ruines, et nous livrerait, comme du temps des Romains, par les divisions effrénées des républiques, à toutes les horreurs du despotisme arbitraire.
Français ! Français ! que la providence a placés dans le juste milieu, qui constitue l’ordre et la sagesse, craignez, craignez, ces deux extrémités, que l’ardeur du sang gaulois ne peut supporter.
Deux idées fausses, ou pour le moins très confuses, exprimées par autant de mots équivoques, toujours mal définis, renferment tous les principes de ce fatal esprit républicain, source des divisions, des partis, des guerres civiles et des horreurs qui les accompagnent, surtout chez les peuples dont le caractère est impétueux, mobile, et mal endurant, comme le français.
Ces mots sont égalité, société. Par eux, les paradoxes forment une doctrine, aussi commune dans les écrits de nos jours, qu’elle est absurde lorsqu’on l’examine avec soin, comme je le ferai voir dans la suite de ces idées.
Je vais la disséquer avec exactitude et précision, le plus qu’il me sera possible.
Égalité. Ce mot exprime ici la plus absurde et la plus manifeste des chimères ; un seul instant de réflexion peut en convaincre tout homme de bon sens.
« L’égalité (disent-ils) est la loi de la nature. » Mais de quelle nature, s’il vous plaît ? car ce n’est pas de celle que nous connaissons.
Ouvrez les yeux, parcourez le firmament et les deux hémisphères du globe terrestre. Dans l’immensité des êtres, vous n’en trouverez pas deux qui soient égaux, depuis les étoiles et les planètes, jusqu’aux atomes les plus imperceptibles. Les continents, les montagnes, les vallons et les fleuves, ne sont point égaux ; pas un rocher qui ressemble totalement à l’autre, pas un animal de la même espèce qui ne diffère très sensiblement de tout le reste. Où la trouvez-vous donc ? Égalité de quoi ! Dites-le-nous une fois, si vous pouvez.
Égalité d’âges entre le bisaïeul centenaire et son arrière-petit-fils, qui vient de voir le jour ?
Égalité de forces corporelles entre un Patagon de trente ans et un Lapon de dix ?
Égalité d’esprit et de savoir entre un idiot qui n’a jamais rien appris, et Newton ?
Égalité de courage entre Achille et Therfite ?
Égalité de caractère entre un furieux, un avare, un fourbe, un hypocrite, et le citoyen paisible, probe, loyal, bienfaisant ?
Hélas ! bien loin que la nature nous fasse tous égaux, comme vous le répétez, sans savoir pourquoi, nous sommes assujettis, avec le reste des êtres, à une double loi générale, et très manifeste d’inégalité. Nous-mêmes individuellement nous ne sommes jamais semblables à nous-mêmes, dans tout le cours de notre vie. Ce vieillard, qui va mourrir, est-il égal à ce qu’il était lors de sa naissance ? Étiez-vous, il y a vingt ans, ce que vous êtes aujourd’hui, le serez-vous dans quatre lustres ? Non, il est évident que non.
« Mais au moins les droits des hommes sont-ils semblables ; c’est cette égalité que nous réclamons ! »
Les droits ! À quoi ? Cherchez, trouvez, et dites, si vous pouvez : ai-je droit d’occuper autant d’espace physique, debout, assis ou couché, qu’un des Cents Suisses de la garde du Roi, moi qui ne lui touche du front que l’épaule, et qui ferais faire trois fois le tour de mon corps au ceinturon qui le gêne ?
La plus grêle femmelette a-t-elle droit de manger autant de pain, de viandes et de fruits, de boire autant de bière, de vin et d’eau-de-vie, que le géant de la foire, elle qui ne digérerait pas successivement dans l’espace d’un mois, ce qui suffit à peine à l’une de ses journées ?
Tout homme a-t-il droit de décider, autant que l’Académie des Sciences, de la bonté d’un ouvrage de haute géométrie, quoiqu’il n’entende pas les premiers éléments, et sans savoir le grec, peut-il décider entre deux traductions d’Homère ?
Le premier mot de ralliement, qui sert de signal aux esprits républicains, exprime donc une chimère. La loi de la nature est celle de l’inégalité la plus vraie, la plus sensible entre les hommes, même les plus isolés et les plus sauvages. Deux Robinsons-Crusoés dans deux îles éloignées, ne seraient égaux en rien, pas même en droits ; ceux qu’ils auraient et qu’ils exerceraient, chacun sur leur île particulièrement, ne ressemblant en rien aux droits qu’ils pourraient avoir sur celle de l’autre, les uns étant réels, présents, exécutoires, les autres, quand même ils auraient quelques fondements, étant sans exercice.
Société. C’est le second mot et la seconde source d’absurdités. « Quand les hommes, auparavant isolés, se réunissent en sociétés, ils font un pacte, une convention entre eux ; ils fondent les pouvoirs et les autorités ; ils les distribuent, les restreignent et les modifient, comme ils jugent à propos. C’est dans l’État entier que réside la souveraineté. »
Vous dites donc « quand les hommes, auparavant isolés, se réunissent en sociétés… » Arrêtez-là, s’il vous plaît, philosophes profonds, grands professeurs du dix-huitièmes siècle.
Quand ? Je vous le demande, répondez, je vous prie, à cette première question, si simple et si naturelle : quand ?
Vous supposez donc sans peine une foule considérable d’hommes, conçus, nés, conservés et même instruits, hors de toute société. Les voilà tous robustes, fort sages, fort éclairés, barbe au menton, qui s’assemblent au nombre de quelques milliers, qui forment un beau cercle, et qui délibèrent tranquillement : 1°. s’ils s’associent ou non ; 2°. s’ils feront un despote ou un monarque, une aristocratie ou une démocratie ; 3°. comment s’éliront les représentants, et quelle sera la forme des assemblées.
Mais, docteurs, êtes-vous bien assurés, que chacun de ces votants, si parfaitement égaux, est venu jusqu’à l’âge de raison hors de toute société !
Nous croirions, nous autres ignorants, qu’il aurait eu d’abord celle de son père et de sa mère, puis celle de ses frères et de ses sœurs ; nous y joindrions même son grand-père, ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines, peut-être son bisaïeul, et des grands oncles, avec leurs familles : c’est dans cette société qu’il est né, c’est par elle qu’il fut conservé, qu’il fut nourri, qu’il fut instruit, dix ans au moins avant de pouvoir se procurer lui-même aucunes de ses plus pressantes nécessités.
Car l’instinct caractéristique de l’homme est l’agriculture, et par elle tous les arts, qui font servir les productions, à nourrir, loger et vêtir les humains, à leur procurer les jouissances utiles et agréables, qui font le bien-être, la conservation, la multiplication de notre espèce sur la terre, dont elle possède l’empire.
Cet instinct, cet art fondamental, père de toute industrie, ces autres arts secondaires, dont il est la cause et le principe, supposent et nécessitent la société, fondée par la nature, la société qu’aucun des hommes n’a formée, mais au contraire la société, qui seule a fait naître, qui seule conserve, qui seule instruit, qui seule fait jouir tous les hommes. Il n’y a point de pacte de la part d’un enfant pour être le fils de son père et de sa mère, le petit-fils de son aïeul, pour être le frère de ses frères, le neveu de ses oncles, et le cousin de ses cousins. La première de toutes les sociétés, l’origine et le modèle des autres, la société de famille, existe avant lui ; c’est elle qui l’a produit lui-même, tout ce qu’il a, tout ce qu’il peut être.
La seconde société, celle d’une famille immense, qui s’est multipliée par l’agriculture, par les arts propres à l’espèce humaine, exclusivement aux autres, la société politique n’a point besoin de pacte ni de contrat, elle ne suppose ni congrès, ni délibérations, ni statuts, ni représentants, ni division et modification des pouvoirs : cet immense attirail n’est qu’une chimère, produite par l’imagination échauffée des modernes.
À la seconde, à la troisième, à la quatrième génération, sera parfaitement établie la diversité des fonctions, celle des travaux, celle des avances. Les devoirs, les droits, les propriétés, seront distingués ; les états et conditions seront caractérisés, de manière à ne pouvoir plus être confondus.
Je ne dis pas que la diversité sera créée par la volonté des hommes, que les distinctions seront imaginées, qu’on les admettra par un accord libre et réfléchi.
Tout au contraire, je dis qu’elles seront plus manifestes, mieux établies, plus connues ; mais j’ajoute qu’elles existent essentiellement par l’ordre même de la nature, je le dis et je le prouve, à la différence de nos grands docteurs, qui allèguent toujours, sans justifier leurs assertions : je le dis, et j’offre de répondre aux objections qu’ils pourraient me faire, eux qui ne donnent jamais la solution des difficultés qu’on leur propose, avec candeur et bonne foi.
Supposez l’homme le plus isolé, Robinson, dans son île déserte. Eh bien ! pour lui-même, autre chose est de réfléchir, de méditer, pour s’instruire sur ce qu’il a, sur ce qui lui manque, sur ses projets, ses moyens, ses espérances, ses dangers et ses craintes.
Autre chose est de veiller en armes à sa sûreté, d’enclore sa demeure, de préparer des instruments d’attaque et de défense.
Autre chose est de se faire des chemins, des ponts, des petits ports, une maison.
Autre chose d’abattre les arbres, d’extirper les plantes, les racines, les pierres, les eaux d’un champ, qu’il veut rendre cultivable.
Autre chose est de l’ensemencer, de le sarcler, d’en faire la récolte.
Autre chose est d’en filer le lin, d’en ourdir une toile et d’en faire un vêtement, et de l’user.
Aucune de ces fonctions ne peut être confondue avec les autres, même dans la personne de Robinson Crusoé : le premier examen qu’il médite du terrain, pour connaître s’il est propre à produire du chanvre, n’est certainement pas le même que l’acte qu’il fera dans deux ans, lorsqu’il prendre la première chemise, formée de sa récolte.
Quoiqu’il existe seul, et absolument seul dans son île, qu’il y a pense ou non, qu’il le veuille ou non, il existe entre ces actions un enchaînement, un ordre, une dépendance, naturels, physiques, évidents, incontestables, comme entre les causes qui précèdent et les effets qui suivent.
Son examen et son choix seront les premiers, les moyens de défendre le sol contre les invasions nuisibles seront les seconds, un chemin commode pour l’aborder seront les troisièmes. Elles forment un premier ordre, une première classe de soins, de travaux et de dépenses générales, qui s’étendent de même à toute espèce de culture ; ces avances personnelles, mobilières, foncières et souveraines, qui précèdent le défrichement du sol, Robinson lui-même les fait pour un jardin, pour un champ, pour une vigne, comme pour sa chènevière.
Le défrichement et la préparation qu’exige une chènevière, seront les quatrièmes ; labourer, semer, sarcler, récolter, préparer les chanvres, seront les cinquièmes : elles forment un second ordre bien caractérisé, qui n’est pas si général que le premier, mais au contraire, qui se borne à chaque pièce de sol, et qui varie, suivant les lieux, les temps et les circonstances.
Filer le chanvre et tisser la toile, seront les sixièmes, la taille et coudre les chemises seront les dernières.
Assemblez tant que vous voudrez de grands mots, de belles phrases, de superbes spéculations. Il n’en est pas moins vrai que la nature a mis cette échelle, si manifestement graduée entre les idées, les volontés, les soins, les travaux et les jouissances des hommes ; c’est la nature elle-même qui veut évidemment, impérieusement, irrésistiblement, que l’un procède l’autre, et le précède même de très loin.
La société, les fonctions, et leur caractère distinctif, leur supériorité et leur subordination, existent donc par la nature elle-même : nos prétendus beaux génies peuvent dédaigner cette observation, parce qu’ils ne l’ont jamais faite ; mais ils n’en effaceront pas la réalité ; l’ordre physique subsistera, quoiqu’ils feignent de ne le pas voir.
Dans la monarchie paternelle tout est fondé sur le droit des propriétés héréditaires, et ce droit est fondé sur les devoirs, sur les fonctions, sur les travaux, sur les avances, qui sont essentiellement différents, essentiellement subordonnés les uns aux autres, comme les états et conditions qu’ils caractérisent.
Le Roi, la famille régnante, possèdent, à titre de propriété spéciale, héréditaire, comme représentants du premier père commun de la grande famille, le devoir et le droit de remplir, par eux et leurs officiers ou mandataires, les fonctions augustes, sublimes et bienfaisantes, de nous instruire ; de protéger, envers et contre tous, nos propriétés, nos libertés : au dedans par la justice civile et criminelle, au dehors par la puissance militaire et les négociations ; de nous administrer les grandes facilités que procurent les propriétés publiques à celles de toutes les classes et familles particulières.
L’instruction du Roi, la protection du Roi, l’administration du Roi, par ses délégués et représentants, c’est l’autorité suprême qui fait, dans une monarchie, la paix, le bon ordre et la prospérité publique : c’est au Roi que sont les conseils, les tribunaux de magistrature, les armées, les ports, les chemins, les ponts, les édifices publics, à l’usage de tous et d’un chacun des citoyens ; c’est le revenu du Roi qui fait les avances des constructions, entretiens et améliorations de ces grandes et utiles propriétés communes, de ces forces militaires et politiques, de ces tribunaux de magistrature, de ces grands moyens d’instructions.
Car il a son revenu spécial et assuré, le possesseur héréditaire d’une monarchie parfaite, comme la France.
Chaque propriété réelle doit payer à la souveraineté tous les ans, en ARGENT, une portion fixe de sa valeur totale, effective et foncière : ce n’est ni par des taxes personnelles sur chaque tête, ni par des impôts indirects, sur les consommations et les marchandises, qui nécessitent une infinité de frais énormes, de faux frais encore pires, une armée de commis et de contrebandiers, et des pertes inévitables, journalières, considérables de toutes les espèces.
Les revenus du Roi, pris directement à la source, ne sont point une portion des frais et avances que sont obligés de faire les cultivateurs et le propriétaire. Ces frais sont une charge, et non pas un bien disponible ; on ne les achète pas, on peut les vendre.
Les revenus du Roi ne doivent donc jamais être proportionnés à la totalité des récoltes en nature, parce qu’il faut prélever les frais, qui sont presque toujours très inégaux, même sur des récoltes parfaitement égales.
Mais les vrais revenus de la couronne, c’est au Roi à les recevoir, les avances souveraines de la monarchie, c’est au Roi à les faire, comme les particuliers se font payer leurs rentes et ordonnent leurs dépenses. Citadins ! citadins ! dont les têtes genevoises ont égaré le bon sens, revenez, revenez à l’antique simplesse de nos bons aïeux. Les idées républicaines, dont s’enivrent les banquiers et les horlogers d’un état presque aussi vaste que la seigneurie de Vaugirard, sont étrangères à la nature, aux empires agricoles, et surtout à l’esprit français. Rendons à Dieu, ce qui est à Dieu ; au Roi, ce qui est au Roi : voilà nos vrais maximes.
Quæ sunt Dei deo, quæ sunt Cæsaris Cæsari.
L’ÉVANGILE.
[Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. — Évangile selon Saint Mathieu, XXII, 2.]
IDÉES D’UN CITOYEN
Sur l’état actuel du royaume de France
QUATRIÈME PARTIE
AVERTISSEMENT
Les observations critiques sur les Idées d’un Citoyen, m’ont été communiquées par l’auteur, magistrat infiniment respectable à tous égards. Je me hâte de les communiquer au public. J’en ferai de même pour toutes les autres objections qui me seront adressées.
Ma cinquième partie, qui sera distribuée très incessamment, contiendra ma réponse aux observations et à quelques autres ouvrages, nouvellement imprimés, qui ne s’accordent pas avec mes idées.
En tout, j’aime fort la contradiction ; c’est d’elle seule que naît la connaissance de la vérité.
Hanc veniam petimus que damusque vicissim.
HORACE
[Je demande cette permission, et je la donne à mon tour. — Horace, Art Poétique, 11]
OBSERVATIONS CRITIQUES SUR LES IDÉES D’UN CITOYEN
Les Idées d’un Citoyen m’ont paru, en général, avoir besoin de développement. J’ai trouvé aussi, dans le plan de l’auteur, quelques parties que je ne peux approuver. Puisqu’il est bon citoyen, il ne trouvera pas mauvais que je dise ici ce que j’en pense.
L’arrêté du 5 mai, rédigé dans le bureau qui a l’honneur d’être présidé par Monsieur, et adopté par les six autres bureaux, annonce dans l’assemblée des notables de grandes vues, une grande sagesse, un zèle très éclairé pour les intérêts communs du Roi et de ses sujets.
Le comité des finances, dont cette délibération demande au Roi l’établissement, répond parfaitement à l’esprit d’ordre, de justice et d’économie dont Sa Majesté est pénétrée : elle y trouvera un préservatif assuré contre les surprises si souvent faites à la religion de nos monarques : cet établissement ne peut ainsi manquer d’arrêter le cours des abus, dont les funestes effets effraient aujourd’hui toute la France, et pénètrent de douleur le cœur du Roi.
La seule publicité de cet arrêté a déjà fait, parmi nous, succéder l’espoir à la crainte, la confiance à l’inquiétude : tous les esprits étaient agités, étaient troublés ; le calme commence à renaître, et le crédit à se rétablir : que sera-ce donc, lorsque nos espérances à cet égard se seront réalisées ; que l’institution du comité aura mis la nation dans le cas de n’avoir plus à redouter de nouveaux désordres ; de voir elle-même ses intérêts unis à ceux de son souverain, par une administration vraiment paternelle ; de ne pouvoir, dans aucun temps, élever le soupçon le plus léger sur le sage emploi de ses contributions et le bon ordre dans les finances ? L’État alors eût-il besoin de toutes nos fortunes pécuniaires, le Roi n’aurait pas la peine de les demander, on s’empresserait de les lui offrir.
Je crains cependant que le nombre de cinq commissaires pour être adjoints aux deux chefs des finances, ne paraisse insuffisants, quand on considérera que ce nombre, déjà si borné, peut encore se trouver souvent diminué par des maladies ou d’autres empêchements majeurs, et que les commissaires seront précisément ceux sur qui reposera la confiance publique. Il me semble que deux ou trois membres de plus n’occasionneraient pas de la confusion dans le comité. Mais, en hasardant cette observation, qui n’intéresse aucunement le fond de l’arrêté, je la soumets, comme je le dois, au jugement de l’assemblée.
Quoiqu’il soit dans ses vues que ces commissaires connaissent de toutes les opérations de finances qui pourront se présenter dans la suite, il en est une trop urgente pour qu’elle puisse attendre l’établissement d’un comité ; elle est d’ailleurs d’un si grand intérêt pour la nation, qu’elle paraît en devoir être ni proposée ni discutée que dans une assemblée représentative de la nation : celle des notables porte, en quelque sorte, ce grand caractère ; aussi cette importante opération peut-elle être regardée comme le principal objet pour lequel ils ont été convoqués.
On devine aisément que je veux parler de l’examen et du choix des moyens les plus convenables pour couvrir le déficit qui se trouve dans les revenus du Roi, comparés aux dépenses qu’ils doivent acquitter.
Qu’il me soit donc permis d’exposer sommairement à cette respectable assemblée quelques observations sur ces moyens ; non que je pense qu’elle puisse, à ce sujet, avoir besoin de mes faibles lumières ; mais parce que le devoir et l’honneur commandent à tout bon citoyen de se rallier aux drapeaux de l’intérêt commun, de s’unir aux défenseurs de l’État, pour combattre les intérêts particuliers ligués contre lui, et des ennemis d’autant plus dangereux, que c’est à l’aide de ses propres armes qu’ils parviennent à se nourrir journellement du sang de ses sujets.
Parmi les impôts levés sur la France, quelques-uns sont en horreur à la nation, pour raison des vexations qu’ils occasionnent, des préjudices qu’ils lui causent par leurs contre-coups, des frais énormes que leur perception entraîne, et qui sont en pure perte pour le Roi.
De ce nombre sont principalement la gabelle et les aides. Les cris des malheureuses victimes immolées à ces deux impôts remplissent journellement nos campagnes ; nombre de tribunaux ne sont occupés que des poursuites rigoureuses auxquelles donnent lieu ces fatales institutions ; nos villes ne cessent de retentir des plaintes que ces fléaux excitent de la part de tous les ordres de l’État. Et quelque chose, dont on ne se douterait pas, c’est que l’impôt sur les cuirs, monstre digne des temps de troubles qui l’ont vu naître, est encore plus vexatoire : par la manière dont il est régi, chaque jour des contraventions purement apparentes naissent nécessairement de la nature des choses, et sont poursuivies comme des délits réels.
Les droits sur la viande, les suifs, les huiles, les savons, les fers, etc., n’ont pas des suites aussi révoltantes ; mais ils en ont encore de très fâcheuses, par le renchérissement excessif qu’ils causent à ces diverses marchandises et à la main-d’œuvre, par les obstacles qu’ils mettent à la consommation, et par conséquent à la reproduction.
Gabelles, aides et traites ont deux inconvénients majeurs, qui depuis longtemps auraient dû les faire abolir : le premier, de coûter à la nation infiniment plus qu’ils ne rendent au Roi ; le second, d’entretenir une guerre ouverte et perpétuelle que les traitants font, au nom du souverain, à des sujets chers à son cœur et dont il est adoré.
Si je ne range pas dans la même classe la vente exclusive du tabac, c’est qu’il est d’un usage moins général et moins indispensable que les denrées qui appartiennent aux trois autres fermes, quoiqu’on puisse dire qu’il est en quelque sorte devenu de première nécessité; les 30 millions que cette vente exclusive rend au Roi en sont une preuve convaincante.
Sans les gabelles, la consommation du sel doublerait ; sans les aides, celle du vin augmenterait considérablement ; sans les traites, il en serait de même des autres marchandises ; sans la vente exclusive du tabac, nombre de malheureux, pour se procurer cette jouissance, ne seraient pas réduits à se priver de leur pain, du moins en partie, et la France ne serait pas contrainte de renoncer à cette culture très lucrative, qui formerait un grand agrandissement dans ses revenus.
La consommation de toutes ces denrées ne pourrait augmenter, sans que leur reproduction augmentât pareillement : ce n’est donc pas aux personnes seulement que ces divers impôts font la guerre, c’est encore à notre sol, à la reproduction, c’est à l’État entier, en altérant le principe de sa puissance.
Depuis plusieurs années, les vices monstrueux dont ils sont infestés ont été développés dans plusieurs ouvrages ; ils viennent encore d’être retracés sommairement, mais avec beaucoup de force, dans des brochures nouvelles, publiées successivement sous le titre d’Idées d’un Citoyen, avec des suppléments ; en un mot, ils sont présentement si généralement connus, que le gouvernement, en les avouant par rapport aux gabelles et aux traites intérieures, en a proposé, dans l’assemblée des notables, la réformation ; le Roi même en gémit, et désire cette réformation si ardemment, qu’il a voulu que personne ne pût l’ignorer ; Sa Majesté en a fait une déclaration formelle dans cette assemblée.
Jusqu’à présent la suppression entière de la ferme générale et de la régie générale est le seul moyen connu de remplir les vœux du Roi et de la nation. Cette suppression a été proposée dans les brochures dont je viens de parler ; il y est démontré que c’est la chose du monde la plus facile, et même sans détruire les fermiers généraux actuels ; on ne ferait que changer les objets de leurs recouvrements.
Le remplacement des revenus qui se trouveraient éteints par cette suppression, est assigné, par l’auteur de ces brochures, partie sur les rentes, les pensions, les gages et appointements, partie sur les propriétaires des biens-fonds, en leur accordant la faculté de reprendre, dès la première année, une portion de leur contribution, tant sur leurs locataires ou fermiers, que sur les rentes dont leurs propriétés foncières peuvent être chargées : ce remplacement se trouve ainsi fourni par tous ceux qui doivent naturellement y contribuer, par tous ceux qui profitent de la suppression.
Dans ce nouveau régime, il sera fait partage entre le Roi et la nation, des frais connus et avoués que font cette ferme et cette régie générale. Par les résultat de ce partage les revenus du Roi augmenteront de 25 millions, et cependant la nation se trouvera payer 12 millions de moins : pour le prouver, je ne me servirai point des calculs de l’auteur ; ils ne sont pas absolument les mêmes que les miens ; mais la différence qui se trouve entre eux, est peu importante, et ne change rien au fond des idées.
M. Necker, premier vol., ch. 3, reconnaît que la régie générale fait 8 millions 600 mille livres de frais, pour une recette brute de 50 millions. Le produit net de cette régie, celui qui revient au Roi, ne monte donc qu’à 41 millions 400 mille livres ; les frais sont ainsi de vingt pour cent, un cinquième en sus de ce produit net.
Mais si le produit de la régie coûte un cinquième en sus, m’accusera-t-on d’exagération, quand je dirai que les frais de la ferme générale doivent être de vingt-cinq pour cent ? Ce ne sont que cinq pour cent de plus : cela ne doit-il pas évidemment résulter de la multitude de gens qu’elle est obligée d’employer, et qui, suivant M. Necker, coûtent quatorze millions de plus que ceux de la régie : ces quatorze millions, sur cent cinquante de produit net actuel, font neuf et un tiers pour cent.
M. Necker cependant ne porte pas ces frais à vingt-cinq pour cent, mais il les compare à un produit de 166 millions : j’en ignore la raison ; car dans son Compte rendu, ce produit ne devait se monter qu’à 130, compris 4 millions pour le domaine d’Occident, régi par la ferme générale. D’ailleurs il peut avoir été trompé, et cela paraît d’autant plus vraisemblable, qu’après avoir évalué à 60 mille livres le bénéfice de chaque régisseur général, il n’estime que 75 mille francs celui de chaque fermier général, ce qui contrarie la notoriété publique.
Enfin, si malgré ces observations, mon évaluation paraissait forcée, l’exagération qu’on lui supposerait serait compensée par les saisies et confiscations, que M. Necker estime être d’environ 8 millions par chaque année, et que je ne compte pas ici parmi les frais.
La ferme générale est à 150 millions ; vingt-cinq pour cent en sus pour les frais, font 37 millions, qui, joints à ceux de la régie générale, forment 45 millions 600 mille livres : ne comptons que 45 millions.
Divisions maintenant ces 45 millions en trois parties : 25 pour le Roi, 12 en décharge pour les peuples, et 8 pour les frais de la perception du remplacement ; j’en parlerai plus bas.
Indépendamment de ce premier bénéfice pour la nation, elle en trouverait deux autres encore bien plus considérable, mais dont je ne peux présenter que des aperçus.
D’abord, la cessation des faux frais de toute espèce ; des monopoles et vexations exercés par les commis subalternes ; des pertes de temps et de marchandises ; de l’impôt payé à la contrebande, etc.
Parmi les pertes de temps, l’auteur des brochures compte, et avec raison, celle des journées de 80 mille hommes employés habituellement, les uns à faire la contrebande, les autres à l’empêcher. Suivant lui, tous ces objets réunis excèdent 130 millions. Je n’adopterai ni ne critiquerai ses calculs ; je me contenterai de dire qu’il doit en résulter, pour la nation, un préjudice énorme, et que les 12 millions qu’elle gagnera sur les frais connus, ne sont rien en comparaison de ce qu’elle gagnera sur l’inconnu.
Un troisième bénéfice, est celui des améliorations foncières, celui de l’accroissement du revenu territorial. Les cultivateurs auront le double avantage d’avoir moins de dépenses à faire pour leurs cultures, et de vendre leurs denrées plus avantageusement pour eux : de là, grands efforts de leur part pour fertiliser leurs terres, et en obtenir des récoltes plus abondantes.
Le revenu territorial augmentant ainsi de trois manières, il ne serait point étonnant qu’il doublât dans un très petit nombre d’années ; et c’est l’opinion la plus commune parmi ceux qui ont approfondi cette matière ; mais ne supposons son accroissement que d’un quart en sus de son montant actuel, ce serait pour la nation un bénéfice annuel de 200 millions : une telle augmentation de revenu pourrait-elle s’établir dans la nation, sans que les propriétaires en devinssent plus riches, et sans que le peuple vécût dans l’aisance ? Tel est le premier coup-d’œil des heureux effets de la suppression qu’on propose. Entrons maintenant dans l’examen des revenus qu’elle éteindra, et des procédés proposés pour leur remplacement.
Les 150 millions de la ferme générale se trouvent réduits à 148 au plus, par les francs-salés, les passeports, par d’autres indemnités. La régie générale, déduction faite de ses frais, ne rend pas plus de 42 millions ; ces deux sommes forment ensemble 190 millions. Ajoutons maintenant 25 millions pour la portion réservée au Roi dans les 45 millions de frais supprimés, le total à remplacer sera 215 millions.
Parmi ses moyens de remplacement, l’auteur des brochures propose de prendre 50 millions sur les rentes, pensions, gages et appointements, en quoi je pense qu’il entend comprendre les taxations ; car ce sont de véritables appointements ; il n’y a de changé que la forme et le nom. Il ajoute cependant qu’il croit convenable de commencer par la retenue d’un dixième seulement, sauf à augmenter, si besoin est, pour parfaire les 50 millions. Quant à moi, je ne peux adopter que la seconde partie de son plan, la retenue du dixième ; la fixation des 50 millions me paraît exagérée ; j’en dirai plus bas les raison ; c’est à l’assemblée à les juger.
Il propose encore de régler la contribution des biens-fonds, à raison d’un centième denier de leur véritable valeur foncière actuelle, sans avoir égard à ce qu’on appelle le prix de convenance ou d’affection, et sans que le centième denier, une fois fixé, puisse augmenter, quand les valeurs foncières augmenteront.
Il est à remarquer que relativement à cette contribution, aucuns biens-fonds ne doivent être exceptés, pas même ceux du Roi, attendu que le Roi paie les impôts dont il s’agit, tant par ses dépenses personnelles, que par celles de tous ceux qu’il entretient.
Comme il n’est pas possible de calculer d’avance le produit de ces deux impositions, il regarde comme indispensable que la fixation de leur taux ne soit que provisoire et conditionnelle, c’est-à-dire qu’après que leurs produits auront été réalisés et connus, il sera fait comparaison de leur montant avec celui du remplacement : par cette balance, on connaîtra clairement si ces impositions doivent rester sur le même pied, ou si elles comportent soit une augmentation, soit une diminution ; et dans l’un ou l’autre cas, la répartition en sera faite entre elles au marc la livre.
J’avoue qu’à l’exception de ce qui concerne les rentiers, pensionnaires et autres, par les raisons déduites ci-après, un tel règlement provisoire me paraît fort sage, et qu’il est difficile de procéder autrement avec sûreté ; mais pour le mettre à l’abri de toute critique, je crois nécessaire que le Roi veuille bien instituer le comité qui lui est demandé par tous les notables, et le charger, comme ils le désirent, de dresser le compte de la nation pour le rendre public par la voie de l’impression.
Essayons cependant de nous former une idée de la répartition du remplacement, d’après les bases ci-dessus posées.
À vue de pays, le dixième sur les rentes, pensions, gages, etc., ne peut guère se monter qu’à 35 millions ; restent 180 à imposer sur les biens-fonds.
Ces 35 millions de retenue n’exigeront aucuns frais de perception ; mais il n’en sera pas ainsi des 180 millions d’imposition. Les taxations pour la recette des vingtièmes, sont de 10 deniers pour livre, dont 3 deniers pour les receveurs généraux, 3 autres pour les receveurs particuliers, et 4 pour les préposés. En se rapprochant de ces taxations, les frais du remplacent monteront à peu près à 8 millions, qu’il faut ajouter aux 180, attendu qu’il s’agit de remplacer un revenu net, dont les frais ont été déduits ; voyons si le centième denier nous donnera ces 188 millions.
La valeur foncière de tous les domaines du royaume est généralement estimée 20 milliards au moins ; n’en comptons que 19 : leur centième denier est 190 millions, et nous n’avons besoin que de 188. Il y a donc lieu de présumer que ce centième denier sera suffisant ; je ne serais pas même surpris qu’il donnât un excédent, et qu’en conséquence le comité se trouvât dans le cas de proposer au Roi la diminution de cette imposition ; mais écartons l’idée de cette diminution, et d’après la levée d’un centième denier sur les biens-fonds, examinons ce qui en résultera pour leurs propriétaires.
Premièrement, ils retiendront un dixième des rentes qu’ils paient, et la plupart d’entre eux en doivent pour des douaires, pour des retours de partage, des constitutions de dot ou des emprunts. [20]
En second lieu, ils seront autorisés à reprendre sur leurs fermiers ou locataires, une portion de la contribution ; et, suivant l’auteur des brochures, cette portion sera de 18 deniers pour livre du prix du loyer. Ainsi, pour le propriétaire d’un domaine affermé 6 mille livres, et dont je suppose la valeur foncière à cent vingt mille, la contribution sera de 12 cents francs, et la reprise sur son fermier, de 450 ; donc la contribution ne sera plus que de 750 livres pour ce propriétaire ; c’est le cent soixantième denier, au lieu du centième.
Cette reprise ainsi fixée à 18 deniers pour livre du prix des baux, ce qui fait un treizième en sus, n’est-elle point trop lourde pour les fermiers des biens de campagne ? Nullement ; car les impôts à supprimer leur coûtent bien davantage. Il est certain que par l’effet de ces impôts, celui qui exploite une ferme de 6 mille livres perd beaucoup plus que 450, en augmentation de ses dépenses et en diminution de ses recettes, faute de vendre ses denrées aussi avantageusement pour lui, qu’il le ferait sans ces impôts. Mais pour achever de convaincre, rappelons ici ce qui a été dit ci-dessus, que la suppression dont il s’agit ferait augmenter d’un quart le revenu territorial, et que cette évaluation est fort au-dessous de toutes celles qui ont été faites à cet égard. Cela posé, ces 18 deniers pour livres ne doivent point grever ce fermier, puisqu’ils n’augmentent le prix de son bail que d’un treizième.
Voilà donc que l’imposition du centième denier n’est plus que le cent soixantième, et que le propriétaire d’une ferme de 6 mille livres, au lieu de 12 cents livres de contribution, n’en paie plus que 750. Je laisse à juger s’il ne sera pas amplement dédommagé par la diminution du prix de ses consommations et de la main-d’œuvre de tous les gens qu’il emploie.
En effet, il faut bien que cela soit ainsi, car de l’aveu même de M. Necker, toutes les charges imposées sur les denrées et leurs consommations retombent indirectement sur les propriétaires fonciers ; et de là suit qu’ils doivent profiter du très grand nombre de millions qui se trouvent diminués sur ces charges, par la suppression en question.
Mais ce n’est pas tout : par la raison que cette suppression doit faire augmenter au moins d’un quart le revenu territorial, il devient évident qu’au renouvellement des baux, cette augmentation se partagera entre les propriétaires et les fermiers ; qu’ainsi le prix des baux doit augmenter d’un cinquième, peut-être de beaucoup plus ; mais je n’en demande pas davantage.
Ainsi la ferme supposée de 6 mille francs sera portée à 7 mille 2 cents ; dès lors son propriétaire se trouve totalement indemnisé de sa contribution de douze cents livres, puisqu’il les reçoit de plus de son fermier. C’est la terre, oui, la terre qui désormais se charge de l’acquitter de cette contribution, sans diminution du revenu qu’elle lui donnait.
Il va donc jouir en entier de ce même revenu de 6 mille livres ; et il n’en sera pas moins affranchi complètement des droits onéreux qui lui en enlevaient annuellement une grande portion ; il devient donc plus riche, au lieu d’être écrasé, comme quelques personnes se l’étaient imaginé.
On doit maintenant apercevoir pourquoi je pense qu’il convient de ne prendre qu’un dixième sur les rentiers, pensionnaires et gagistes ; c’est que ce dixième sera toujours pour eux ce qu’il est, au lieu que le centième denier des propriétaires fonciers est d’abord diminué de plus d’un tiers par les reprises sur les fermiers, et que dans un très petit nombre d’années, ces propriétaires s’en trouveront entièrement déchargés ; qu’ainsi parvenus à cette époque, ils ne contribueront plus au remplacement, tandis que les rentiers et autres continueront toujours d’y contribuer pour leur dixième de retenue.
Au surplus, on doit considérer que prendre directement sur les vendeurs, ou diminuer les moyens des acheteurs, ce sont deux opérations qui reviennent à peu près au même pour les premiers, car le montant des ventes sera toujours dépendant du montant des moyens que les acheteurs auront pour payer.
Pour terminer cette dissertation, je crois devoir prévenir une objection contre la retenue d’un dixième sur les rentes. Elle est juste, dira-t-on, par rapport aux rentiers nationaux, parce qu’ils en seront plus qu’indemnisés ; mais où sera le dédommagement des rentiers étrangers ? Et n’est-il pas à craindre qu’une telle retenue sur eux, ne porte atteinte au crédit ?
La réponse à cette objection est facile, dès qu’on voudra bien considérer en masse, et non pas individuellement, les étrangers : alors on les verra dédommagés de la retenue, par les avantages que leur procurera une pleine liberté de commerce avec la France : j’en parlerai dans un moment.
L’uniformité qui doit régner dans les systèmes d’un gouvernement, exige qu’il considère chaque toutdans son ensemble, et non séparément dans chacune des parties qui le composent ; si l’une perd, une autre gagne : sans cela une multitude d’exceptions détruirait la régularité de ses plans ; et à force de vouloir être juste, il deviendrait injuste. L’ordre qu’il doit se proposer de suivre, est celui de la nature, qui, gouvernant tout par des lois générales, assure à chaque espèce tout le bien dont elle est susceptible, sans se mettre en peine des individus en particulier ; c’est à eux à s’arranger selon ces lois.
À l’égard du crédit, il sera toujours relatif à l’état de nos affaires : il n’est point à craindre qu’il nous manque, lorsqu’on nous connaîtra plus de richesses, plus de moyens pour rembourser, et qu’on verra dans nos finances l’ordre propre à effectuer les remboursements. Le vrai secret pour assurer un grand crédit, c’est de se mettre en état de s’en passer ; d’ailleurs, en fait d’emprunts, le besoin est réciproque : si vous avez besoin de fonds, les prêteurs ont besoin d’emplois.
Une augmentation de 25 millions dans les revenus du Roi ; une diminution néanmoins de douze millions sur les charges du peuple ; un bénéfice bien plus considérable encore, résultant pour eux de la cessation d’une multitude de faux frais et de vexations ; enfin un accroissement de 200 millions au moins dans le revenu territorial ; tels sont les avantages qui résulteront nécessairement des opérations simples et faciles qui sont présentées à l’assemblée des notables. Ne faudrait-il pas les procurer à la nation, ces avantages précieux, quand même elle ne se trouverait pas, comme aujourd’hui, en avoir essentiellement besoin ?
Je voudrais pouvoir balancer cette augmentation de 25 millions, dans les revenus du Roi, avec le déficit qu’il s’agit de couvrir ; mais les différentes pièces qui pourraient m’en instruire, sont entre elles si contradictoires, que ce déficit est une énigme pour moi. J’entrevois cependant, surtout d’après l’édit de mai 1787, pour un nouvel emprunt, que les dettes payables à époques fixes, font une grande partie du déficit actuel.
J’ignore le montant de ces dettes ; je n’examine point si elles sont illégales ou usuraires, ou si on doit les regarder comme sacrées ; pour les qualifier, quand leur nature sera connue, ce sont les lois qu’il faut consulter ; car enfin, dans une monarchie, les lois étant les expressions des volontés du souverain, personne n’est au-dessus des lois, parce que personne n’est au-dessus du souverain.
Je me borne donc à dire, que de quelque espèce que soient ces dettes, s’il est des considérations impérieuses, qui exigent qu’elles soient payées à leur échéance, nul doute qu’il ne faille emprunter pour les acquitter. Si au contraire, de telles considérations n’existent pas, rien n’empêche qu’elles ne soient converties en contrats de rentes.
Il est indifférent à l’État de payer ces rentes aux créanciers actuels, ou à des créanciers nouveaux, qui prêtent des fonds pour rembourser les anciens ; mais dans les deux cas, le véritable déficit ordinaire et annuel ne doit être calculé que d’après le montant des intérêts à payer pour les capitaux réputés exigibles, ainsi que d’après la portion qu’on jugera devoir annuellement en rembourser ; et c’est par le montant d’un tel déficit, bien reconnu, bien constaté, que l’assemblée des notables pourra déterminer le montant et la durée de l’augmentation nécessaire aux revenus du Roi : tout le monde est persuadé que c’est ainsi qu’elle pense et qu’elle dirige ses opérations.
Les 25 millions dont je viens de parler, joints aux économies annoncées par le Roi, et aux produits que donnera le redressement de la perception des vingtièmes, ou suffiront ou ne suffiront pas : s’ils suffisent, grande raison pour adopter le plan proposé, puisqu’il dispense de mettre de nouveaux impôts ; si au contraire ils ne suffisent pas, plus grande raison encore pour donner la préférence à ce même plan, puisque, pour faire le contre-poids de ces nouvelles charges, il procure à la nation des moyens sans lesquels il lui serait impossible de les supporter.
Et voilà le point fixe à saisir ; c’est que la somme des impôts, comparée à la somme du revenu national sur lequel elle est établie, nous montre clairement qu’augmenter celle-là sans augmenter en même temps celle-ci, ce serait ruiner le Roi en ruinant la nation.
Quand cette assertion ne paraîtrait pas rigoureusement vraie pour le temps de paix, ne faut-il pas considérer le temps de guerre, qui nécessite l’augmentation des impôts, soit pour se dispenser de faire des emprunts, soit pour payer les intérêts de ceux qu’on est alors obligé de faire, et pour assurer en outre leurs remboursements ?
Certainement ce ne sera pas en entassant impôts sur impôts, emprunts sur emprunts, sans améliorer en même temps les revenus particuliers, qu’on peut rétablir les finances, puisque ce sont, et ces emprunts et ces impôts qui les ont jetées dans le désordre où elles sont aujourd’hui : si le Roi ne voulait employer que ces palliatifs passagers et homicides, il n’aurait pas pris le parti de se faire environner de tant de conseils extraordinaires, par lui choisis dans toutes nos provinces et dans tous les ordres. Chose certaine, c’est qu’il nous reste assez de forces pour pouvoir réparer toutes celles que nous avons perdues ; il ne s’agit que de les bien employer ; et la France alors étonnera toutes les autres puissances par la grandeur de ses ressources.
C’est ainsi que le sort de l’État dépendant du moment présent, notre situation actuelle semble nous destiner à instruire les autres nations, ou par nos prospérités, ou par nos malheurs : aussi, de l’assemblée des notables résulterait-il pour nous de grands maux, s’il n’en résultait de grands biens ; mais son zèle et ses lumières nous permettent de tout espérer, pénétrée surtout comme elle doit l’être, des vues et des intentions du Roi.
Si j’en crois ce qui me revient de toutes parts, déjà plusieurs de ses délibérations ont eu pour objet la suppression totale de la gabelle ; mais cette suppression, quoique très désirable, ne pourrait seule et par elle-même nous procurer les secours dont nous avons besoin. Les mêmes frais de garde dans l’intérieur du royaume n’en serait pas moins nécessaires à la sûreté des autres droits : de là résulterait dans les produits nets de ceux-ci, une diminution qui mettrait dans la nécessité de reprendre sur les peuples plus que le Roi ne retire des gabelles.
Ne peut-on pas, nous dira-t-on, supprimer en même temps la régie générale et les traites intérieures, pour ne laisser subsister que celles des frontières ? Cette idée ne peut séduire que ceux qui ignorent que la garde de nos frontières n’empêche point les versements frauduleux en France des tabacs étrangers ; que la plupart des saisies de cette marchandise sont faites dans l’intérieur du royaume. Que serait-ce donc, s’il suffisait d’y être entré pour n’avoir plus rien à craindre ? La contrebande triplerait, quadruplerait, et bientôt la ferme du tabac serait réduite à rien. Ajoutons qu’il en serait de même des traites extérieures, parce qu’il y aurait la même facilité pour les fraudes, et que les fraudeurs seraient encouragés par la parfaite sécurité où seraient leurs marchandises, une fois qu’elles auraient passé nos frontières.
Une dernière considération, c’est que les gabelles, les traites intérieures et la régie générale ne frappent point également sur toutes nos provinces : il est en cela tant de bigarrure et tant d’inégalités, qu’il ne serait pas possible d’imaginer une manière de répartir avec équité les sommes à lever pour le remplacement de ces impôts.
La suppression de la gabelle seule mettrait dans la nécessité de lever sur les peuples plus qu’elle ne donne au Roi ; la suppression de la gabelle avec celle de la régie générale et des traites intérieures, réduirait presque à rien les fermes du tabac et des traites extérieures. La suppression d’une partie de ces divers impôts, est donc impraticable ; enchaînés tous les uns avec les autres, c’est leur totalité qu’il faut nécessairement abolir, ou renoncer à faire usage de nos ressources, dans un moment où il n’est point pour nous de milieu entre nous en servir ou périr.
Supposons-la donc faite, cette suppression totale, et arrêtons-nous un moment à contempler la France dans ce nouvel ordre de choses. D’une frontière à l’autre, plus de passages obstrués par le régime fiscal, plus d’obstacles au mouvement du commerce extérieur ; il n’est pas une partie du royaume qu’il n’aille vivifier. La liberté du débit, augmentant la consommation, provoque les améliorations de nos cultures ; toutes nos campagnes se fertilisent, et l’accroissement de nos richesses opère celui de notre population. Par une suite naturelle du sentiment intime de notre liberté, l’énergie nationale acquiert une nouvelle force ; l’industrie s’anime de jour en jour, et tous nos arts, toutes nos manufactures se perfectionnent. Leurs travaux devenus moins dispendieux, par la diminution du prix de la main-d’œuvre, et par l’abolition de tous droits sur leurs marchandises, tant avant qu’après la fabrication, à qualités égales, elles n’ont à redouter aucune concurrence de la part des étrangers. Tandis qu’au dehors notre commerce s’étend ainsi, s’agrandit, et travaille à varier nos jouissances, au dedans l’activité qui redouble, grossit pour nous les tributs des mers, et répand partout l’abondance. Le royaume n’est plus qu’un vaste jardin public, où chacun est libre de se promener à son gré, et de cueillir des fruits délicieux dus à l’aisance publique qui le cultive et l’embellit : pour devenir un véritable paradis terrestre, un tel jardin n’a plus besoin que de la paix.
Heureusement, un des grands moyens de l’entretenir, c’est ce haut degré de richesse et de puissance où la France sera portée naturellement par ce nouveau régime ; c’est encore que toutes les semences de division entre les étrangers et nous, pour raison de commerce, seront absolument étouffées : ils n’auront pas de plus grand intérêt que celui de nous avoir pour alliés, et de pouvoir se présenter librement dans nos marchés ; nous deviendrons pour eux un vrai centre de réunion.
Je ne m’inquiète point du parti que prendront les nations commerçantes par rapport aux douanes sur leurs frontières ; elles les conserveront ou ne les conserveront pas ; et dans les deux cas elles perdront les revenus qu’elles en retirent : en effet, si elles les conservent, le commerce les abandonnera, pour venir jouir dans nos ports, de la franchise qu’il ne trouvera pas chez elles ; mais, quand elles l’auront perdu, ce revenu, pourront-elles, comme nous, le retrouver dans un impôt territorial ? Il n’est pas un bon Français qui ne doive faire une attention sérieuse à cette observation.
C’est ainsi que la France, pour se ménager une grande prépondérance dans la balance politique des pouvoirs, n’a pas besoin de chercher à affaiblir les autres puissances : son sol et son climat lui assurent naturellement cette prépondérance ; elle n’a rien à faire pour l’acquérir, il lui suffit de ne rien faire pour la perdre.
Que faut-il donc pour opérer cette brillante et salutaire révolution ? Rien autre chose que la volonté : Dieu dit, que la lumière se fasse, et la lumière se fit ; le Roi dira, que la suppression des impôts désastreux se fasse, et la suppression des impôts désastreux sera faite. Dieu dit, que la terre se couvre de plantes et d’arbres fruitiers de toute espèce, et la terre se couvrit de plantes et d’arbres fruitiers de toute espèce ; le Roi dira, que le sol de mon empire se féconde pour donner à mes sujets une plus grande abondance de richesses, et le sol de son empire va se féconder pour donner à ses sujets une plus grande abondance de richesses : auguste et respectable monarque, cette nouvelle création doit être votre ouvrage, puisque vous êtes sur la terre une image vivante de la Divinité.
IDÉES D’UN CITOYEN
CINQUIÈME PARTIE
NUMÉRO X.
IDÉES SUR LA CORRESPONDANCE D’UN BUREAU GÉNÉRAL des syndicats royaux et perpétuels de paroisses.
Supposé que le Roi jugeant à propos d’essayer quel pourrait être le succès de cette idée, pour le bien de son service et l’avantage de son peuple, ait ordonné à tous ses évêques, à tous ses intendants de province et aux administrateurs des postes, de notifier aux curés, aux subdélégués, aux syndics, aux directeurs des postes aux lettres, ses volontés à cet égard ; je suppose ici le projet de la première feuille, qui fera mieux comprendre le plan général, dont l’utilité me paraît presque indubitable, et sans aucun danger, Sa Majesté pouvant d’ailleurs tout supprimer, à la moindre apparence d’inconvénient.
Un des premiers avantages que j’ose annoncer, et que je m’engage à procurer en deux ans au Roi, par le moyen de la correspondance avec les syndicats de toutes ses paroisses, c’est un détail de la France, à l’usage particulier de Sa Majesté, en autant de feuilles in-folio qu’il y a de cures dans son empire, contenant pour chacune, en huit colonnes in-folio, plus de faits certains et intéressants qu’on n’en ait jamais recueillis, et rangés dans un tel ordre, qu’en trois minutes notre auguste monarque puisse faire mettre sous ses yeux, par tout homme qui saura lire, l’article précis qu’il pourra désirer.
J’ai dit que la correspondance coûterait vingt sols par mois au syndicat, composé de six personnes aisées ; et j’ai fait observer, que les fonctions de ce petit conseil paroissial lui procureraient, sans surcharger le peule, un revenu plus que suffisant pour cette modique avance et quelques autres semblables. J’ajoute que, par la suite, on pourra diminuer le prix de cette feuille hebdomadaire. La sagesse prescrit de caver au plus fort, lorsqu’il s’agit d’un établissement qu’on veut rendre solide, les essais et premiers procédés coûtant, quelque attention qu’on y fasse, beaucoup de faux frais, et de fortes avances.
Pour ce travail, je m’en chargerai très volontiers, si l’on m’en juge capable ; je regarderai l’acceptation de mes offres comme le bienfait le plus précieux, et je consacrerai le reste de mes jours aux succès d’un établissement que je crois utile à mon Roi, à ma patrie, à tous les hommes, si l’expérience des biens qu’il nous produira le fait adopter par d’autres souverains. Je me flatte de ne point faire de mal : si l’espoir de faire du bien m’a trompé, j’espère que le motif me fera pardonner.
Premier dimanche de juillet 1787.
Les intentions du Roi sont, d’après les avis qui lui ont été donnés par Monsieur et Monseigneur comte d’Artois, ses frères les princes de son sang, la noblesse, le clergé, les magistrats et les maires de ville, composant l’assemblée des notables, ainsi que par ses ministres et par son Conseil :
Premièrement, de diminuer, autant et le plus promptement qu’il sera possible, la charge des impôts, particulièrement de ceux qui sont payés par les pauvres journaliers, artisans et petits marchands des campagnes, et qui causent journellement au peuple beaucoup de frais ordinaires connus et avoués ; beaucoup de petites fraudes et vexations secrètes, de procédures et autres faux frais, beaucoup de pertes de temps, denrées et marchandises, le tout sans aucun profit pour le Trésor royal ; notamment la gabelle et la corvée, dont Sa Majesté a ordonné la destruction perpétuelle, le plus tôt qu’on pourra.
Secondement, de rendre les contributions particulières de ses sujets, qu’il regarde tous sans exception comme ses enfants, aux dépenses de son État, aussi justement proportionnées qu’il est possible, à leurs biens, revenus et facultés : en sorte que tous les riches, sans aucune faveur, paient à proportion de leurs richesses, et que tous les pauvres, sans aucun passe-droit, soient soulagés de leur pauvreté.
Troisièmement, d’empêcher, le mieux possible, qu’il ne soit commis par aucunes personnes, et notamment par ses officiers, de quelque grade qu’ils soient, aucunes violences, injustices, extorsions, ou autres insultes contre ses bons et fidèles sujets.
Quatrièmement enfin, de leur procurer, au contraire, toutes les instructions, toute la protection, toutes les facilités, tous les débouchés et toutes les autres faveurs possibles, conformément aux devoirs de son autorité paternelle, tutélaire et bienfaisante, devoirs dont l’accomplissement est le vœu de son cœur.
Pour assurer l’exécution des plans qui feront la restauration et la prospérité de son empire, Sa Majesté croit qu’il sera très utile, 1°. d’ériger dans chaque paroisse de ville et de campagne, un syndicat royal, paroissial et perpétuel, composé des personnes qui exercent, sous son autorité royale, quelques fonctions publiques, et des plus anciens propriétaires. 2° D’entretenir une correspondance directe et continuelle entre les syndicats perpétuels de paroisse et un Bureau général établi à Paris, où ses ministres et autres préposés pourront trouver toutes les connaissances qui leur paraîtront nécessaires pour le bien de sa couronne et pour celui de son peuple.
En conséquence le Roi veut, qu’à commencer le plus tôt possible, dans chacune des paroisses de son royaume, tous les dimanches, à l’issue de la messe paroissiale, soient assemblés, 1°. les seigneurs haut-justiciers ou leurs représentants, lesquels présideront ; 2°. le curé ou l’ecclésiastique qui tiendra sa place, lequel fera les fonctions de secrétaire ; 3°. les quatre plus âgés des possesseurs de biens-fonds ; 4°. le syndic actuel de la paroisse, lequel sera, dans celles des villes, le premier marguillier ou syndic de la fabrique en exercice. Lesquelles personnes ainsi réunies en corps de syndicat royal, paroissial et perpétuel, en premier lieu, entendront la lecture qui sera faite de la feuille imprimée, venue du bureau général des syndicats à Paris en double exemplaire… En second lieu, répondront par écrit aux questions qui seront proposées dans ladite lettre, l’ecclésiastique secrétaire remplissant les blancs qui s’y trouveront à cet effet… En troisième lieu, replieront un des deux exemplaires ainsi répondus par le remplissage des blancs, et chargeront l’un d’eux d’avoir soin qu’il soit remis à la poste pour le Bureau général des syndicats de paroisses à Paris, dont il porte l’adresse. Et enfin, en quatrième lieu, garderont en dépôt au presbytère l’exemplaire du syndicat ainsi répondu par le remplissage des blancs, lequel sera soigneusement enfilé par ordre, et conservé dans un carton.
Sa Majesté aura soin que toutes les petites dépenses du syndicat et de la correspondance soient remboursées, et de prouver à ceux qui se distingueront dans les services qu’ils y rendront à lui et à son royaume, la satisfaction qu’il aura de leur zèle et de leur intelligence.
PROCÈS-VERBAL de la première assemblée.
En vertu des ordres du Roi et par son autorité, le dimanche de 1787.
Paroisse de
Diocèse de
Généralité de
Subdélégation de
Présidial de
À l’issue de la messe paroissial, se sont assemblés les membres du syndicat royal, paroissial et perpétuel, savoir, pour la haute-justice :
Le sieur
Pour le clergé, faisant fonctions de secrétaire :
Le sieur
Pour les quatre plus anciens propriétaires des biens-fonds :
Le sieur
Le sieur
Le sieur
Le sieur
Pour syndic, requérant au nom du Roi :
Le sieur
Lesquels, premièrement, ont entendu lecture de la lettre ci-dessus… Secondement, ont rempli, dans les deux exemplaires imprimés, tous les blancs qui se sont trouvés au projet de procès-verbal. Troisièmement, ont replié celui des deux qui doit être remis au bureau général à Paris, chargeant le sieur de le renvoyer exactement. Quatrièmement, ont enfilé d’un cordonnet, et déposé dans un carton, l’autre exemplaire qui doit rester au syndicat.
Questions à répondre.
Par oui et par non, tout simplement par un seul mot, ou du moins en aussi peu de syllabes qu’il est possible.
Quand on demande quel ? ou quelle ?… s’il n’y en a pas, on laisse les points comme ils sont, sans rien écrire.
Quand on demande combien ? s’il n’y en a pas, on laisse aussi les points, et l’on n’y met rien.
La réponse doit être écrite par l’ecclésiastique secrétaire, sur les points mêmes qui sont au blanc marginal des deux exemplaires.
Ces questions seront de trois sortes. Les unes, qui ne se feront qu’une fois ; les autres, qui se répèteront de temps en temps ; les dernières, qui reviendront presque tous les mois.
Première espèce.
Position de la paroisse.
Est-elle en montagnes ? . . . . . . . . .
en plaine ? . . . . . . . . .
en coteaux ? . . . . . . . . .
en vallon ? . . . . . . . . .
Quelles sont les paroisses voisines ?
Du côté du levant . . . . . . . . .
Du côté du midi . . . . . . . . .
Du côté du couchant . . . . . . . . .
Du côté du nord . . . . . . . . .
Eaux passant dans la paroisse.
Quelle grande rivière navigable ? . . . . . . . . .
Quelle petite rivière non navigable ? . . . . . . . . .
Quel ruisseau ? . . . . . . . . .
Seconde espèce.
Dépérissement des cultures depuis cinq ou six ans.
Combien de terres tombées en friche ? . . . . . . . . .
Combien de vignes abandonnées ? . . . . . . . . .
Dépopulation.
Combien de maisons en masures ? . . . . . . . . .
Combien de ménages manquant ? . . . . . . . . .
Troisième espèce.
Prix des subsistances.
Combien coûtent vingt livres pesant de froment ? . . . . . . . . .
Combien vingt livres de seigle ? . . . . . . . . .
Combien un pot de vin de quatre bouteilles de Paris, chez le bourgeois ? . . . . . . . . .
Combien au cabaret ? . . . . . . . . .
Combien la livre de pain, chez le boulanger ? . . . . . . . . .
Combien la livre de viande, chez le boucher ? . . . . . . . . .
Au presbytère et au syndicat de la paroisse de route de à .
NUMÉRO XI.
IDÉES sur les travaux publics après l’abolition des corvées.
§. PREMIER.
Recette.
1°. Dans toute administration, la recette devant être le premier point comme principe, la dépense le second comme conséquence, il faut évidemment que la recette à faire au nom du Roi pour le grand objet des travaux publics, soit fixée avant tout.
2°. La manière la plus juste, la plus sage et la plus avantageuse de procurer au souverain une recette, étant une perception directe de quotité, c’est-à-dire sur chaque portion de bien, en particulier, proportionnément à sa valeur effective, réelle et totale, sans solidarité, ni répartition, il faut pareillement que la loi des travaux publics établisse pour cet objet une quotité précise, par exemple un millième de la valeur des biens, estimés à l’amiable ou par sentence arbitrale, exécutée par provision, sauf l’appel aux sièges et cours ordinaires. Mais sans exception, tout le monde usant des propriétés publiques.
3°. La perception de ce millième des biens réels, ne doit point être confiée aux collecteurs et préposés ordinaires, mais au syndicat de la paroisse en corps, qui en tiendra la caisse, sous plusieurs clés, pour éviter toute confusion et tout divertissement.
4°. Les propriétaires nobles, ecclésiastiques et bourgeois, faisant ainsi toute l’avance des deniers destinés aux travaux publics, il est indispensable qu’on les autorise à recevoir de leurs fermiers et locataires un cinquantième en sus du prix des baux, et à retenir un cinquantième des rentes et pensions qu’ils paient.
5°. Par la même raison, le Roi, pour contribuer de sa part aux travaux publics, comme le premier et le plus considérable des propriétaires, tant pour lui que pour les fermiers locataires, rentiers ou pensionnaires, doit faire verser dans une caisse générale ad hoc, par les uns le cinquantième en sus de ce qu’ils lui paient, et pour les autres le cinquantième de ce qu’ils reçoivent.
Cette caisse générale servira de supplément aux caisses particulières, et remplira les besoins extraordinaires.
On ne doit pas craindre que la recette soit trop forte, dès qu’on prendra les précautions suivantes pour en assurer l’emploi direct, unique et inviolable aux travaux publics, qui sont les premières et principales causes de la prospérité des héritages particuliers.
§. II.
Dépense.
1°. Les chemins, les ponts, les canaux de navigation et de flottaison, et les autres travaux publics ou avances souveraines, qui font valoir et rendent productifs les travaux ou avances des propriétaires fonciers et des cultivateurs, ceux des manufactures et des arts, sont notoirement de trois espèces correspondantes, savoir : les routes royales qui traversent en entier plusieurs généralités et qui font le premier ordre ; les grands chemins de la généralité qui font la communication de leurs principales villes entre elles et le second ordre ; les petits chemins vicinaux qui communiquent des paroisses de campagnes aux villes prochaines.
De cette observation résulte la nécessité de partager le produit du millième des fonds réels, dans la caisse même du syndicat paroissial, en trois portions distinctes et séparées, qui ne puissent jamais être confondues entre elles. Une par chaque ordre, savoir, la première, pour les routes royales, à condition qu’elle ne sortira jamais de la généralité ; la seconde, pour les grands chemins de ville à ville, à condition qu’elle ne sortira pas du ressort présidial ; la troisième, pour les petits chemins, ponts, eaux et autres besoins publics de la paroisse, et à condition de n’en jamais sortir.
2°. Pour assurer cette consécration inviolable, il doit être défendu, par les cours, aux membres du syndicat, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom, de se dessaisir d’aucuns deniers que pour acquitter des mandats en forme, tirés au profit des adjudicataires, pour ouvrages faits et reçus par procès verbaux, dont l’homologation régulière sera mentionnée dans les mandats.
3°. Quant à la caisse générale de Paris, provenant de la contribution du Roi, comme premier propriétaire, elle doit être à l’entière et libre disposition de Sa Majesté et de son conseil, pour l’appliquer dans les lieux, et de la manière qu’ils jugeront à propos.
J’ose assurer que cette forme est légale, fondée sur les vrais principes de la justice et de la bienfaisance, que jamais il ne sera de l’intérêt du souverain ni de la nation, qu’elle soit intervertie.
SUITE DES IDÉES D’UN CITOYEN.
Questions au défenseur de M. Necker.
Vous dites, Monsieur, dans votre brochure (pages 10, 11 et 12), ce qui suit :
« D’abord c’est une grande question en économie politique, de savoir si dans un emprunt, c’est un mal que les sujets aient l’avantage sur le Roi. Pour juger cette question, il faut se mettre bien dans l’esprit ce que c’est que le gouvernement monarchique. C’est une grande famille où le prince est le père, et les sujets les enfants. Cette société mutuelle rend les intérêts communs. De quelque côté que penche la balance des richesses, elle se rapporte au centre de la famille, c’est un point où aboutissent toutes les lignes de la fortune publique. Peut-être faudrait-il même que pour le bien de la république, l’avantage fût du côté des sujets, parce que l’agriculture, l’industrie, les arts et le commerce fleuriront dans la proportion de cet avantage. Le Roi n’est que le simple économe des richesses générales. Si une fois pour toutes on se formait des idées justes sur cette première branche de l’administration économique, on ne verrait pas des ministres se tourmenter l’esprit pour imaginer des systèmes de finance, qu’on regarde mal combinés, lorsque dans les emprunts, les avantages sont plus en faveur du peuple, qu’en faveur du prince.
S’est-on jamais plaint dans une famille particulière, que le père ait trop favorisé ses enfants ? Non : voilà le gouvernement monarchique.
Que dans un emprunt le Roi paie trop, le mal n’est pas grand. Vice versa ; que les sujets paient beaucoup, leur ruine se tournera contre l’aisance publique. Si l’État proportionne sa fortune à celle des particuliers, l’aisance des particuliers fera bientôt monter la fortune de l’État. Tout dépend du moment, dit l’auteur de l’Esprit des Lois. Le Roi commencera-t-il par appauvrir ses sujets pour s’enrichir, ou attendra-t-il que ses sujets à leur aise l’enrichissent ? Aura-t-il le premier avantage ou le second ? Commencera-t-il par être riche, ou finira-t-il par l’être ? Problème que Louis XVI, le plus juste de tous les Rois, peut définir, et qu’il n’y a peut-être que lui en France qui puisse le définir. »
Oserais-je vous demander ce que vous appelez sujets du Roi, par exclusion, ou du moins par préférence à tous autres ?
Il paraît que vous donnez là ce titre aux seuls prêteurs qui placent leur capital dans les emprunts.
Mais, Monsieur, ceux qui paient les intérêts ne sont-ils pas aussi sujets du Roi ? Bien des gens le penseront.
Je pourrais vous dire qu’ils le sont plus que les capitalistes, prêteurs et les banquiers négociateurs des emprunts.
Si j’avais raison sur ce point, vous auriez je crois mal proposé la question ; ne faudrait-il pas l’exprimer ainsi ? « Le Roi, père commun, qui doit recevoir de ses vrais sujets, nobles, ecclésiastiques, bourgeois, marchands et artisans, de quoi payer les rentes créées par les emprunts, est-il vraiment intéressé à leur en faire payer trop, au profit des capitalistes et banquiers étrangers et nationaux qui négocient ou qui font le prêt ? »
Et en ce cas la solution est-elle bien celle que vous donnez ? J’en doute… et j’attends votre réplique, ou celle du banquier administrateur dont vous défendez les principes.
L’abbé Baudeau.
SIXIÈME ET DERNIÈRE PARTIE
DES IDÉES D’UN CITOYEN
ÉCLAIRCISSEMENTS demandés à M. de Calonne.
NUMÉRO XII.
ÉCLAIRCISSEMENTS demandés à M. de Calonne sur son mémoire.
Tu quid ego & mecum populus desideret audi.
HORACE.
[Donnez-vous donc la patience d’écouter ce que moi et le peuple avons à vous dire. — Horace, Art poétique, 153.]
PREMIER OBJET.
Vous assurez, Monsieur, qu’en travaillant nuit et jour de concert avec feu M. de Vergennes, vous avez si bien arrangé les finances du Roi, qu’à la fin de 1786, en pleine paix, la somme des dépenses ordinaires ne surpassait la totalité des revenus que d’environ cent quatorze ou cent quinze millions tous les ans.
D’autres calculateurs ont prétendu pendant l’assemblée des notables et depuis, que ce déficit était cette année, suivant vous-même, d’environ cent trente ou cent quarante millions par an.
Vous vous récriez avec amertume contre cette assertion. Mais en même temps vous donnez, je crois, la preuve indubitable qu’elle est absolument de vous et confirmée par votre propre mémoire.
Premièrement, vous avez trouvé (dites-vous) le déficit annuel à quatre-vingt millions en 1783, quoique le troisième vingtième fût établi.
Secondement, vous l’avez augmenté, selon votre propre aveu, de trente-cinq ou de quarante-cinq millions tous les ans par vos emprunts… Je répète trente-cinq ou quarante-cinq, parce que vous accusez la première somme dans le texte de votre mémoire, page 168, et la seconde, dans les pièces que vous appelez justificatives, page 85.
Mais troisièmement, le dernier vingtième, qui subsistait en 1783 et 1786, était supprimé cette année, lors des calculs qu’on a faits après vous. Cette suppression est évidemment une troisième cause de déficit, que vous évaluez vous-même à vingt-et-un millions.
Refaisons donc ensemble cette addition. Quatre-vingts millions que vous dites avoir trouvés le dernier vingtième existant, trente-cinq ou quarante-cinq de votre création avouée, et vingt-et-un de la cessation du dernier vingtième, font bien cent trente-six ou cent-quarante six.
De quoi vous plaignez-vous donc ? Et de qui, sur ce premier article ?
SECOND OBJET.
Vous prenez, Monsieur, pour base de votre apologie ce fait capital, qu’en 1783 vous avez trouvé le déficit à quatre-vingt millions. J’en cherche la preuve dans les deux parties de votre écrit, et je n’en trouve pas la moindre apparence… Vous la promettez. Il faut l’attendre… Et jusque-là, suspendre son jugement.
Je ne me permets ici qu’une seule observation : M. Necker persiste à soutenir qu’il n’a point laissé de déficit en 1781 ; le public m’a semblé croire que vous vous combattiez l’un et l’autre ; mais je vois qu’en réalité vous tirez de concert à bout-portant contre M. Joly de Fleury, votre intermédiaire.
S’il fallait vous en croire tous les deux, ce ministre aurait seul créé pour plus de cent trente millions de dépenses ordinaires et annuelles encore subsistantes aujourd’hui en pleine paix… Qui que ce soit au monde ne s’attendait à cette découverte. C’est à vous deux à la prouver. Celui qui fut le successeur de l’un et le prédécesseur de l’autre est plein de vie : ses moyens de défense doivent être subsistants.
Je dis cent trente millionset plus, car il s’était procuré, par l’addition des sols pour livre aux impôts et par le troisième vingtième, cinquante millions au moins de revenus annuels plus que M. Necker, qui se trouvait au pair, à ce qu’il dit. Par conséquent, pour être court de quatre-vingt, comme vous le prétendez, il faudrait que l’administration intermédiaire eût seule augmenté la dépense annuelle et ordinaire de cent trente millions.
C’est donc là précisément ce que vous devez prouver tous les deux au grand étonnement général ; car M. Joly de Fleury n’a jamais été regardé comme l’extendeur des dépenses.
TROISIÈME OBJET.
Tous les magistrats du royaume, regardant comme leur devoir le plus essentiel de mettre la vérité sous les yeux du Roi qui la chérit, se sont accordés à lui rappeler deux points capitaux. Le premier, que son peuple se trouve surchargé tous les ans de six cents millions. Le second, que le revenu quitte et net de son trésor se trouve bonifié de cent trente millions au moins depuis l’année 1776, le dernier vingtième non compris.
De ces deux vérités, ils ont conclu que votre déficit annuel de cent quatorze ou quinze, annoncerait une augmentation de dépenses ordinaires en 1786 et 1787, époque de paix, qui se monterait à deux cent quarante millions et plus.
Vous essayez, Monsieur, de contredire sur ces deux points tous les parlements de France, et vous critiquez jusqu’à la cour souveraine que vous semblez demander pour juge.
Laquelle des deux propositions pouvez-vous trouver exagérée ?
Quand M. Necker a donné son état de ces énormes surchages, qu’il porte à six cents millions, je me flatte d’avoir prouvé très clairement qu’il était infiniment au-dessous de la réalité.
Outre ces six cents millions, à peu près, qu’il jugeait à propos de compter, il existe malheureusement deux articles, aussi réels que considérables, qu’il s’obstine à dissimuler au monarque et à la nation ; ne voulant jamais calculer au juste le premier, et s’acharnant toujours à ne faire aucune mention du second, qui n’en reste, hélas ! ni moins vrai, ni moins déplorable.
Le premier, c’est celui des faux frais. J’entends par là, 1°. tous les pillages secrets, et toutes les exactions clandestines des commis subalternes. Je soutiens que cet article est excessivement fort. 2°. Le renchérissement des marchandises vendues par le contrebandier, autre partie qu’on veut en vain dissimuler. Les fraudeurs vendent huit ou neuf sols du sel qui n’en vaudrait que deux dans l’état de liberté, mais qui se paie quatorze au regrat de la ferme. Ces huit ou neuf sols ne sont pas tous un profit quitte pour les contrebandiers eux-mêmes qui font de gros frais. Mais le sel n’en coûte pas moins six sols par livre, plus que sa vraie valeur, au particulier qui l’achète de cette manière… Je persiste à soutenir que M. Necker n’a jamais bien évalué cette seconde surcharge, non plus que la troisième espèce de faux frais, qui sont les procédures, saisies, amendes et confiscations ; papier marqué, contrôles, huissiers, procureurs, avocats, greffiers et juges, etc., etc., etc.
L’autre article est si manifeste, que la persévérance de M. Necker, à n’en jamais faire nulle mention malgré mes réclamations continuelles, me paraît incompréhensible. Ce sont les pertes que causent ces impôts désastreux, appelés gabelle, aides, taxes sur les cuirs, etc., etc. Car enfin, je le répète, quarante mille commis, dont il avoue l’existence ; quarante mille fraudeurs rodant autour des barrières qui ferment d’abord tout le royaume, puis les provinces intérieurs, puis chaque ville, et jusqu’à des bourgs, perdent quatre-vingt mille journées de travail utile tous les jours ; sans compter celles que perdent les citoyens, en gros ou en détail, pour aller chercher les bureaux de la ferme ou de la régie, attendre la commodité de messieurs les commis, et discuter leurs prétentions. Le sel, qui ne se consomme plus, étant trop cher, les récoltes qui ne naissent plus, le bétail, les cuirs, qui n’existent pas, faute de sel ; les légumes, la viande, le poisson, qu’on ne peut plus saler, etc., etc. Qui peut les méconnaître, ces pertes journalières, ces pertes si manifestes ?
De ces pertesinestimables, ainsi que de la totalité des faux frais, il n’en entre pas une obole ni au Trésor du Roi, ni même dans la caisse des fermiers généraux, ni des régisseurs. Tout est perdu.
M. Necker a beau faire, il n’est plus possible de les dissimuler ni au Roi, ni à son clergé, ni à sa noblesse, ni à ses vrais, ses loyaux et fidèles sujets les propriétaires fonciers ; il a beau dire, ce n’est pas seulement les six cents millions qu’il a confessés, mais plus de sept, plus de huit que la nation paye ou perd tous les ans, pendant que la recette du Roi n’est que de quatre cent soixante-quinze.
Vous taxez tous les magistrats d’avoir exagéré. Je prends la liberté de leur remontrer qu’ils sont restés fort au-dessous de la réalité, pour avoir suivi l’évaluation très fautive de M. Necker. Ce n’es plus à lui, ce n’est plus à vos juges que vous avez à faire sur ce point. C’est à moi qui vous défie, comme j’ai défié M. Necker, et qui suis prêt à vous répondre, pour éclairer enfin la religion du monarque, de ses ministres, de tous mes compatriotes, de M. Necker et la vôtre.
La seconde proposition adoptée par toute la magistrature, que vous tâchez d’obscurcir, ne me paraît pas moins certaine.
« Il est faut, dites-vous, que les impôts soient augmentés de cent trente millions. »
Mais, en vérité, pouvez-vous ignorer que les revenus quittes du Trésor royal sont bonifiés de deux manières, savoir : par l’augmentation du produit des impôts, et par la cessation des charges annuelles du Trésor !
Ici vous êtes en contradiction formelle avec M. Necker. Tout le monde a vu et lu comme nous, pendant le carême dernier, son mémoire contre vous. Il renferme deux tableaux bien détaillés des augmentations dans le produit annuel des droits et des diminutions de charges annuelles du Trésor royal, article par article. Le premier état de ces bonifications se monte, dit-il, à quatre-vingt-quatre millions ; le second, à quatre-vingt. Je les ai sous les yeux en ce moment… Vous n’avez pas osé contester un seul des objets qu’ils renferment… S’il y en a de faux, dites-le donc : donnez-en donc la preuve avant tout.
Ces deux sommes de quatre-vingt-quatre millions d’une part, et de quatre-vingt millions d’autre part, font cent soixante-quatre millions. Et vous accusez tous les magistrats d’exagérer, parce qu’ils ont dit cent trente ! … Vos débats n’étant ni produits, ni justifiés, la présomption reste au compte imprimé sous vos yeux, et qui vous a été signifié en personne il y a six mois. Je ne dis pas qu’il soit parfaitement exact ; mais jusqu’à ce moment, n’ayant pas même essayé de combattre ces deux états, dont le total donne cent soixante-quatre, devons-nous croire coupables d’exagération les cours souveraines qui disent cent trente ?
QUATRIÈME OBJET.
Vous voulez, Monsieur, nous faire préjuger à tous un fameux procès criminel, qui se poursuit à la cour des monnaies, et qui fut commencé dans le temps où vous étiez encore au ministère, même en pleine faveur, du vivant de M. de Vergennes. Mais le Roi, ses ministres actuels, et le public, peuvent-ils décider du mérite de votre apologie avant l’arrêt définitif que le tribunal supérieur et compétant doit prononcer sur le vu des pièces dans une matière très difficile, et qui suppose beaucoup d’expérience !
Je vais analyser vos raisonnements extrajudiciaires. Premièrement, dites-vous, les louis d’or qu’on échangeait pour quatre écus de six livres, valaient beaucoup plus, car d’un marc d’or on ne faisait que trente louis produisant cent vingt écus de six livres. Il valait cent vingt-huit écus.
Une loi juste, sage, utile, a ordonné qu’on refondrait tout l’or du royaume, qu’on diviserait le marc en trente-deux louis d’or au lieu de trente.
Mais (ajoutez-vous), par un bel et bon procès-verbal, dans la meilleure forme possible, on a fait une grande et singulière découverte… Laquelle donc ? … c’est, dites-vous, que la majeure partie des louis d’or anciens était de la fausse monnaie ; … vous l’avez cru d’abord sur un certain mémoire anonyme qui paraît avoir été fabriqué, lorsqu’en 1770 on détruisit la cour des monnaies de Lyon, pour faciliter la création de ces trop fameux sièges substitués aux parlements.
Vous l’avez cru, et vous l’avez fait justifier, dans une forme qui vous paraissait très légale, au mois de novembre 1785, dans le cours d’une opération singulière qui dura cinq ou six grands jours.
Ce procès-verbal si démonstratif a-t-il été dressé par la cour des monnaies assemblée ? … Il me semble que non… Par des commissaires très expérimentés qu’elle eût nommés ? … Il me semble que non… Par quels juges donc ? … Par le nouveau procureur général de cette cour, jadis, assure-t-on, secrétaire de l’intendance de Metz, reçu en juillet 1784, et dont l’expérience, consommée en cette partie si difficile, était certainement très précoce en 1785.
Je n’ai pas l’honneur d’être né dans la magistrature, ni d’avoir exercé le ministère public ainsi que vous, Monsieur. Mais il me semble qu’un procès-verbal de ce genre devrait être fait par des juges, en présence il est vrai du procureur du Roi, qui le demande, et qui ne s’y trouve que comme partie et comme témoin nécessaire.
En conséquence j’apprends que ce prétendu procès-verbal est précisément le délit sur lequel s’instruit actuellement le procès criminel à la cour des monnaies. Étant attaqué lui-même en justice réglée, ce procès-verbal de six jours peut-il servir de pièce justificative? [21]
Suivant le récit que vous a fait ce nouveau procureur général, tous les directeurs de France avaient été si prévaricateurs, sans qu’il y eût aucune justice exercée contre eux par la cour des monnaies, ni par le ministère, depuis 1726, que sur la masse entière des espèces d’or en France, il manquait la valeur de sept livres dix sols par marc. En vérité, Monsieur, plus le fait était grave et invraisemblable, moins il devait être cru sans une très grande vérification.
« Vous ajoutez que les lettres patentes qui l’énoncent formellement sont enregistrées ? Où ? À la chambre des comptes… » Bon pour la comptabilité…, qui suppose le fait comme exact et régulièrement constaté. Mais la chambre des comptes n’a dû, ni pu, ni voulu vérifier ce fait de fausse monnaie, si commune depuis 1726. Il n’était pas de sa compétence.
C’était, je pense, à la cour des monnaies à le juger. Et certes, l’opération était importante ; la décision très difficile.
On pourrait même vous faire cette objection. Si tous les louis d’or étaient à un faux titre, comment avez-vous supposé que tous les écus de six livres du royaume, fabriqués par les mêmes personnes aux mêmes hôtels, ne l’étaient pas ! L’avez-vous aussi fait vérifier dans le procès-verbal de six jours ? Si vous n’en êtes pas assuré, qui vous a dit que les lois d’or actuels ne valent que quatre de ces écus de six livres ? Et s’ils valaient beaucoup plus, n’y verriez-vous aucune risque, d’après vos propres idées !
CINQUIÈME OBJET.
Vous parlez, Monsieur, avec une grande sécurité des papiers commerçables que vous avez remis au sieur Piron qui les a donnés en gage à des banquiers, et de l’usage qu’il en a fait de votre aveu, pour soutenir la valeur des actions, soit de la nouvelle Compagnie des Indes, soit des Eaux de Paris.
Vous alléguez à cette occasion qu’il fallait soutenir alors le crédit du Roi et celui du commerce français : mais on trouve dans vos mémoires et dans la lettre du sieur Haller, banquier, que vous produisez des aveux très singuliers à mon avis, et qui demandent explication.
Premièrement, les nouvelles actions de votre Compagnie des Indes venaient d’être créées de mille livres chaque : il y en avait pour vingt millions.
On les avait vendues quinze cents livres à M. l’abbé d’Espagnac. Il y avait donc cinq cents livres de gagnés sur chaque action, ce qui faisait dix millions sur le total.
Quel était donc le vendeur gagnant les cinq cents livres ? … Le sieur Haller ou l’abbé d’Espagnac le diront à ceux qui doivent le savoir, et au public.
Secondement, sur les actions de mille livres qu’il achetait quinze cents livres à crédit, comme en conviennent le sieur Haller, l’abbé d’Espagnac voulait emprunter treize cents francs comptant: c’est déjà trois cents livres au-dessus de la valeur créée par le Roi ; ce serait, sur le total, six millions de réalisés par provision. À qui remettait-on ces treize cents livres par action ? L’un des deux l’indiquera.
Pour obtenir ces treize cents livres, MM. Piron, l’abbé d’Espagnac et compagnie donnaient de si grands avantages, que tous les banquiers genevois, et leurs correspondants de Paris, succombaient à la tentation : c’est une concession très ingénue de la part d’un étranger qui tient une banque genevoise déjà si favorisée ; une banque dont les agents successifs, les sieurs Telusson, Necker frères et Girardot, ont déjà réalisé des millions en terres titrées, en palais à la ville, en charge et autres places honorifiques souvent très coûteuses, et qui n’en a pas moins (dit-elle), trois ou quatre millions en activité.
Mais, 1°. quels étaient donc ces avantages, quels étaient donc les avantagés ? Mais, 2°. qu’avaient donc à faire les deniers du Roi dans ce patricotage ? Tout le monde vous le demande.
Bien loin de favoriser le crédit de l’État, en soutenant le prix des contrats et papiers créés et autorisés pour le service de Sa Majesté, ces avantages énormes offerts par le sieur Piron, l’abbé d’Espagnac et compagnie aux banquiers étrangers et nationaux, ne pouvaient que renchérir l’argent et faire tomber les vrais effets du Roi.
Bien loin que les manufacturiers, les négociants français, qui achètent les marchandises françaises pour les revendre à des Français, fussent favorisés par là, ces mêmes avantages, joints à d’autres causes, devraient leur ôter toute ressource dans leurs plus pressants besoins.
Car les capitalistes spéculateurs ne donnent point leur argent au vrai commerce, quand ils trouvent ailleurs d’énormes bénéfices. Aussi la détresse d’une part, et l’exaltation usuraire de l’autre, ont-elles été à leur comble.
Les banquiers étrangers gagnaient donc excessivement à prêter sur gages en argent ou en bon papier les treize cents livres aux sieurs d’Espagnac, Piron et autres.
Mais, dit M. Haller, ils auraient couru des risques, s’ils n’eussent demandé pour gages que les actions de la compagnie, créées pour mille livres, et le seul cautionnement de ces associés.
Ils auraient couru des risques, dites-vous ? Eh bien, pourquoi pas ! s’ils risquaient de tant gagner, ces étrangers séduits par l’appas d’énormes avantages, ces étrangers qui n’aidaient d’une obole ni les manufactures ni les marchands des objets les plus utiles ?
Le sieur Haller vous a dit qu’il fallait leur donner double gage, double sûreté. Mais quand ce banquier étranger vous alléguait à cette occasion le bien public et la prospérité de l’État, ce n’est sûrement pas la France et les Français qu’il entendait par ces paroles.
Quoi ! des Genevois, des Allemands qui veulent gagner beaucoup, prêtent treize cents francs à un ecclésiastique et au sieur Piron sur chaque action, qui n’a de valeur que mille livres : et l’intérêt de la noblesse, du clergé, des magistrats, des bourgeois propriétaires, des cultivateurs de terre de toutes nos provinces, des bons marchands qui nous vendent les objets de nos besoins ; celui des ouvriers et autres salariés de toute espèce, est que ces Genevois, ces Allemands, ne risquent rien ? Que les treize cents livres par eux prêtés sur gages à ces associés, ainsi que leur énorme bénéfice soient infailliblement assurés ? C’est bien le cas de dire avec le poète latin :
Credat judeus appela.
[Que le juif Appela le croie s’il le veut. — Horace, Satires, 5.]
Mais enfin, quels moyens les sieurs Piron, d’Espagnac et autres vous ont-ils dont fait adopter ? Ce sont, dites-vous, des assignations tirées sur le Trésor royal au profit des trésoriers de la guerre et de la Maison du Roi, pour la fin de cette année 1787. Bon Dieu, quelle confession vous faites là, Monsieur !
Qu’entendez-vous donc par des assignations ? Je conçois que le Roi décidant, vers la fin de chaque année, quelles sommes seront employées au département de la guerre, à celui de sa Maison, Sa Majesté fait une première assignation générale de ces deux objets de dépense sur la totalité de ses revenus.
Je comprends de même qu’un administrateur des finances, divisant chacun de ces deux objets par mois et par douzième partie, par exemple six millions par mois pour la guerre, trois pour la Maison du Roi, assigne les six millions de la guerre sur les tailles et capitations qui lui sont attribuées par l’ancienne constitution du Royaume ; les trois millions de la Maison du Roi sur le produit des domaines, dont c’est l’antique et légale destination.
Mais, Monsieur, ces arrangements économiques n’exigent certainement aucuns papiers de banque et de négoce à mettre en circulation, il ne faut que les notifier d’une part aux receveurs généraux des finances qui doivent payer six millions tous les mois à la guerre, aux administrateurs des domaines, qui seront tenus d’en verser trois à la Maison du Roi et aux trésoriers qui les recevront.
Dites-nous donc, je vous prie, par quel motif, par quelle autorisation régulière le sieur Piron vous a persuadé que vous pouviez en faire fabriquer les assignations dix ou douze mois par avance, en papier de banque publique ?
On avait bien imaginé d’anticiper la recette des revenus du Roi, par ces malheureux papiers, qui ne sont que trop connus. Vous et vos prédécesseurs avez assez bien usé, c’est-à-dire abusé, de ce moyen très illégal et très dangereux. M. Necker trouva que ses prédécesseurs avaient dépensés d’avance, sous cette forme, pour soixante millions de recettes futures, il en mangea d’avance quarante autres millions de son propre aveu. Vous en trouvâtes encore, dites-vous, soixante-treize autres millions, ainsi consommés de plus, toujours par anticipations. Vous confessez en avoir laissé de votre propre fait, pour soixante-dix-neuf millions encore de plus. Je calcule que ces sommes réunies font un total assez honnête de deux cents cinquante millions sur un revenu quitte et net que vous évaluez au total à quatre cent soixante-quinze millions par an.
Mais après avoir ainsi dissipé la recettepar avance, anticiper aussi la dépense par des assignations négociées en banque, c’est une invention qui pourrait bien paraître nouvelle ?
Quoi qu’il en soit, il me semble voir dans cette opération trois créanciers affectés et hypothéqués sur la même somme. Auquel déciderez-vous qu’elle appartient de préférence ?
Vous avez reçu d’un prêteur, en argent comptant, six millions qui sont dépensés dès 1786. Vous lui avez donné, par des descriptions au porteur qui circulent en banque, une affectation spéciale sur la caisse des recettes générales, premier créancier. Le Roi destinait les mêmes revenus à la guerre, et vous-même vous les avez assignés ces mêmes six millions, au trésorier qui doit payer les officiers et les soldats, second créancier. Mais l’assignation a été remise au sieur Piron en papiers de banque, et par ses mains à des agioteurs étrangers pour leur garantir le capital et le gros intérêts des actions de mille livres vendues quinze cents livres à la compagnie de M. l’abbé d’Espagnac, troisième créancier.
Mais, dit le sieur Haller avec le sang-froid le plus merveilleux, dans cette lettre que vous citez comme un oracle, « il est probable que les sieurs Piron et d’Espagnac vendront leurs actions avec profit, qu’ils retireront les assignations englouties par la banque, et qu’ils les rendront au Trésor royal… » Probable ! … Et sur cette probabilité d’agiotage qui ferait vendre à des dupes plus de quinze cents livres un papier très douteux, qui venait d’être créé pour mille francs, vous risquez la solde entière des troupes, la propre subsistance de la famille royale ? Vous les mettez à la merci du sieur Piron, si connu du parlement ?
Qu’on admette la combinaison de ces manières d’opérer sur les finances du Roi, quel pourrait être le résultat ? Une masse de restrictions aura consommé par avance, en 1787, tous les fonds que les receveurs généraux doivent compter en 1788. Cependant on assignera, par des papiers de banque, sur ces fonds qui ne sont plus à recevoir, la subsistance de l’armée… Et cependant encore, ces papiers seront portés en gage à des banquiers étrangers, pour sûreté d’un objet qui n’a pas le moindre rapport avec le militaire ! En vérité, Monsieur, si la compagnie qui patricottait les nouvelles actions des Indes et des Eaux de Seine, vous a donné de bonnes et solides raisons, pour vous persuader que vous pouviez, même sans aucune autorisation du Roi, mettre un pareil ordre dans ses finances, vous devez, sans perdre du temps, les communiquer au public.
DERNIER OBJET.
Vous voulez, Monsieur, justifier l’échange du comté de Sancerre, mais sans vous faire aucune inculpation personnelle, je trouve deux singuliers aveux dans votre mémoire.
Premièrement, M. d’Espagnac était, dites-vous, originairement comme un prête-nom du Roi, qui destinait Sancerre à Monsieur, pour faire partie de son apanage. C’est avec l’argent du Roi fourni par feu M. de Vergennes et vous, sur les affaires étrangères, qu’en fut faite l’acquisition.
Mais on assure que les héritiers de Madame la princesse de Conti mère ne l’ont vendu qu’un million quatre cent mille livres. Ce contrat fait si nouvellement avec trois princes du sang, par leurs trois conseils, est facile à vérifier et ne peut être soupçonné de collusion.
Il n’y avait donc pas lieu, ce me semble, suivant vous-même, à faire l’estimation de cette seigneurie. Il fallait rendre à M. d’Espagnac le prix qu’il en avait donné. Comment pouvez-vous prouver qu’on doit lui payer trois millions et plus ? Premier point.
Secondement, vous ne trouvez aucun inconvénient à lui payer ces trois millions en forêts de haute futaie, estimées au denier trente de leur produit annuel !
Mais, Monsieur, je crois premièrement qu’il existe des lois qui ne permettent pas de comprendre les grandes futaies du Roi, dans les engagements ni même dans les échanges. Je crois secondement que dans les forêts aménagées en grands arbres, qu’on ne coupe qu’après cent ans, tous ceux qui en ont plus de trente font un fonds et non pas un revenu.
Si vous me donniez un bois de cette espèce qui contînt cent arpents, la coupe annuelle ne serait en grande futaie que d’un seul arpent ; supposez le vendu trois mille livres, tous les ans il donnerait un revenu de mille écus, valant quatre-vingt-dix mille livres, suivant votre évaluation au denier trente.
Je le mettrais en coupe réglée de taillis à l’âge de dix ans…, j’aurais, dès l’an 1798, dix arpents de taillis à couper tous les ans, qui me vaudraient plus de deux mille livres de revenus, mais j’aurais vendu d’abord soixante-dix arpents de haute futaie qui m’auraient produit plus de cinquante mille écus, et vingt arpents de taillis, dont l’âge serait depuis dix ans jusqu’à trente…, et j’aurais payé le tout quatre-vingt-dix mille livres ? Je crois le marché trop avantageux pour avoir jamais été fait.
Il me semble qu’en pareil cas on estime non pas la seule valeur du sol, non pas le produit annuel d’une coupe de futaie, mais tous les bois qui existent surtout ceux dont l’âge passe trente ans.
Hâtez-vous donc, Monsieur, de donner au public les éclaircissements que je vous demande, car il me paraît qu’ils peuvent seuls opérer votre justification.
FIN.
——————
[1] Henri Bertin, contrôleur général des finances de 1759 à 1763.
[3] J’oubliais qu’il faudra pourvoir aux indemnités des hôpitaux de quelques hôtels de villes et de quelques seigneurs particuliers. On en ferait une grande objection ; mais c’est une misère à laquelle on satisferait de même.
[4] Dieux, inspirez de meilleures pensées à ceux qui sont pieux et réservez cet égarement à vos ennemis ! (Virgile, Géorgiques, III, 513.)
[8] Défense de M. Necker (1787).
[9] Jean-François Joly de Fleury.
[12] Henri Levèfre d’Ormesson.
[15] Condorcet (Vie de Monsieur Turgot).
[16] Du Pont (de Nemours) (Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, ministre d’État)
[19] Le bon sens est le principe et la source du bien écrire. (Art Poétique, 309.)
[20] Semblable facilité doit être accordée aux propriétaires des offices et aux rentiers du Roi : cette justice est trop sensible, pour que je m’arrête à la démontrer. (Note de l’auteur.)
[21] Il paraît une copie de ce prétendu procès-verbal à la suite d’un mémoire sur sieur Carra. Si par hasard elle était exacte, l’original ne pourrait jamais soutenir les regards de la justice, il ne pourrait entrer dans aucun progrès que comme pièce de conviction.


Laisser un commentaire