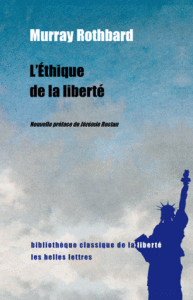Entretien avec Jérémie Rostan*, auteur d’une préface à la réédition française de l’Ethique de la liberté de Murray Rothbard, qui parait aux Belles Lettres ce 19 mai 2011, dans la collection Bibliothèque classique de la liberté, dirigée par Alain Laurent.
Lorsque The Ethics of Liberty est publié en 1982, Murray Rothbard (1926-1995) n’en est pourtant pas à son coup d’essai : dans une veine semblable, cet émule de Ludwig von Mises s’est fait connaître en 1973 avec For a New Liberty : The Libertarian Manifesto. Mais dans son nouvel opus et en partant d’une décapante « robinsonnade », il radicalise le libertarianisme en prônant une liberté individuelle maximale, l’État zéro et une société totalement privatisée fondée sur l’échange volontaire et le capitalisme de laissez-faire, eux-mêmes légitimés par une réinterprétation rationaliste rigoureuse de la tradition du droit naturel, du droit de propriété et de la morale qui en découle.
Dans cet entretien, Jérémie Rostan décrypte pour l’Institut Coppet les principales thèses philosophiques contenues dans L’Ethique de la liberté et répond aux objections qui lui sont couramment adressées.
Damien Theillier : Peut-on faire un parallèle entre la pensée de Rothbard et la pensée libérale française, celle de Turgot, de Condillac et de Bastiat ?
Jérémie Rostan : Rothbard était effectivement le premier à revendiquer une telle parenté. Ses écrits fourmillent de référence à Turgot, comme à Bastiat, auxquels il a même consacré des textes entiers.
La principale raison est qu’il voyait dans le libéralisme français une sorte de proto-austrianisme oublié, et pourtant supérieur aux classiques britanniques (A. Smith, etc.)
Ceci étant, Rothbard n’avait, à ma connaissance, guère idée du génie de Condillac, auteur encore ignoré, de nos jours, de la plupart des libertariens, y compris en France.
Damien Theillier : Peux-tu expliciter le sens de cette radicalité ? Pourquoi n’est-elle pas partagée par tous les libéraux ? En particulier Hayek et Nozick que Rothbard critique.
Jérémie Rostan : Cette radicalité est double. Lorsque l’on affirme quoi que ce soit, on affirme en effet, d’une part toutes les prémisses dont cela découle, jusqu’aux premiers principes, et, d’autre part, toutes les conséquences qui se déduisent de ces derniers.
Rothbard acceptait ainsi d’être taxé, si je puis dire, d’extrémisme, car seuls les extrémistes sont cohérents, c’est-à-dire conséquents.
Telle est aussi la source de ses critiques envers Hayek et Nozick. Au premier, il reprochait de ne pas partir de principes suffisamment clairs et premiers. Sa définition de la coercition, notamment, lui semblait bien vague, interdisant la déduction logique d’un système sur la base de la seule Règle d’Or de non-agression. Plus encore, Rothbard reprochait précisément à Hayek de ne pas partager sa forme axiomatique, ou logico-déductive, de libéralisme, lui préférant une approche plus empirique et évolutionniste. Au second, il reprochait de ne pas « aller jusqu’au bout », s’arrêtant à un État minimal après un long argumentaire contre la production marchande de services de sécurité.
Il faut de plus remarquer que cette radicalité est la forme même de Man Economy and State, comme de l’Éthique de la liberté. Dans le premier, Rothbard déduit la science économique et le fonctionnement d’un pur marché libre, ainsi que les dysfonctionnements de l’interventionnisme, sur la seule base d’une analyse de l’action humaine.
Cette praxéologie est aussi à l’œuvre dans l’Ethique de la Liberté. Ici, Rothbard décrit le code de loi convenant à une société libre sur la seule base du principe de propriété de soi / non-agression d’autrui.
Damien Theillier : En quoi cette approche praxéologique se distingue-t-elle des autres ?
Jérémie Rostan : Économiquement, elle s’oppose à la version néoclassique du libéralisme, laquelle consiste, non pas dans une déduction praxéo-logique, mais dans la construction hautement abstraite et mathématisée de modèles, imitant la méthode des sciences naturelles. Moralement, eh bien, les néoclassiques se contentent le plus souvent de justifier leur libéralisme pour son efficacité économique, sur la base d’un utilitarisme social. Ils ne le fondent donc pas dans une règle d’Or, comme le fait Rothbard. Leur défense est donc moins forte, pragmatique, plutôt que de principe. Pour cette raison, ils sont aussi bien prêts à en refuser certaines conséquences, par exemple en défendant les « politiques de concurrence », et autres formes d’interventions censées corriger des défauts… qui sont ceux de leurs modèles, mais non d’un pur marché libre.
Damien Theillier : On fait couramment cette objection à l’anarchisme : il ne suffit pas de supprimer l’Etat pour supprimer la violence. L’homme n’est pas bon. Comment une société anarchiste peut-elle gérer la violence qui subsiste en l’homme ?
Jérémie Rostan : Cela reprend un peu la question précédente sur l’État minimal. La confusion, ici, est que les libéraux « anarchistes » défendent jusqu’à la libéralisation des services de coercition précisément parce que « l’homme n’est pas bon ». Si les hommes tendent à être violents, alors pourquoi diable instituer un monopole permettant aux intérêts combinant le plus grand capital politique d’exercer une violence incontestée, à grande échelle, et sous des formes souvent déguisées ?
Cette question est évidemment complexe. C’est-à-dire qu’elle en contient plusieurs. Pour cette raison, elle est aussi bien primordiale que secondaire. Le fait que l’armée et la police soient des services publics n’est par exemple pas le problème le plus urgent à régler. En revanche, certaines fonctions dites régaliennes devraient urgemment être remises en cause, à commencer par la politique monétaire. En fait, la confusion est celle de l’État et du gouvernement. Au fond, même un anarchiste comme Rothbard acceptait une certaine forme d’État, puisqu’il prévoyait qu’une société libre aurait une sorte de constitution, un code libertarien. Ce à quoi il s’opposait catégoriquement, en revanche, c’est à la politique, c’est-à-dire à l’intervention législative dans les droits naturels. Soit la justice, par exemple. On objecte souvent aux anarchistes que la société a besoin de lois, et donc d’un État. Mais L’Ethique de la Liberté tout entière n’est finalement rien d’autre que la preuve par le fait de ce qu’un système complet de règles se déduit tout naturellement du principe de liberté individuelle. Une première conséquence en est qu’il suffit à la défendre, et que toute législation est donc inutile. Mais une seconde en est qu’il est nécessaire, au sens ou toute législation s’en écartant ne pourrait être que nocive.
Damien Theillier : Pourquoi intituler « éthique » une œuvre traitant plutôt de politique ?
Jérémie Rostan : En raison de son radicalisme, encore une fois. Pour Rothbard, le système de règles nécessaire à la vie en société relève de l’éthique, et non pas de la politique. La différence est simple, mais révolutionnaire. S’il est possible d’établir un tel système par pure déduction logique, sur la base de principes incontestables, alors toute activité législative est non seulement inutile, mais néfaste. Or c’est la ce que permet l’éthique, selon Rothbard : partir d’une norme objective, dont l’autorité soit donc parfaitement légitime.
Démocrates, il nous semble normal que les lois émanent d’un processus de décision collective. A la réflexion, il y a là contradiction, pourtant. En effet, si l’on juge un tel processus normal, c’est parce que l’on pense inacceptable que les gouvernants exercent un pouvoir arbitraire. Mais pour quelle raison ? On commencera peut-être par répondre qu’il est illégitime qu’une infime minorité règne par la force sur l’immense majorité. Bien vite, on se rendra cependant compte que les effectifs n’ont rien à voir dans l’affaire : on trouvera tout aussi illégitime que l’immense majorité règne par la force sur une infime minorité, comme cela peut être le cas dans un régime esclavagiste. On dira donc qu’il est illégitime qu’un groupe d’hommes en asservisse un autre, quelque soit leur nombre. De fait, ce que l’on refuse, c’est le principe même du règne par la force en tant que mode de rapport humain. Soyez donc cohérents avec vous-même, dirait alors Rothbard. Si vous acceptez ce principe de non-agression, vous devez en effet en accepter toutes les implications logiques. Or celles-ci constituent un système de normes permettant l’économie de toute la politique. Ne voyez-vous pas, ajouterait-il, que celle-ci ne peut être qu’une version parmi d’autres de la loi du plus fort, laquelle ne peut être dépassée que dans une société libertarienne interdisant toute initiation de la force — et rien d’autre ?
Damien Theillier : La société libre de Rothbard est, selon ses propres termes, un pur marché, le règne d’un capitalisme débridé. N’est-ce pas là encore la loi du plus fort ?
Jérémie Rostan : C’est l’opinion courante, en effet, mais elle est mille fois fausse. D’une part, ce qu’on appelle « loi du plus fort », ici, c’est la libre concurrence. Or il y a là une grave confusion. Certes, la libre concurrence récompense les plus forts aux dépens des plus faibles, qu’elle peut sanctionner jusqu’à la faillite. Mais ceux qui règnent grâce à elle, ce sont, par exemple, les plus forts dans la construction automobile, c’est-à-dire ceux qui offrent le meilleur véhicule au meilleur prix. C’est l’intervention de l’État entravant la loi du marché qui favoriserait les intérêts particuliers des plus aptes à la violence légale, et cela aux dépens de la satisfaction de la demande, c’est-à-dire de l’intérêt général—l’accès du plus grand nombre possible aux meilleurs véhicules possibles.
D’autre part, si la libre concurrence récompense les plus forts, au sens des plus compétents, il s’ensuit qu’elle ne peut bénéficier qu’aux faibles. Ceux qui occupent les meilleures positions, les gagnants, n’ont pas intérêt à ce que la compétition continue, mais cesse, ou bien soit aussi empêchée que possible. Seuls ceux qui n’ont pas encore réussi, qu’il s’agisse d’employés ou bien d’employeurs, peuvent tirer profit du droit de faire mieux que les autres qu’est la concurrence. Cette dernière définition est surement le meilleur argument en faveur du libéralisme, d’ailleurs, je veux dire la meilleure preuve de sa valeur morale, ainsi que de son utilité sociale.
Damien Theillier : Qui croit encore de nos jours à une morale absolue, à une distinction stricte du bien et du mal ? Nous vivons une époque sceptique et beaucoup en doutent.
Jérémie Rostan : L’Éthique de la liberté repose en effet tout entière sur l’idée selon laquelle il existe un critère permettant une distinction objective du Bien et du Mal et, sur cette base, une déduction logique des types d’action moralement condamnables.
Une telle position n’était guère à la mode à l’époque de Rothbard, et cela n’a pas vraiment changé. De nos jours, on considère généralement simpliste de penser en ces termes, rien n’étant jamais « tout blanc ou tout noir ». Le problème est que tout système de normes implique et opère une distinction entre le Bien et le Mal, et qu’aucune société ne peut se passer de telles règles. La question n’est donc pas de savoir si les catégories de Bien et de Mal ont un sens, mais lequel, et comment l’établir.
Damien Theillier : D’après Rothbard, le critère du Mal est l’initiation de la force physique. Comment le sait-il ? Comment être sûr qu’une action est en-soi condamnable si elle initie la force, et dans ce cas seulement ?
Jérémie Rostan : Tout simplement parce que c’est la seule réponse possible. La seule alternative est en effet la loi du plus fort. Or, avec elle, la distinction du Bien et du Mal disparait. Le principe de non-agression n’est en fait que le négatif des droits naturels, c’est-à-dire inaliénables. Sans eux, il ne peut y avoir aucun droits réels : seulement des codes de lois, ensemble de privilèges et de violations exprimant des rapports de force politiques. Là encore, nous autres démocrates sommes contradictoires : on pense d’ordinaire que la démocratie implique la souveraineté de la majorité, ainsi que le respect de certaines libertés fondamentales. Mais il faut choisir : si le peuple est souverain, alors son pouvoir doit être sans limites. Et si l’on pense qu’il doit être limité, alors on devrait reconnaitre que c’est par le droit absolu de chacun d’agir librement tant qu’il n’empiète pas sur le droit identique de tout autre.
Damien Theillier : Tout ceci repose sur l’idée de libre-arbitre. Que répondrait Rothbard aux sociologues qui invoquent l’influence du milieu social, etc. ?
Jérémie Rostan : Que sans libre-arbitre, il n’est aucune éthique, ni aucune doctrine du droit possible. Aucune éthique, parce que l’homme serait privé de toute dignité. La critique marxiste du libre-arbitre est ainsi contradictoire : si les travailleurs sont, comme les hommes en général, dépourvus de libre-arbitre, qu’est-ce qu’il pourrait bien y avoir de mal à les exploiter et à les traiter comme des animaux (si cela était effectivement le cas) ? Aucune doctrine du droit, parce que celle-ci n’a de sens que si elle réglemente des choix. Certes, la « société » influence l’individu. Mais influencer n’est pas déterminer. Plutôt inciter. Or on ne peut influencer qu’un choix — et donc un être libre.
Damien Theillier : Si la morale est synonyme de respect de la personne humaine, ce respect se limite-t-il au respect de sa liberté ? Qu’en est-il de sa dignité ? N’est-elle pas la source d’un devoir de solidarité ? Et un tel principe ne justifie-t-il pas l’intervention de l’Etat ?
Jérémie Rostan : Cette question est intéressante, parce qu’elle montre que L’Ethique de la Liberté n’offre pas simplement une nouvelle conception morale, centrée sur la liberté plutôt que l’égalité, la piété, etc. mais renouvelle bien plutôt la conception de la morale elle-même. Sur le plan théorique, on peut dire que la morale libertarienne est négative, alors que toutes les autres sont positives : d’après la première, la morale interdit simplement de faire le mal, alors que d’après les secondes elle oblige a faire le bien. Cela peut sembler abstrait, mais c’est que cette révolution conceptuelle, je dirais même copernicienne, importe surtout sur le plan pratique, puisqu’elle concerne l’action humaine. Ou plus exactement sur le plan politique, puisqu’elle concerne l’action sociale — et sa régulation. En effet, L’Ethique de la Liberté inverse le rapport traditionnel entre morale et pouvoir. Toutes les autres morales, qu’elles soient progressistes, religieuses, etc., sont au fond des justifications de l’initiation de la force. Elles énoncent les conditions auxquelles cette dernière est légitime. Cela est très clair dans le cas de l’interventionnisme : « Les membres de la société ont le devoir d’être solidaires, donc l’Etat est en droit de redistribuer les richesses… » Dans le cas du libertarianisme, la morale est au contraire synonyme d’interdiction, et non pas d’autorisation, de la violence.
De fait, la conséquence en est que « faire le bien » ne relève plus de la morale. Mais il n’y a rien de plus normal ! Le domaine de la morale est en effet celui du devoir ; or, ce que je dois à autrui, c’est ce à quoi il a droit, et qui n’implique donc aucune générosité de ma part. Faire le bien, c’est tout autre chose : c’est faire pour autrui quelque chose que je ne lui dois pas, et à quoi je ne suis pas obligé — mais que je fais par solidarité.
Damien Theillier : Ceci évoque de nombreux thèmes kantiens. Peux-tu préciser la position de Rothbard à l’égard de ce philosophe ?
Jérémie Rostan : Relue à la lumière de L’Ethique de la liberté, la morale kantienne prend effectivement un tour étonnement libertarien. La première raison est qu’elle se fonde sur la sacralité de la personne humaine, et cela en raison de son caractère transcendant, c’est-à-dire de sa liberté. La deuxième raison est que Kant conçoit la morale comme une législation idéale : celle d’une société véritablement humaine, dont les membres se comportent les uns envers les autres en tant que fin en-soi. A cet égard, et c’est la dernière raison, le devoir kantien semble proche de l’impératif négatif libertarien : je ne traite jamais autrui comme un simple moyen tant que je n’initie pas la force envers lui. Je n’ai jamais à me sacrifier en quelque sens que ce soit pour bien agir. Ceci étant, il n’est pas compatible avec une éthique de la liberté que chacun doive respecter la personne humaine aussi bien « en lui-même ». La conséquence en est en effet un droit d’autrui, et finalement du gouvernement, sur des choix individuels non-agressifs, tels que le tatouage, que Kant condamnait.
* Jérémie Rostan est agrégé de philosophie et docteur en économie. Il enseigne ces deux disciplines à San Francisco.