GEORGES DE NOUVION
CHARLES COQUELIN : SA VIE ET SES TRAVAUX
(1908)
Ouvrage couronné par la Société d’économie politique (Prix Frédéric Passy)
Né à Dunkerque en 1802, Charles Coquelin est resté célèbre pour son livre Du crédit et des banques (1848) dans lequel il réclame l’adoption d’un régime de parfaite concurrence pour les banques, qui leur permettrait d’émettre des billets librement, comme cela a pu se passer en Écosse ou aux États-Unis. Négligées pendant près d’un siècle, ces idées ont été remises sur le devant de la scène par l’École autrichienne d’économie, et notamment par Friedrich Hayek, Prix Nobel d’Économie.
Spécialiste des banques, Charles Coquelin fut aussi très impliqué dans le mouvement de la science économique de son siècle. En 1840, il participa, avec Frédéric Bastiat, Horace Say, et Gilbert Guillaumin, à la création du Journal des Économistes ; en 1848, il fut des co-auteurs de Jacques Bonhomme ; puis, en collaboration avec Guillaumin, il dirigea le Dictionnaire de l’économie politique (1854), somme magistrale du savoir économique de l’époque, pour laquelle il écrivit les articles les plus substantiels, tels que Banque, Capital, Concurrence, Crises, Échange, Économie Politique, ou Industrie.
Dans cette étude sur sa vie et son œuvre, Georges de Nouvion retrace les accomplissements de Coquelin et précise la place que ce soldat oublié de la liberté a joué dans le développement de la science économique en France.
Introduction
Dans le grand mouvement d’idées du XVIIIe siècle, la curiosité des esprits avait été attirée vers toutes les directions. Ils s’étaient affranchis des entraves qui gênaient la liberté de leurs investigations. Les encyclopédistes, les philosophes, les savants avaient osé regarder les problèmes en face, discuter la valeur des solutions admises ou imposées et s’engager dans la voie de la libre critique. Les circonstances politiques, les fautes de la royauté, les embarras du Trésor, les besoins généraux conduisaient certains hommes à se préoccuper de sciences sinon nouvelles, du moins peu répandues, les uns, comme Turgot, dans le but de réaliser des améliorations immédiates et d’empêcher la course vers l’abîme, d’autres, tels que les physiocrates, dans un esprit plus théorique et dans l’intention de déterminer des lois générales de l’observation desquelles dépendrait l’avenir d’une humanité plus éclairée.
Les idées de J.-J. Rousseau — quelque contestables qu’elles puissent être — avaient exercé une grande influence sur la Révolution et inspiré la législation sociale. La crise financière et économique qui avait marqué les dernières années du siècle et la période impériale, les découvertes scientifiques, les inventions mécaniques, les premières applications de la vapeur, le rôle nouveau du crédit, la formation de la richesse mobilière avaient été, pendant la première période du XIXe siècle, des phénomènes sur lesquels l’attention de certains esprits s’était portée et les fondements de la science économique avaient été posés.
À la suite d’Adam Smith, de Ricardo, de Malthus, de J.-B. Say, de Destutt de Tracy, les générations qui arrivaient à maturité vers la fin de la Restauration fournissaient une phalange d’hommes qu’attirait l’étude des questions économiques. Ce qui se rattache au négoce était l’objet d’une préoccupation particulière. Il est le point de départ des raisonnements des « Réformateurs » ; c’est aux « négociants » que Saint-Simon s’adresse dans beaucoup de ses écrits et c’est sur les questions de commerce que finirent par se concentrer, avec le plus grand succès, les efforts de ses adeptes.
Mais beaucoup de ces jeunes gens, imprégnés des idées libérales qui se faisaient jour dans toutes les directions, réfléchissaient et, par leurs études, par leurs travaux, se préparaient à former cette élite d’économistes qui a brillé d’un si grand éclat vers le milieu du XIXe siècle, qui s’est groupée dans la Société d’Économie politique et dont Frédéric Bastiat est resté l’un des chefs vénérés.
La plupart d’entre eux ont fait partie des assemblées politiques où l’importance de leur rôle a été considérable. Ils ont aussi appartenu à l’Institut et ils ont établi à l’Académie des sciences morales et politiques des traditions de libéralisme économique dont leurs successeurs restent les vigilants gardiens. Le temps a cependant manqué à quelques-uns pour remplir leur destinée ; les circonstances ne leur ont pas permis de donner toute leur mesure ; leurs travaux sont un peu tombés dans l’oubli, et les générations qui les ont suivis ne savent pas toujours qu’elles leur sont redevables de quelque reconnaissance pour les progrès dont ils ont été les initiateurs. Tel est le cas de Charles Coquelin.
I. La famille de Coquelin. — Sa jeunesse. — Les Annales du Commerce. — Au barreau de Dunkerque. — Discussions économiques. — Retour à Paris. — Collaboration au Temps. — Le Monde de Lamennais. — Quesnay et Turgot. — À la Revue des Deux-Mondes. — La filature du lin et du chanvre. — La question des banques. — Les sociétés commerciales.
Coquelin (Charles-François) est né à Dunkerque le 25 novembre 1802[1]. Il était le second enfant de Jacques-François Coquelin, né lui-même à Dunkerque[2] et d’Isabelle-Claire Campe[3] née à Brouckerque. Ses parents eurent treize enfants dont le dernier naquit en 1820[4]. Ils étaient établis bouchers à Dunkerque où son grand-père Jean-Jacques Coquelin était, au moment de son décès, « maître boucher. » Le père de Coquelin abandonna, paraît-il, la profession de boucher pour se faire distillateur de genièvre. Mais la famille était dans une situation assez modeste pour que deux seulement des enfants, Charles et le dernier-né, aient fait leurs études classiques complètes et poussé leur instruction jusqu’à la licence en droit. Leur mère était une petite femme énergique, vive, ambitieuse pour ses enfants et dont la pensée constante était de faire tous les efforts, tous les sacrifices pour les mettre en mesure d’arriver à une brillante situation.
Nous n’avons pas pour Coquelin une source d’informations comparable à celle qu’a été, pour les biographes de Bastiat, la correspondance de leur personnage. Dans ses lettres, Bastiat se raconte lui-même. On peut y suivre ses actes au jour le jour et sa pensée, ses projets, ses espérances, ses troubles s’y manifestent en toute sincérité. Pour Coquelin, nous ne connaissons aucun indice personnel. Ses œuvres seules, éparses dans les journaux et les revues, subsistent. Encore n’a-t-il pas signé tout ce qu’il a écrit et ne peut-on, dans certains cas, lui attribuer des articles que sous réserve.
Le seul guide que nous ayons est la notice biographique que M. G. de Molinari publia dans le Journal des Économistes[5] après la mort de Coquelin. M. de Molinari et Coquelin avaient tous deux collaboré au Journal des Économistes, au Libre-Échange, à Jacques Bonhomme ; ensemble ils avaient été aux côtés de Bastiat à l’Association pour la liberté des échanges dont ils étaient secrétaires-adjoints ; des relations d’amitié existaient entre eux et c’est d’après ce que Coquelin avait lui-même, dans les entretiens familiers, raconté de sa vie, de ses débuts, de ses premiers travaux, que M. de Molinari a écrit sa notice.
Par elle, nous apprenons que Coquelin avait fait de brillantes études au collège de Douai[6] où la vivacité de son intelligence le faisait remarquer par ses professeurs autant que l’égalité de son humeur et la douceur de son caractère le faisaient aimer de ses condisciples. Il y avait acquis une forte instruction que secondait une mémoire remarquable. Vers la fin de sa vie, il possédait non seulement à un degré rare toutes les notions relatives à la science à laquelle il s’était spécialement voué, mais encore il avait retenu les plus beaux morceaux des maîtres de notre littérature. Il savait Racine et Molière à peu près par cœur, comme il connaissait d’une manière approfondie Adam Smith, J.-B. Say et Ricardo. Sa mémoire était une bibliothèque où les poètes et les orateurs avaient leur place, à côté des économistes et où il trouvait, avec de nombreux et solides matériaux pour ses travaux scientifiques, des modèles dont l’influence s’aperçoit dans l’élégante et facile correction de sa diction et de son style.
Ses études terminées, il suivit les cours de la faculté de droit de Paris et se fit recevoir licencié. Il se destinait au barreau. « Un organe sonore, une élocution facile et claire lui promettaient du succès, une carrière sûre et une existence aisée. Mais Coquelin avait des défauts et des qualités qui devaient lui rendre antipathique l’exercice de la profession d’avocat. Ses défauts consistaient dans l’absence de toute préoccupation relative à ses intérêts personnels et dans une fâcheuse imprévoyance de l’avenir ; ses qualités étaient une probité ombrageuse et un sentiment inné du devoir que le moindre sophisme exaspérait. Il aurait passé sa vie à refuser des dossiers. Ajoutons encore qu’il avait le goût des idées bien plus que le goût des affaires. »
C’est cependant par une affaire, qui avait du reste de la valeur et qui pouvait avoir du succès, qu’il débuta. Il fondait, en 1827, avec quelques jeunes avocats, une feuille intitulée :
ANNALES DU COMMERCE
Journal de jurisprudence commerciale, changes et opérations de commerce, arts, industrie, spectacles et littérature.
À côté du compte rendu des affaires judiciaire présentant un intérêt pour les industriels, les commerçants, les banquiers, ce journal fournissait des nouvelles maritimes, des renseignements sur le mouvement des ports, sur les bourses étrangères, les changes, le cours des matières d’or et d’argent. Dans une partie littéraire figuraient les comptes rendus des pièces de théâtre, des informations diverses et aussi des propos satiriques dans la rédaction desquels les jeunes collaborateurs exerçaient leur verve irrévérencieuse.
Le journal était quotidien. Le premier n° est du 16 décembre 1827. Le 15 août 1828 le titre est modifié de cette façon :
ANNALES DU COMMERCE
Arrivages maritimes. Mercuriales. Prix-courants.
Affiches judiciaires. Annonces et avis divers.
La partie juridique et les articles sont supprimés. Le 17 août, une note annonce que « jusqu’au moment où nous aurons déposé le cautionnement exigé par la loi du 18 juillet dernier », le journal publiera tous les jours une feuille d’annonces et les lundis et jeudis les avis du commerce. Il ne paraît plus que sur une demi-feuille. Le dernier numéro est du lundi 18 septembre 1828.
Le journal ne porte aucune signature, ni de directeur, ni de rédacteur, ni de gérant. Le seul nom est celui de l’imprimeur et le journal change souvent d’imprimerie. Au début, il porte l’adresse de J.-L. Bellemain, rue Saint-Denis, 268 ; puis celle de Trouvé, rue Notre-Dame des Victoires, 16 ; le 1er avril 1828 il passe chez Carpentier-Méricourt, rue Traînée, 15, près Saint-Eustache ; le 27 avril, chez Coniam, Faubourg-Mont-martre, 4 ; le 24 juillet, il retourne chez Carpentier-Méricourt[7].
L’anonymat complet de cette publication ne permet pas de discerner quelle fut, dans sa direction et sa rédaction, la part de Coquelin. Nous ne saurions même pas — la notice de M. de Molinari ne donnant pas le titre du journal — si le journal de Coquelin était bien celui qui nous occupe, si, en feuilletant la collection, nous n’avions trouvé, en mars 1828, une série de cinq articles intitulés : « Aux capitalistes ». L’auteur y soutient que la Banque rend service aux négociants, mais n’en rend aucun à la masse des commerçants. « Les capitaux seuls et trois signatures qui les représentent y ont accès. » Il plaide la cause de la liberté des banques. Il insiste sur la nécessité de préparer au commerce des ressources nouvelles et il réclame l’institution de banques particulières, comme en Hollande et en Angleterre, pouvant émettre du papier-monnaie de 150 et même 250 francs dont la circulation est si vivement désirée par le commerce.
Aucun doute n’est possible. Les articles sont de Coquelin. À son début, il soutient la théorie qu’il devait défendre en toute circonstance, qu’il a défendue vingt-cinq ans plus tard dans son dernier ouvrage et à laquelle il projetait encore de consacrer de nouveaux efforts, lorsque la mort le prit.
La disparition du journal fut brusque. Rien n’indique dans le dernier n° que la publication est arrêtée. Cette cessation fut sans doute la conséquence d’une administration imprévoyante et des difficultés que Coquelin éprouva, par suite de l’abandon successif de ses associés qui le laissaient seul aux prises avec les embarras d’une entreprise qui tournait à mal.
Après cette tentative malheureuse, Charles Coquelin revint à Dunkerque. Sur les instances de sa famille et malgré ses répugnances, il se fit inscrire au barreau et il plaida plusieurs fois avec succès. Mais ce ne fut qu’une phase bien courte de sa carrière. Paris l’attirait et il ne renonçait pas à l’intention de s’y adonner aux travaux scientifiques et littéraires. Il avait pour les questions économiques une prédilection que ses premiers écrits nous ont déjà révélée, et M. de Molinari a raconté comment son esprit et ses études s’étaient, de bonne heure, dirigés vers elles. Naturellement porté vers la liberté du commerce, il avait de fréquents entretiens avec un négociant de Dunkerque, ami de sa famille et protectionniste déterminé. Pour soutenir la discussion, Coquelin sentit le besoin de creuser à fond les doctrines vers lesquelles sa raison l’avait guidé et il se mit à étudier et à annoter les ouvrages de J.-B. Say, de Destutt de Tracy, du comte d’Hauterive, de Mac-Culloch, etc. Ricardo ne lui tomba sous la main que plus tard ; mais, chose curieuse et dont toutefois l’histoire des sciences offre plus d’un exemple, Coquelin avait trouvé, de son côté, l’ingénieuse théorie de la rente, qui est un des principaux titres de gloire de l’illustre économiste anglais. Il racontait plus tard à ses amis combien il avait été surpris, et jusqu’à un certain point contrarié, de trouver dans les œuvres de Ricardo ce qu’il croyait être sa découverte. Cet incident de ses premières études d’économie politique explique l’ardeur avec laquelle il défendit la théorie de la rente, lorsqu’elle eut été remise en question par Carey et par Bastiat. C’est que Charles Coquelin considérait un peu la théorie de Ricardo comme sienne.
Coquelin ne se bornait pas à l’étude des maîtres qui défendaient les doctrines auxquelles il était lui-même attaché. Il ne négligeait pas de prendre connaissance des travaux de leurs adversaires. Un des plus notables champions du régime prohibitif, Ferrier, était son compatriote. La lecture de ses ouvrages n’avait pas ébranlé les convictions de Coquelin. Mais les prohibitionnistes affectant d’invoquer les faits de la pratique pour les opposer aux théories scientifiques — méthode à laquelle les protectionnistes actuels, n’ont, du reste, pas renoncé — Coquelin jugea important d’aborder résolument le terrain des faits afin de montrer qu’ils concordaient avec les principes et de mieux réfuter ainsi l’opinion adverse. Il se mit à étudier la situation des principales branches de la production nationale et il puisa dans cette étude une forte préparation aux luttes auxquelles il prit plus tard une part très active, lors de la campagne en faveur de la liberté des échanges.
Il semble bien que ces travaux devaient tenir plus de place que la jurisprudence et le barreau dans les préoccupations de Coquelin. Ils ne contribuaient pas à réparer les brèches faites à sa bourse par les Annales du Commerce. Mais il amassait des matériaux. Quand il se crut suffisamment armé, il revint à Paris avec l’intention de demander à sa plume ses moyens d’existence.
Un des principaux journaux libéraux de l’époque était le Temps dont le directeur, Jacques Coste, avait été l’un des signataires de la protestation des journalistes contre les ordonnances du 25 juillet 1830[8]. En économiste politique, il défendait les saines doctrines et, en 1832, il publiait chaque semaine un compte rendu des leçons professées au Collège de France par J.-B. Say. Peut-être est-ce cette circonstance qui donna à Coquelin de proposer au Temps des articles sur des questions spéciales auxquelles ses études l’avaient préparé. En septembre 1832, il donne deux articles intitulés : « De la discussion sur le privilège de la Banque aux États-Unis ». Ils ne sont pas signés, mais la notice de M. de Molinari nous a permis de les retrouver.
Le premier est du 3 septembre. Le début porte bien la trace de la préoccupation constante de Coquelin : « La question des banques aux États-Unis est fort importante ; il n’y a pas de classe de la société à laquelle elle puisse être indifférence car, dans ce pays, la circulation de toutes les valeurs, de tous les produits, s’opère presque exclusivement par l’intermédiaire des bank-notes. Ce n’est pas comme en France où, à l’exception de deux ou trois villes qui possèdent des banques, tout notre système monétaire repose sur l’emploi des métaux précieux ; là, au contraire, l’or et l’argent ne jouent qu’un très faible rôle. »
Dans le second article, du 10 septembre, il constate le désordre dans les opérations des banques débarrassées du contrôle de la Banque des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, désordre tel qu’il a fallu rétablir le contrôle en 1816. Il expose le fonctionnement de ce contrôle sur les émissions des banques locales : « Un des principaux avantages, dit-il, que la Banque des États-Unis a procurés à l’industrie, c’est l’introduction d’un papier de crédit uniforme dans toutes les parties de l’Union ; c’est encore la diminution considérable qu’elle a provoquée dans le change ». Il conclut ainsi : « La Banque des États-Unis nous paraît être une des plus belles institutions de crédit qui existent actuellement… Nous terminerons par un fait qui montrera d’une manière concluante la nécessité de renforcer cette institution pour augmenter la solidité de la circulation aux États-Unis. Depuis le 1er janvier 1811 jusqu’au 1er juillet 1830, 165 banques locales ont manqué ; leur capital peut être évalué à trente millions de dollars ; c’est le cinquième actuel de toutes les banques de l’Union. »
Au même moment, une de ces enquêtes, qui sont dans les traditions britanniques et sur la méthode desquelles Bastiat demandait, en 1848, des renseignements à Cobden, était ouverte sur la situation de la Banque d’Angleterre. De secrète qu’elle avait été tout d’abord, cette enquête n’avait pas tardé à devenir publique. Les documents de la commission avaient été publiés, ce dont Coquelin la félicitait dans le premier des articles qu’il consacrait à cette question de la Banque d’Angleterre[9]. Comme conclusion de cette étude, il pose en fait que le privilège de la Banque d’Angleterre a eu une influence funeste sur tout le système de crédit de l’Angleterre. Parmi les plans de réforme qui ont été examinés par le comité d’enquête, le premier a été le régime de la liberté absolue. Il a été repoussé par tous les banquiers de Londres. Coquelin fait remarquer que ce système a été contraire à leurs intérêts. Il reconnaît cependant qu’il aurait eu des inconvénients dont l’un eût été « la multiplicité et la confusion des monnaies de crédit ». Un autre système qui lui paraît préférable consiste à remplacer toutes les banknotes des banques de province par celles de la Banque d’Angleterre et à réunir en un seul trésor toutes les espèces que les banques provinciales sont obligées de garder en réserve pour les besoins de leur circulation. Il estime que ce système aurait pour avantage l’unité du papier-monnaie, l’économie réalisée en concentrant la réserve destinée à satisfaire toutes les demandes d’espèces, la facilité de maintenir cette réserve à un certain niveau, la possibilité de régulariser les émissions de papier et la diminution des risques auxquels sont exposées toutes les banques en cas de panique.
Ces articles révélaient une étude attentive des questions et une connaissance approfondie du sujet. M. de Molinari dit qu’ils furent remarqués ; ils méritaient de l’être. Il ne semble pas cependant que Coquelin ait pris dans la rédaction du Temps une situation stable. En 1836, on le trouve au Monde que Lamennais venait de fonder avec Pistor. Celui-ci, dans son prospectus, faisait grief à la presse française de se placer à un point de vue exclusivement national, d’avoir « des tendances égoïstes » et il déclarait : « Les tendances du journal (le Monde) sont éminemment cosmopolites. » Ce programme pouvait plaire à Coquelin, aux yeux duquel les questions d’échange et de crédit étaient des questions d’ordre général, embrassant les hommes par-dessus les frontières. En novembre et décembre 1836, le Monde publie sur la crise commerciale et les affaires de banque des articles anonymes auxquels on peut attribuer la paternité de Coquelin. Mais le Monde eut une courte existence et, de cette période, ce qu’il y a peut-être surtout à relever, ce sont les piquants détails rapportés par M. de Molinari des rapports de Coquelin avec Lamennais. Des discussions presque quotidiennes s’engageaient entre eux sur les questions économiques. « Comme la plupart de ses coreligionnaires politiques, M. de Lamennais se méfiait de la liberté du travail et il était assez disposé à voir dans la concurrence un moyen « d’exploitation de l’homme par l’homme ». Mais, d’un autre côté, M. de Lamennais se laissait influencer aisément par une conviction énergique et chaleureusement exprimée. Les plaidoyers de son jeune collaborateur en faveur de la liberté économiques firent une vive impression sur lui, et l’on pourrait retrouver la trace de cette influence salutaire dans les admonestations véhémentes que l’ancien directeur du Monde adressait plus tard aux socialistes. »
La publication du Monde cesse[10] et nous perdons pour quelque temps les traces de Coquelin. Le 25 janvier 1839, le Droit donne sous ce titre :
Sciences morales.
Économistes français.
Quesnay.
un article signé Ch. C. Coquelin y étudie les doctrines des physiocrates. « Le plus beau titre de gloire de cette secte, dit-il, c’est la direction toute nouvelle qu’elle a imprimée aux travaux économiques ; c’est par là qu’il faut l’envisager. » Il observe que Quesnay a renversé les anciennes idées en montrant que l’or et l’argent ne sont que des moyens d’échange et que la richesse consiste dans les biens réels qui se consomment. En faisant de la terre l’unique source de richesse et des travaux agricoles les seuls travaux productifs, il s’est trompé et il a eu une vue étroite. Erreur féconde cependant, car elle a préparé les voies à Turgot, le « disciple émancipé » de Quesnay. « C’est à tort que, sur la foi de M. J.-B. Say, on se représente communément le docteur Quesnay comme un philosophe rêveur dont la doctrine n’a fait que passer sans laisser de traces de son passage… Il ne restera pas sans gloire, le nom de celui qui, outre d’utiles mesures administratives, a provoqué toute une série d’études et communiqué aux esprits un salutaire ébranlement. » S’il refuse à Quesnay le titre de fondateur de l’économie politique, il reconnaît cependant en lui le précurseur d’Adam Smith[11].
Coquelin avait sans doute projeté de donner au Droit une série d’études sur les principaux économistes. C’est ce que semble indiquer le titre de son article du 2 mai 1839 :
Économistes français.
II
Turgot.
Il note tout d’abord que si Turgot n’a pas, comme économiste, toute la réputation qu’il mérite, c’est que ses doctrines ne sont pas réunies en un corps d’ouvrage, que ses pensées sont éparses et que ses travaux ont été trop vite éclipsés ou absorbés par ceux d’Adam Smith. « Il n’en est pas moins vrai qu’on peut ranger Turgot parmi les hommes qui ont activement contribué aux progrès de la science ; il était, à coup sûr, avant Smith, l’économiste le plus avancé de son temps. » Il revendique pour lui, contre J.-B. Say qui l’attribue à Smith, l’honneur d’avoir, le premier, déterminé les fonctions de la monnaie dans la société. Les Réflexions sur la formation et la distribution des richesses sont de neuf ans antérieures à l’ouvrage de Smith. L’influence de Quesnay se fait sentir dans « ce qui est relatif à ce malheureux produit net des terres, à cette malheureuse distinction de classe productive et de classe stérile. » Sauf sur ce point, « on n’y trouve qu’une suite d’observations aussi justes que profondes ». Coquelin regrette cependant que l’ouvrage présente beaucoup de lacunes et notamment qu’après avoir expliqué la fonction de la monnaie et la nature du prêt à intérêt, « il ne dise pas un mot du crédit, des billets, des banques, qui trouvaient là si naturellement leur place. »
Le second article, du 25 mai, résume le rôle de Turgot comme intendant de la généralité de Limoges qui, sous son administration, changea de face et s’enrichit à vue d’œil. Coquelin annonçait l’intention d’étudier dans d’autres articles l’œuvre de Turgot en ce qui concerne la liberté du commerce des grains : « Ce qu’il a fait à ce sujet mérite, dit-il, une attention particulière. » Il se proposait aussi de retracer son œuvre pour le rétablissement des finances de l’État. Un changement dans la direction du journal vint déranger ses projets et l’étude est restée inachevée.
À ce moment, étant entré en relations avec François Buloz, Coquelin publia dans la Revue des Deux-Mondes une étude en deux articles[12] sur l’industrie linière en France et en Angleterre. Les procédés mécaniques imaginés par Philippe de Girard avaient été repris en Angleterre ; l’importation des fils anglais faisait en France une concurrence d’autant plus redoutable au filage à la main et aux essais de filature mécanique que le lin et le chanvre étrangers étaient frappés de droits élevés, afin de protéger la culture française et que les fils anglais n’étaient grevés que de droits assez faibles, étant considérés comme matière première pour les tissages. Une enquête avait été faite en 1838 sur la situation de l’industrie linière et la commission avait recueilli les doléances unanimes des filateurs, au premier rang desquels était Feray (d’Essonnes). C’était un ordre initial de considérations qui rendaient « actuelle » l’étude de la question.
Elle présentait encore un autre intérêt. Pendant longtemps l’Angleterre s’était réservé un monopole de fabrication en interdisant l’exportation des machines. En 1834, un ingénieur français, Decoster, était allé en Angleterre, emportant une peigneuse Philippe de Girard à laquelle il avait fait subir diverses modifications et projetant d’enlever aux Anglais le système entier de leurs mécaniques. Il s’était fixé à Leeds, centre de la construction et de la filature ; il était parvenu à tout voir, à tout étudier, à comparer les appareils. De retour en France, il avait, à la fin de 1835, formé à Paris un premier atelier de construction et dès 1838 « l’œuvre de la transplantation en France de l’industrie nouvelle, cette œuvre délicate et pénible serait entièrement consommée ». La filature mécanique appartient désormais à la France, s’écrie Coquelin, et il estime que les conséquences de cette conquête seront incomparablement plus importantes que celles de l’industrie cotonnière. Sans doute, le filage à la main, déjà ébranlé par l’importation anglaise, sera frappé et Coquelin regrette la modification des mœurs familiales que sa disparition déterminera. Mais il faut que notre filature mécanique « reprenne à la filature anglaise notre marché envahi. »
Nous notons intentionnellement cette phrase parce qu’elle n’est pas un lapsus sous la plume de Coquelin. Certes, il fait, dans sa conclusion, une profession de foi libre-échangiste : « C’est, dit-il, un grand et beau principe que celui de la liberté commerciale et nous espérons bien le voir triompher un jour. » Mais à bien des reprises, il proteste contre « l’invasion funeste des produits anglais ». Il emprunte aux Ferrier et aux Saint-Chamans le langage qui allait, quelques années plus tard, exciter les colères de Bastiat.
Celui-ci, dès son entrée dans la lice, devait montrer que le système protectionniste aboutissait à faire deux catégories des industries, les unes privilégiées, les autres sacrifiées, et se plaçant au point de vue de l’intérêt général et surtout de l’intérêt du consommateur, sa conclusion devait être : l’égalité dans et par la liberté. Coquelin, se plaçant au point de vue d’une industrie spéciale, arrive à une conclusion différence puisqu’il réclame pour la filature une protection modérée. « La position n’est pas tenable », dit-il ; et il faut reconnaître que la douane faisait de son mieux pour qu’il en fût ainsi. Le tarif frappait à l’importation les fils d’étoupe d’un droit de 14 francs et les fils de lin d’un droit de 24 francs les 100 kilogrammes. Mais les perfectionnements de fabrication ne permettant plus de distinguer les catégories, la douane avait imaginé une autre classification « et ce n’est pas à l’avantage de nos filateurs ». Au lieu de percevoir 24 francs sur tous les fils, tous ayant acquis la valeur supérieure des fils de lin, elle perçoit 14 francs jusqu’au n°30 anglais, c’est-à-dire sur les qualités communes de l’usage le plus général et les qualités plus hautes paient 24 francs ; le prix du fil augmentant à mesure que le numéro s’élève, le droit de 14 francs ressort pour les numéros les plus bas à 5 ou 6% et pour les numéros plus élevés à 2,5%. Le rapport est à peu près le même, avec le droit de 24 francs pour les n°30 à 60 ; au-dessus de celui-ci, la proportion diminue et si l’on passe le n°100, le droit devient insignifiant.
Et Coquelin ajoute, pour justifier sa demande de protection : « Il s’agit de savoir si, dans un état de choses où tout se règle par la protection, où tout se place à son niveau, il est permis de choisir une industrie entre mille pour la livrer seule à toutes les chances d’un régime particulier ; si, lorsque la valeur de toutes les matières premières et de tous les agents du travail est altérée et grossie par le système en vigueur, il est permis de parler de liberté commerciale de nos manufactures. Ainsi entendue, la liberté ne serait qu’une fiction désastreuse et une cruelle ironie. »
Cette étude eut, paraît-il, un grand retentissement. Non seulement les deux numéros de la Revue des Deux-Mondes furent épuisés mais Coquelin fut vivement pressé de réimprimer son travail. Il le fit l’année suivante[13] et il s’excuse, dans sa préface, de ce retard, par ce motif qu’il avait un projet plus vaste, celui de « traiter la matière ex professo dans un grand ouvrage accompagné de planches dont il poursuit la préparation avec le concours de M. Decoster. »
Dans ce volume, la reproduction des articles de la Revue des Deux-Mondes est suivie d’une longue lettre, datée de Varsovie, le 20 septembre 1839, de Philippe de Girard. « Je vous remercie, dit-il, pour l’honorable part que vous m’avez réservée dans la création de cette industrie et pour les éloges trop flatteurs que vous avez bien voulu m’accorder. » Mais il s’attache à prouver « que les filateurs anglais n’ont pas plus perfectionné les procédés actuels de la filature du lin qu’ils ne les ont inventés » et il veut « rendre tout entier à la France l’honneur de cette création. » Le volume se complète par des considérations techniques sur les opérations d’une filature.
L’ouvrage spécial dont Coquelin annonçait la publication ultérieure ne parut qu’en 1846[14]. Coquelin dit dans la préface : « La lenteur avec laquelle le premier éditeur poursuivit la confection des planches et le retard extraordinaire qui en résulta nous déterminèrent à renoncer à cette publication après trois ans d’attente. Nous l’avons reprise quand un autre éditeur s’en est chargé… Nous livrons aujourd’hui au public l’ouvrage corrigé, émondé et enrichi des nouvelles observations que nous avons faites depuis cinq ans. » C’est un traité purement technique où sont étudiées la culture du lin et du chanvre, décrites les machines et les opérations de filature et de tissage.
À la suite de ces travaux qui montrent qu’il avait fait une étude très approfondie de tout ce qui se rattache à l’industrie linière, Coquelin fut chargé par M. Decoster de diverses missions d’organisation et de surveillance ; il se rendit à Bayonne, en Auvergne, en Normandie, pour aider à la fondation de filatures nouvelles. Il fut même, paraît-il, sur le point de s’associer dans une de ces entreprises. L’affaire ne se conclut pas et Coquelin renonça à ses velléités industrielles pour se consacrer exclusivement à l’économie politique.
C’est dans le numéro du 1er septembre 1842 que la Revue des Deux-Mondes publie son article : Du crédit et des banques dans l’industrie où il revient sur la question qu’il avait déjà traitée dans les Annales du Commerce. Sur beaucoup de points, le volume : Le crédit et les banques qu’il publia en 1848 est la reproduction de cet article. Nous ne nous y arrêterons en ce moment que pour noter que Coquelin, parlant du privilège de la Banque de France renouvelé en 1840, tout en regrettant que le système de la liberté n’ait pas prévalu, « ce qui n’était guère à espérer », s’étonne qu’on n’ait même pas songé à étendre le privilège et que les choses aient été « maintenues dans l’état misérable où elles étaient auparavant ». Il demande, non pas l’abolition du privilège, mais des mesures qui facilitent l’établissement des banques dans les départements. Quant aux banques existantes, il estime nécessaire de favoriser, au lieu de les défendre, les relations qu’elles peuvent former entre elles, de les autoriser à recevoir des dépôts à intérêts de 2 000 francs au minimum, de leur permettre, en conséquence, d’ouvrir des crédits à découvert dans une certaine limite ; enfin « d’abaisser le minimum des coupons de billets, non pas au taux de 250 francs comme l’a proposé la Banque de France, non pas même au taux de 125 francs comme en Angleterre, mais au taux de 25 francs comme en Écosse.
Son article sur les sociétés commerciales en France et en Angleterre (1er août 1843) est, au témoignage de M. de Molinari, un de ses titres de gloire. Dégagé des timidités de ses premières œuvres, en pleine possession des questions sur lesquelles il a longuement médité, il ose regarder la liberté en face et en proclamer sans hésitation la supériorité sur tous les systèmes de restriction. En même temps que la pensée s’élève, la forme littéraire devient plus belle et atteint une véritable éloquence lorsque, parlant « des écoles philosophiques qui ont la prétention de conduire l’humanité, par l’association, à des destinées inconnues », il montre que ce que voulaient ces réformateurs, « c’était une société une, avec un seul centre et un seul chef ; une société universelle par son étendue, universelle par son objet, où l’individualité humaine disparût dans le courant de l’action sociale, qui n’eût qu’une seule âme, un seul mobile ; où l’homme ne connût aussi qu’un seul lien ; mais un lien tel qu’il l’étreignît, pour ainsi dire tout entier… L’homme est un être sociable, dit-on, et sur ce fondement on veut qu’il s’absorbe tout entier dans une société unique, comme si ce penchant social qu’on lui attribue ne pouvait s’exercer que là. Oui, l’homme est un être sociable ; il l’est plus que nul être sensible ; c’est là son attribut le plus distinctif et son plus noble apanage. Mais, avec le sentiment de la sociabilité, il nourrit en lui un besoin impérieux de liberté et une entière spontanéité dans ses rapports. C’est d’ailleurs un être mobile et divers autant que sociable, et il se porte d’instinct sur un état de société mobile et divers comme sa nature elle-même. Au lieu donc de se lier une fois pour toutes, dans une société unique, par une chaîne lourde qui entraverait la liberté de ses allures, il doit se lier plutôt par des milliers de fils légers qui, en l’attachant de toutes parts, à ses semblables, respectent pourtant le jeu de sa nature mobile. Voilà ce que la raison commande ; là est le progrès. »
De ces considérations auxquelles le cours des années n’a rien enlevé de leur force ni de leur opportunité, Coquelin passe à l’étude de l’association qui, « appliquée avec mesure et dans les limites des spécialités qui la comportent, est un levier d’une grande puissance. » Dans l’industrie et le commerce, de combien d’heureuses applications n’est-elle pas susceptible ? Par elle, il n’est point d’entreprises inabordables à l’homme, point de travaux gigantesques qu’il ne puisse exécuter. En Angleterre, aux États-Unis, des associations se sont formées pour les objets les plus divers. Mais en France le principe de l’association n’a jamais été appliqué largement. Soit avant, soit depuis la Révolution, on n’y trouve guère qu’un certain nombre de ces sociétés chétives que le niveau commun atteint, peu ou point de ces puissants concours de capitaux ou d’hommes qui mettent le commerce d’un pays à la hauteur des grandes entreprises. Coquelin n’hésite pas à déclarer : « La cause du mal est toute dans la loi qui régit nos sociétés. »
Cette loi est celle de 1807 qui, en effet, s’était beaucoup plus préoccupée de gêner les sociétés dans leur formation et leur action que de les aider. Elle n’avait pas prévu — et qui l’aurait pu alors ? — le développement de la richesse mobilière et les transformations économiques accomplies durant la première moitié du XIXe siècle. À peine avait-elle soupçonné la société anonyme, dont Coquelin pouvait dire avec raison qu’elle « est la véritable association de notre temps, celle que les besoins actuels de l’industrie réclament et à qui l’avenir appartient », celle dans laquelle « la base de l’association peut s’élargir à volonté, la seule qui soit à la hauteur de toutes les conceptions industrielles ». Si l’association était libre, l’industrie privée, qui s’ingénie sans cesse pour accroître ses moyens et utiliser ses ressources, n’eût pas manqué de la soumettre à de nouvelles combinaisons qui en eussent singulièrement fécondé le principe.
En Angleterre, une société est formée et constituée aussitôt que les parties contractantes sont d’accord. Leur consentement mutuel, de quelque manière qu’il soit exprimé, suffit. Établies sans formalités et sans frais, elles se constatent aussi par des procédés fort simples et les mêmes facilités se retrouvent en ce qui concerne la division du capital en actions.
En France, au contraire, le législateur a arrêté le développement et contrarié les lois de l’association par l’abus de la réglementation. Il a marqué la défiance que lui inspirent toujours les institutions nouvelles. Régulièrement il les étouffe sous le poids des garanties qu’il leur impose. « Tel a été le sort de ces admirables institutions de banque, merveilles commerciales des temps modernes. Tel est encore celui des sociétés anonymes. » Coquelin s’attache à montrer que « les raisons alléguées pour justifier leur asservissement ne soutiennent pas l’examen » et que les sociétés anonymes « offrent aux tiers qui traitent avec elles des garanties incomparablement plus fortes que nulle maison particulière ou nulle autre espèce de société… Elles n’ont été jugées que sous l’influence d’un préjugé funeste. La nouveauté de l’institution, voilà son crime. » Aussi Coquelin donne-t-il ce conseil ironique : « Rendez la vieille s’il se peut ; faites surtout qu’elle soit trop vieille pour le siècle, si tant est qu’elle puisse jamais l’être et toutes les susceptibilités qu’elle éveille se calmeront ; tous les préjugés que l’on suscite contre elle se dissiperont et ceux mêmes qui la tiennent aujourd’hui dans un état de suspicion légale ne sauront plus qu’exalter les garanties qu’elle offre et vanter ses bienfaits ».
Depuis que ces lignes ont été écrites, la société anonyme a grandi ; quelques-uns des obstacles qui gênaient son essor ont été supprimés ou diminués, sous l’influence peut-être des idées répandues par Coquelin. Nous sommes loin cependant encore de la large liberté dont il préconisait le mérite. Nous ne sommes guéris ni de la manie de légiférer ni de la passion de réglementer. Chaque jour en fournit une preuve nouvelle.
II. La liberté du commerce. — Les systèmes de douane. — Les douanes et les finances. — Au Journal des Économistes. — L’organisation du travail. — Les associations ouvrières. — La question monétaire.
Le succès qu’avaient obtenu les premiers articles de Coquelin incitait Buloz à lui en demander d’autres. Lui-même, ayant renoncé à ses projets industriels, qui ne l’avaient cependant pas détourné complètement de ses études économiques, voyait avec satisfaction s’ouvrir devant lui de plus larges débouchés et, à partir de 1845, sa collaboration à la Revue des Deux-Mondes devint plus active. Malgré la facilité de travail dont il était doué, les sujets sur lesquels se portaient ses études exigeaient une préparation laborieuse. Il ne se résignait pas à « manufacturer des articles ». Aussi la liste de ceux qu’il publia dans ce recueil est-elle assez courte[15].
Nous ne saurions cependant les analyser tous. Mais il est deux séries qu’un homme moins insouciant, moins négligent de ses intérêts, et même de sa notoriété, que Coquelin eût réunies en un volume : c’est, d’une part, celle que forment les cinq articles sur la liberté du commerce et les systèmes de douanes et, d’autre part, celle des trois articles intitulés : « Les douanes et les finances de la France ; de l’accroissement possible des recettes et de la révision des tarifs. »
Au moment où paraît le premier de ces articles, l’Association pour la liberté des échanges vient de publier sa célèbre Déclaration. L’obstination de Bastiat a triomphé des résistances de ceux qui hésitent à se placer sur le terrain du « principe absolu ». Avec moins de fièvre et d’entraînement que Bastiat, Coquelin apporte à l’œuvre de liberté un concours efficace. Pour répondre aux ouvrages dans lesquels son compatriote Ferrier n’a cessé de soutenir que, sans protection douanière, l’industrie française ne peut vivre, Coquelin, mettant à profit à la fois ses études économiques et les connaissances pratiques acquises au cours de ses tournées industrielles, entreprend une sorte d’enquête générale sur la situation des diverses branches de l’industrie française ; il recherche ce qu’elle gagne au système protecteur et ce que le système protecteur lui coûte. Sans se faire d’illusions sur l’efficacité immédiate de ses efforts, car il est peu d’industriels qui ne soient convaincus que leur existence dépend de la conservation des tarifs qui les protègent, il montre aux partisans éclairés de la liberté du commerce qu’ils ont une belle tâche à remplir : celle de préparer les voies à l’établissement de ce régime nouveau. Il proclame dès le début qu’il n’appartient pas à cette école éclectique ou mixte qui, prétendant faire la part des deux systèmes, admet les restrictions pour le présent, la liberté pour l’avenir, école bâtarde qui déguise mal, sous une apparence de conciliation et de sagesse, le vide réel de ses doctrines. Il pose en principe que « la liberté du commerce n’est que le mouvement naturel, le cours régulier des transactions ; c’est l’absence de règlements arbitraires, de mesures violentes, de restrictions injustifiées. » Quant au système restrictif, violateur du droit, il est en même temps destructeur de la richesse publique : en d’autres termes, il est contraire aux intérêts qu’il prétend servir. Il entreprend de démontrer que « les industries souffrent du régime présent bien plus qu’elles n’en profitent. Le système restrictif leur assure le marché national, il est vrai. Mais à quel prix ? Il leur vend sa protection beaucoup plus qu’il ne la donne et il la vend assurément trop cher. »
Tandis que l’Association, dans sa Déclaration, s’est placée au point de vue de « l’intérêt général qui se confond partout et sous tous les aspects avec celui du public consommateur », Coquelin se place donc au point de vue spécial de l’intérêt des producteurs qui est l’autre face de la question et, non pas par des considérations générales et par des artifices de rhétorique, mais par des chiffres, par des faits probants, par l’examen même de la situation des principales industries, il établit qu’aussi bien la métallurgie que l’agriculture, les producteurs de houille ou de minerais, toutes les industries, les unes à la suite des autres subissent les conséquences du protectionnisme, bien loin d’en retirer aucun avantage. Devant cette démonstration irréfutable, le fameux thème du travail national tombait à plat.
Dans la seconde série : Les douanes et les finances de la France, publiée en mai-juin 1848, il prend pour point de départ qu’il n’y a pas de mesure plus urgente que la réforme des tarifs douaniers. Améliorer la condition des classes ouvrières en leur procurant ce qui est le principe de tout bien-être : la vie à bon marché ; favoriser le travail national en lui faisant obtenir à un prix moins élevé les matières premières qu’il met en œuvre ; augmenter du même coup les revenus de la douane en ouvrant un accès plus facile à ceux des produits étrangers que repoussent les prohibitions absolues ou les droits prohibitifs, tels sont les résultats qu’il attend de la révision des tarifs.
Tout d’abord il réclame la suppression des droits à l’exportation. C’est un sacrifice de moins de deux millions qui sera compensé par un grand soulagement pour le commerce et aussi pour le service des douanes. Il demande aussi la simplification du tarif, « toile d’araignée à fortes mailles où notre commerce est, de toutes part, enveloppé ». Ceci fait, et pour l’établissement du tarif nouveau, il établit une distinction entre les produits naturels et les produits ouvrés. Pour les premiers, la concurrence intérieure est le plus souvent bornée, soit à cause de l’insuffisance de la production, soit en raison du petit nombre des exploitants. Si la concurrence étrangère n’intervient pas, il se constitue un monopole à l’intérieur et c’est ce qui se remarque notamment pour les denrées agricoles et pour les produits des mines.
La situation est différente en ce qui concerne les produits fabriqués. La production intérieure n’a pas de limite fixe. La concurrence est indéfinie et, même si elle ne s’exerce qu’à l’intérieur, sans l’afflux des produits étrangers, elle suffit pour écarter le danger du monopole.
Donc Coquelin propose de réduire tout d’abord, dans une large mesure, les droits qui frappent les produits naturels à l’importation, ce qui aura pour conséquence la vie à bon marché, mais entraînera une moins-value dans le rendement de la douane. Cette moins-value sera compensée et au-delà par les ressources nouvelles que procurera au Trésor la conversion en droits modérés de la prohibition absolue ou des droits prohibitifs qui repoussent les produits fabriqués étrangers. « C’est une source de revenus où l’on peut puiser sans crainte ni scrupule, dit-il. Personne n’en souffrira. »
Après un examen très détaillé du tarif, qui montre combien ces questions lui étaient familières, Coquelin établit qu’en remplaçant les prohibitions ou les droits exagérés par des droits fiscaux variant de 15 à 25% sur les fabrications étrangères, cette première partie de la réforme, toute compensation faite, donne un supplément de recettes d’environ 6 800 000 francs.
Mais il reste les produits exotiques qui n’ont pas de similaires dans le pays. Ce sont ceux qui offrent aux recettes les meilleures chances d’augmentation, les seuls qui soient susceptibles de procurer un large revenu et que l’on puisse taxer impunément. Encore faut-il tenir compte de cette circonstance que certains de ces produits, tels que les bois, sont des matières premières pour l’industrie et c’est, en dernière analyse, aux denrées coloniales que Coquelin s’attache, non pas pour les surtaxer, mais pour les grever de droits qui tout en étant assez élevés, permettent un accroissement de la consommation en France, qui « a été jusqu’à présent limitée par la loi ».
À l’égard de ces denrées, on a le choix entre deux systèmes : ou de supprimer le tarif différentiel qui taxe inégalement les produits des colonies françaises et les provenances étrangères, ou de réduire graduellement les surtaxes afin de ménager les transitions. C’est pour le premier système que Coquelin se prononce sans hésiter et il calcule que l’application en procurera au Trésor une augmentation de rentes de 30 à 35 millions pour la première année, qui doublera en quatre ans. Par ce procédé, il voit les finances rétablies, les améliorations intérieures rendues possibles, « sans effort, sans crises, sans aucune perturbation fâcheuse, disons même sans qu’aucun intérêt existant ait à souffrir. »
Mais ces moyens de refaire les finances et d’améliorer le sort des classes laborieuses étaient trop modestes pour les grandes ambitions de la République de 1848. Frapper des impôts pour distribuer des subventions, multiplier les interventions de l’État, prodiguer les promesses et exciter les convoitises était la méthode alors en honneur. Nous n’avons que trop d’occasions de constater que malgré les déceptions et les avortements, au cours de soixante années, le nombre de ses partisans n’a pas diminué.
Les articles publiés par Coquelin dans la Revue des Deux-Mondes avaient révélé en lui des connaissances trop étendues, un jugement trop ferme pour que les économistes négligeassent de s’adjoindre un collaborateur aussi précieux lorsqu’ils entreprirent la campagne pour la liberté des échanges. Au comité de l’Association il se trouva en relations intimes avec Bastiat et avec tous ceux qu’animait l’amour des idées libérales. Il était naturel qu’ils l’associassent étroitement à leur œuvre et qu’ils lui fissent place parmi les collaborateurs du Journal des Économistes.
Il y débuta en 1847, par un travail sur « les lois de navigation en Angleterre, leurs dispositions essentielles, leurs modifications successives et leur état actuel »[16]. La question était à l’ordre du jour. Bastiat ne cessait, dans ses lettres, de presser Cobden de réclamer l’abrogation des derniers vestiges de l’Acte de Cromwell, abrogation dans laquelle il voyait un gage des intentions pacifiques de l’Angleterre et un acheminement vers le désarmement. Il est vraisemblable que Bastiat, avec son habitude de revenir sans cesse sur les idées qui le préoccupaient, ne réservait pas ce sujet pour sa seule correspondance avec Cobden, mais qu’il en parlait aussi à ceux qui vivaient dans sa familiarité et que c’est dans ces entretiens que Coquelin puisa au moins l’idée d’exposer au public français la législation britannique de navigation. Il compléta cette étude en 1850, lorsque cette législation eut été abrogée et ce premier travail a passé pour une grande partie dans l’article que Coquelin a écrit au mot : Acte de navigation du Dictionnaire de l’Économie politique.
On verra plus loin à la suite de quel incident Coquelin fut amené, à la dernière séance publique de la salle Montesquieu, le 15 mars 1848, à parler de l’organisation du travail. Il n’est pas sans intérêt de rapprocher cette éloquente improvisation des quelques pages qu’il consacre à cette question dans le Journal des Économistes du 1er avril. Elles paraissent avoir été écrites au sortir de la réunion, au moment où Coquelin était encore tout vibrant de l’enthousiasme et des applaudissements qui avaient salué sa déclaration. « L’organisation du travail, écrit-il, est une conception anti-sociale entée sur un principe faux. Ils ne connaissent pas la société qui les entoure, ils n’ont jamais étudié son organisation sévère et ses indestructibles lois, ceux qui osent la soumettre à ces combinaisons misérables. C’est un progrès en arrière qu’ils nous proposent. » À ce principe faux, il oppose hautement le « principe fécond du laissez-faire ». Le pouvoir qui dirige l’État a une fonction bien assez haute, bien assez lourde de « maintenir le règne de la justice et du droit ». Laissez faire à l’industrie, conclut-il, son œuvre ; laissez-là « progresser sans contrainte et s’ordonner elle-même… contentez-vous de faire régner dans son sein la justice, le droit. »
L’exposition de 1849 lui fournit le sujet d’une étude sur les machines. Son attention paraît s’être portée particulièrement sur le matériel de la filature du lin et il constate que les machines de ce genre sont en petit nombre et que, depuis 1844, il n’y a été fait ni addition, ni innovation importante. Ce n’est pas, à son avis, un symptôme de stérilité ; mais il y a un point de maturité où toute industrie s’arrête et au-delà duquel le progrès ne se manifeste plus que par des perfectionnements de détail.
La pénurie de machines-outils en France comparée à leur généralisation en Angleterre provoque de sa part des réflexions d’ordre général. Il remarque avec justesse qu’elles rendent les plus grands services à l’industrie, mais qu’elles ne peuvent être employées que lorsque l’industrie est elle-même développée. Si la France a été de beaucoup devancée par l’Angleterre, c’est que le fer, la fonte et la houille étant rares et chers en France, les ouvrages en fer, particulièrement les machines, n’ont pu s’y propager que lentement, tandis qu’en Angleterre, le bas prix de ces matières premières y a mis de bonne heure ces mêmes ouvrages à la portée de tous. Notre pays était, naturellement, dans une situation moins favorable que l’Angleterre ; « nos tarifs de douane, par l’exagération des droits qu’ils ont établis sur les fontes, sur les fers et sur les houilles, ont singulièrement aggravé le tort de la nature. »
Nous n’avons pu nous expliquer pour quelles raisons il ne signa pas son article du 15 mars 1850 sur les associations ouvrières et les associations en général et celui du 15 avril sur la situation de la Banque de France. Ce n’est certes pas à cause des critiques un peu vives qu’il adressait au rapport de Léon Faucher sur la proposition Nadaud, qu’il se retranchait derrière l’anonymat. La loyauté de son caractère interdit cette explication, laquelle ne s’appliquerait du reste pas à l’article sur la Banque. La signature a d’ailleurs été rétablie à la table triennale, 1847-1850.
Dans l’un comme dans l’autre, il revient sur les questions qu’il avait traitées avec le plus d’éclat dans la Revue des Deux-Mondes et il profite des circonstances pour insister de nouveau sur les avantages des solutions qu’il avait précédemment défendues, des réformes dont il avait été le promoteur et auxquelles son nom reste attaché.
On sait de quel engouement les associations ouvrières avaient été l’objet en 1848. Par son décret du 5 juillet 1848, l’Assemblée constituante avait ouvert un crédit de 3 millions de francs pour les subventionner. Mais la distribution de ces fonds avait subi de telles lenteurs qu’au début de 1850, il restait douze cent mille francs à verser aux sociétés à l’égard desquelles des engagements avaient été pris[17]. Une demande de crédit avait été présentée à l’Assemblée législative le 3 décembre 1849 par J.-B. Dumas, ministre de l’Agriculture et du Commerce. Lefebvre-Duraflé avait déposé son rapport le 4 février 1850 et la loi avait été votée le 9 février après un discours de Bastiat, dont ce fut le dernier acte parlementaire[18]. Dans ce discours, Bastiat disait : « Quant à moi, j’ai une foi entière dans le principe de l’association qui se confond avec la société elle-même, qui doit se développer avec elle ; mais je ne suis pas partisan des fonds accordés, aux dépens des contribuables, aux associations. »
Dans son article du 15 mars, Coquelin laisse voir une foi moins entière que celle de Bastiat sur le principe de l’association. Il croit cependant « qu’elle peut être la source de quelques avantages précieux, parce que, renonçant à s’imposer comme elle a eu quelquefois la prétention de le faire, elle ne se développe qu’avec et par la liberté ». Alors comme aujourd’hui, c’était le procédé qui était le moins en honneur. Le décret du 18 août 1848, qui avait admis les associations ouvrières à soumissionner certains travaux publics avait voulu étendre sur elles la protection de l’État et décidé qu’il convenait de fixer, non seulement le maximum des prix d’adjudication, mais aussi le maximum du rabais que les associations ouvrières pouvaient offrir. L’État se refusait ainsi à profiter de la concurrence des soumissionnaires, ce qui est imprévu de la part du consommateur. Mais les associations n’avaient pas eu davantage à se féliciter de cette mesure tutélaire et une note officielle relate qu’une association d’ouvriers paveurs qui prospérait et qui, dans une adjudication, avait obtenu deux lots, « en aurait obtenu deux autres si leurs soumissions n’avaient dépassé le maximum de rabais fixé pour eux par le préfet de la Seine ». La proposition Nadaud, dont Léon Faucher était le rapporteur, demandait quelques compléments au décret du 18 août. Coquelin s’élève contre cette tendance à créer en faveur des associations un régime exceptionnel. « Il semble, écrit-il, que personne en France ne veuille se rallier franchement aux principes du droit commun, non pas même ceux qui ne peuvent attendre que du droit commun leur délivrance. » Le succès de quelques associations ne lui paraît pas une garantie pour l’avenir, sans qu’il convienne de tirer des conclusions trop sévères de certaines difficultés dans lesquelles il faut « faire la part des vices flagrants de nos lois relatives aux sociétés commerciales. » Ce que l’État doit à toutes les sociétés, « c’est une législation simple, rationnelle et droite ». Tel est « l’encouragement peu coûteux, mais efficace » qu’il réclame de lui, comme il l’avait déjà réclamé en 1843 dans la Revue des Deux-Mondes.
Le rapport du gouverneur de la Banque de France sur les opérations de l’année 1849 lui fournit l’occasion de revenir, le 15 avril 1850, sur la question qui l’intéressait plus que toute autre. Il recherche les causes de ce qu’il appelle « la crise des escomptes ». Il recherche pourquoi la somme des escomptes continue à s’affaisser lorsque les ateliers ont repris leur activité, autant du moins que le leur a permis cette absence de crédit et il montre que cette situation prend sa source dans l’obligation des trois signatures. Les effets arrivent à la Banque par le canal des banquiers escompteurs dont beaucoup ont disparu dans la tourmente de 1848. Par le fait de leur disparition, les moyens matériels de présenter son papier à la Banque manquent au commerce. Pour détendre la situation, Coquelin estime que la Banque de France aurait dû demander l’autorisation d’escompter le papier à deux signatures présenté par les « maisons respectables » et réclamer la liberté du taux de l’intérêt.
L’occasion eût été favorable entre toutes pour relever le drapeau de la liberté et pour montrer, à la lumière des faits, que, mieux que tout régime de restriction, la liberté des banques aurait aidé la reprise du mouvement industriel et conjuré la « crise des escomptes ». On s’étonne de ne pas trouver dans l’article anonyme quelques développements sur ce point. Peut-être Coquelin a-t-il craint, s’il l’abordait, de déchirer le voile derrière lequel il se dissimulait. Précaution quelque peu illusoire ! l’allure générale de l’article ne permettait guère au lecteur un peu expérimenté de ne pas rétablir la signature.
De l’article qu’il publia le 15 août 1850 sur la prétendue décadence de la France et de l’Angleterre, à propos des ouvrages de Raudot et de Ledru-Rollin, il n’y aurait pas lieu de faire plus qu’une mention si, après avoir montré le parti pris de certaines critiques et l’insuffisance des informations sur lesquelles elles se fondaient, Coquelin ne s’élevait à de plus hautes considérations et à une défense de la liberté de la presse et de la parole qui, à près de soixante ans d’intervalle, n’a rien perdu de sa fraîcheur ni de son opportunité. « Les peuples qui jouissent, dit-il, d’un gouvernement représentatif et de la liberté de la presse, sont les seuls qui connaissent toutes leurs misères. La tribune publique et la presse sont deux yeux incessamment ouverts sur un pays, deux moniteurs incommodes, mais vigilants, qui en signalent toutes les tâches. De là vient que les peuples soumis au régime constitutionnel paraissent souvent plus mal partagés que les autres, lorsqu’en réalité leur condition est meilleure… Elles sont grandes, les misères que vous voyez : qui sait s’il n’y en a pas d’autres plus grandes que vous ne voyez pas ».
L’activité de la collaboration de Coquelin, l’étendue de ses connaissances qui lui permettait, ainsi qu’on a pu en juger par l’analyse que nous venons de faire de ses travaux, de traiter les diverses questions qui se rattachent à l’économie politique, la fermeté de ses principes et la sagacité de ses opinions lui avaient fait au Journal des Économistes une place éminente. S’il en fallait une preuve matérielle, nous la trouverions dans ce fait que ce fut lui qui écrivit « pour le comité de rédaction » l’Introduction à la 10ème année, publiée par la livraison du 15 janvier 1851. Passant en revue les faits économiques de l’année 1850, il s’attachait particulièrement à l’expérience faite en Angleterre du grand principe de la liberté en matière de navigation maritime. L’Acte de navigation, « qui a si longtemps étouffé dans l’empire britannique les développements de l’industrie maritime est enfin tombé, en 1840, sous un arrêt du Parlement et c’est en 1850 que le régime de la liberté absolue et générale a reçu sa première application ».
Il énumérait avec complaisance les manifestations de l’esprit libéral qui se produisaient en Hollande et en Suède ; il enregistrait la suppression des droits différentiels en Piémont ; il se montrait plein de confiance dans le prochain triomphe des idées libérales dans l’Amérique du Nord et dans d’autres pays encore. Il célébrait par avance le jour où « la liberté des mers et la franchise des ports deviendront la loi générale du monde civilisé. Qui sait ? ajoutait-il. Lorsque toutes les nations, l’une après l’autre, auront suivi ce noble exemple, peut-être que la France, elle qui se flatte souvent de marcher à la tête du monde civilisé, se décidera à faire comme elles. » Et il fortifiait son espoir en voyant un plus grand nombre d’hommes s’intéresser chaque jour aux matières économiques.
Dans ce même fascicule, il abordait, avec son article sur la dépréciation de l’or et le régime monétaire français, un ordre de questions qu’il n’avait pas encore traité. À ce moment, la production des mines d’or de Russie avait atteint un chiffre considérable, en même temps que la production des mines de Californie paraissait devoir s’élever à 300 millions par an. Sous l’influence de cette cause, un changement très sensible se produisit dans les rapports de valeur entre l’or et l’argent. L’or tendait à se déprécier. En Angleterre, où l’or est étalon monétaire unique, la perturbation se manifestait par un change très défavorable avec l’étranger. En France, où l’or et l’argent ont cours légal, suivant un rapport fixe, on constatait une émigration de l’argent et un afflux de l’or qui, fort rare auparavant, revenait avec abondance prendre dans la circulation la place de l’argent. Cette crise monétaire préoccupait les économistes. Coquelin, dans un article très nourri de faits, étudie les moyens de la conjurer, et c’est encore une fois à la liberté qu’il en demande la solution. La première mesure à prendre, suivant lui, est de renoncer à la fixation légale du rapport entre les deux métaux. Mais convient-il d’exclure l’argent au profit de l’or, comme l’Angleterre, ou l’or au profit de l’argent comme la Hollande ? Il repousse également ces deux procédés et propose d’admettre les deux métaux pour leur valeur courante en se soumettant sans résistance aux variations de rapports auxquels ils sont sujets.
Ce qui donne à cet article une portée particulière et en fait comme le manifeste d’une opinion, c’est que le rédacteur en chef du Journal des Économistes, Joseph Garnier, le fit suivre d’observations insistant sur la nécessité d’indiquer sur les pièces de monnaie leurs poids et leur titre, condition indispensable pour que, la valeur fixe étant remplacée par une valeur marchande assujettie à fluctuations, le public pût savoir ce que représentait le métal qu’il échangeait contre des produits.
III. À la Société d’Économie politique. — L’intervention de l’État. — Le Crédit foncier. — La théorie de la rente de Ricardo. — Polémique avec Carey.
La même année où il devenait le collaborateur du Journal des Économistes, en 1847, Coquelin était reçu membre titulaire de la Société d’Économie politique. Par l’étendue de ses connaissances, par sa facilité de parole, il semblait désigné pour être de ceux qui prennent aux discussions une part active. Il ne paraît pas cependant que ses interventions aient été très fréquentes.
C’est à la séance d’octobre 1848 que nous le voyons pour la première fois prendre la parole. La réunion discutait la question de l’intervention de l’État, question que les circonstances rendaient alors tout à fait actuelle, à laquelle soixante ans écoulés n’ont rien enlevé de son intérêt immédiat, et qui est encore aujourd’hui le point de départ de presque toutes les discussions, comme la solution que les contradicteurs en ont par avance acceptée forme la ligne de démarcation entre les diverses opinions. Coquelin exprima l’avis que la justice a besoin d’une autorité suprême qui la sanctionne et que la concurrence, seul remède contre la fraude et la violence, seule capable de faire triompher la nature des choses dans les rapports des hommes entre eux, ne peut exister sans cette autorité suprême, sans l’État ; opinion que Bastiat appuya en donnant aux fonctions de l’État cette mesure, si souvent indiquée dans ses écrits, qu’elles doivent être circonscrites aux attributions qui assurent à chacun des garanties de justice et de sécurité.
Sous une forme presque identique, la question revenait à l’ordre du jour de la réunion de janvier 1850. Coquelin, s’appropriant la formule qu’il avait sans doute entendue de la bouche de Bastiat, déclare qu’il admet l’intervention de l’État en matière de sécurité et de justice. Il constate que, seul, l’État peut garantir la liberté et la concurrence qui sont la vie de toutes les industries et il ne fait pas d’exception, « même pour les chemins de fer, pour lesquels cependant il conçoit qu’on ait pu hésiter. » Par malheur, si l’État peut seul garantir la liberté et la concurrence, c’est un monopole dont il n’use guère ; il profite au contraire de sa situation privilégiée contre la liberté, contre la concurrence, pour réglementer arbitrairement, pour prononcer des restrictions et des interdictions frustratoires et pour établir des monopoles en faveur d’intérêts particuliers, au détriment de l’intérêt général. En agissant ainsi, nous sommes d’avis que l’État sort de son rôle, qu’il méconnaît sa fonction et qu’il substitue l’iniquité à la justice. Mais, puisque cette entité abstraite qu’on appelle l’État détient le pouvoir, quel moyen existe-t-il de le contraindre à l’exercer d’une façon normale, à assurer la justice et la liberté ? La question se posait certainement à l’esprit de nos devanciers ; elle se pose, plus aiguë, plus irritante au nôtre, à mesure que les empiétements de l’État sur le domaine de l’ordre privé s’aggravent, portant atteinte à la liberté et faussant la justice. À cette violation persévérante du droit les libéraux n’ont cessé d’opposer leurs protestations. Vain effort ! Elles se perdent dans le vide ou elles sont dominées par le tumulte des intérêts particuliers dont l’État se fait chaque jour davantage le serviteur.
Coquelin n’allait pas tarder à avoir une occasion nouvelle de défendre la cause de la liberté. Parmi les questions à l’ordre du jour était alors celle du Crédit foncier. Elle entrait trop dans le cadre des études de la Société d’Économie politique pour que celle-ci n’en fît pas l’objet d’un examen attentif. Trois réunions avaient été consacrées à cette discussion. Elle se continua encore à la réunion d’octobre 1850. Mais sur la proposition de Joseph Garnier, il fut décidé que ce nouveau débat porterait sur l’intervention de l’État comme intermédiaire entre capitalistes et emprunteurs.
Adversaire de l’intervention de l’État sous quelque forme qu’elle se produise, partisan de la liberté des banques, Coquelin ne pouvait manquer de défendre ses principes. L’occasion était favorable à un double point de vue, puisqu’il s’agissait à la fois d’opposer la liberté au monopole et d’étendre le crédit par la mobilisation de la propriété, ce qui est une opération de banque. Il serait surprenant que les observations de Coquelin n’eussent fait aucune allusion à ce côté de la question. Nous devons cependant constater que le compte-rendu publié par le Journal des Économistes ne l’indique pas. Il note seulement que Coquelin combat l’intervention de l’État. « On fera mal, dit-il, si l’on se jette dans la voie du monopole, si on ne laisse pas aux syndicats de propriétaires la faculté de se constituer diversement. »
Quant à l’État, il n’a, de l’avis de Coquelin, qu’à dépouiller les propriétés des privilèges qui ont pu leur être attribués, à permettre qu’elles se rendent liquides à peu de frais, que les titres qui en sont la représentation soient facilement transmissibles et à garantir la liberté de cette espèce d’association. Ce ne sont pas précisément ces idées qui ont prévalu dans l’exécution. Le décret du 28 février 1852 institua les sociétés de crédit foncier. S’inspirant d’idées assez analogues à celles qui avaient, un demi-siècle plus tôt, présidé à la création de la Banque de France et des banques départementales, il les dotait d’un monopole régional. Celle de Paris, dont Wolowski était nommé directeur, était constituée pour une durée de vingt-cinq ans et avait un privilège exclusif dans le ressort de la Cour d’appel de Paris.
Coquelin consacra un article à cette organisation dans le numéro du 15 avril 1852 du Journal des Économistes. Il faisait bien des réserves au sujet de ce nouveau monopole. Néanmoins l’article décèle des hésitations qui étonnent de la part du vigoureux adversaire des banques privilégiées. Mais il faut tenir compte des temps. Ils n’étaient pas propices à la critique trop vive des actes du pouvoir.
En 1850, s’était ouverte une polémique sur la théorie de Ricardo concernant la rente du sol. Bastiat l’avait combattue dans ses Harmonies et Clément, rendant compte de cet ouvrage dans le Journal des Économistes de juin 1850, avait pris parti pour Ricardo, faisant en même temps intervenir Malthus et la question de la population dans le débat. On connaît la lettre que Bastiat écrivit à ce propos à R. de Fontenay le 3 juillet 1850 : « Peut-être prenez-vous avec un peu trop de feu parti pour les Harmonies contre l’opposition du Journal des Économistes. Des hommes d’un certain âge ne renoncent pas facilement à des idées faites et longtemps caressées… Quant à la population, il est incompréhensible que M. Clément m’attaque sur un sujet que je n’ai pas encore abordé. Et, au fond, nier cet axiome : La densité de la population est une facilité de production, c’est nier toute la puissance de l’échange et de la division du travail. »
À la suite de l’article de Clément, l’économiste américain Carey (de Philadelphie) adressa au Journal des Économistes une note réclamant la priorité des doctrines présentées par Bastiat et exposées par lui-même, en 1837-1840, dans ses Principles of political economy. Il constatait que Bastiat était d’accord avec lui pour adopter des vues qui renversent les doctrines de Ricardo sur la rente et la théorie de Malthus sur la population ; mais Bastiat se devait à lui-même, disait-il, de reconnaître la source à laquelle il avait puisé. Cette note fut transmise à Bastiat qui, mourant, répondit de Rome, le 8 décembre 1850, par un écrit dans lequel il discutait les critiques de Clément et défendait contre l’accusation de plagiat son œuvre, dans laquelle « une lente assimilation, fruit des méditations de toute une vie, est facile à voir. »
La note de Carey et la réponse de Bastiat parurent ensemble, après la mort de celui-ci[19], en même temps qu’une riposte de Clément. La mort de Bastiat ne calma pas la fougue épistolaire de Carey qui répliqua à sa note par une seconde lettre, puis en adressa encore deux autres au Journal des Économistes pour répondre à Clément et pour relever quelques réflexions de M. G. de Molinari dans son article sur Bastiat. Sur ces entrefaites, Paillottet avait protesté contre l’accusation de plagiat jetée à son ami[20], et Carey reprit la plume pour une nouvelle réponse. Le Journal des Économistes n’inséra pas ces lettres ; Joseph Garnier se borna à les analyser dans le numéro d’octobre 1851 et à relever assez ironiquement les plaintes formulées par Carey contre l’intolérance de Clément et de M. de Molinari. Joseph Garnier ajoutait, pour clore le débat, que « si MM. Carey et Bastiat ont, chacun avec ses qualités propres, plus insisté que d’autres sur l’harmonie des lois économiques avec les lois naturelles », il reste à savoir s’ils ne se sont pas mépris sur la nature de quelques-unes
de ces lois. « Et d’autre part, nous persistons à penser qu’ils ont eu tous deux le tort de croire que les grands économistes qui les ont précédés n’avaient aucune idée de cette harmonie qui transpire à travers toutes leurs œuvres, si je puis dire, de Quesnay à Rossi, en passant par Turgot, A. Smith, J.-B. Say, Mill, Comte, et Malthus et Ricardo eux-mêmes, pour ne parler que de ceux qui ne sont plus de ce monde. »
Dans ce même numéro d’octobre 1851, le Journal des Économistes publiait, tout en faisant des réserves, la première partie[21] d’une étude de R. de Fontenay sur la théorie de Ricardo. Naturellement, il se prononçait avec passion dans le même sens que Bastiat.
La question de la rente du sol était donc à l’ordre du jour. Elle se posait, non seulement en théorie devant les économistes, mais aussi devant l’opinion publique. Il est évident que si l’opinion de Ricardo peut se résumer en ces termes : « La propriété foncière est un monopole injuste mais nécessaire dont l’effet est de rendre fatalement le riche toujours plus riche et le pauvre toujours plus pauvre », et si cette opinion est reconnue exacte, c’est la condamnation formelle de la propriété et la justification de tous les efforts des socialistes pour la supprimer. Bastiat les avait vus à l’œuvre. Il avait entendu formuler la fameuse doctrine : « La propriété, c’est le vol », et cela n’avait assurément pas contribué à diminuer son opposition à une théorie dont on pouvait tirer de telles conséquences. Aussi s’écriait-il : « Et moi je dis que la propriété n’est pas un monopole ! »
Mais la question est précisément de savoir si cette interprétation de la théorie de Ricardo est exacte. C’est la question que la Société d’économie politique mettait en discussion en novembre 1851. Dans une note qu’il adressait à la réunion, M. de Molinari protestait contre l’interprétation de Bastiat : « Si elle était exacte, disait-il, Ricardo mériterait d’être attaché au pilori, car il aurait misérablement calomnié la Providence. » Coquelin présentait ensuite une analyse des écrits de Carey sur la rente et notamment de son ouvrage Le Passé, le Présent et l’Avenir où est développée cette idée que la situation matérielle de l’homme s’améliore à mesure qu’il avance dans la vie sociale et que l’accroissement de la population contribue autant à cette amélioration que l’accroissement du capital et des lumières. À mesure que la population, le capital et les lumières augmentent, l’homme agit avec plus de puissance sur la nature physique, particulièrement sur le sol et il en tire, avec une égale dépense de force, des fruits plus abondants. Coquelin terminait l’analyse de cet ouvrage, où Carey oppose sa théorie à celle de Ricardo, en disant : « C’est à chacun de voir d’abord, en relisant Ricardo, s’il y a réellement entre les deux théories l’opposition radicale que M. Carey croit y apercevoir ; puis, en supposant que cette opposition soit réelle, à accorder à chacun des deux systèmes la part qui lui revient. »
La réunion de novembre 1851 n’avait fait, en quelque sorte, qu’exposer l’état de la question. La discussion se poursuivit à la réunion de janvier 1852. R. de Fontenay et Paillottet présentèrent diverses observations et soutinrent l’opinion de Bastiat. Coquelin prit au débat une part brillante. Il contestait que, sous l’influence des lois naturelles, la cherté des subsistances décroisse sans cesse. Ce qui diminue, ce sont les prix de main-d’œuvre et de transport, c’est-à-dire les frais de production manufacturière ; mais le prix du blé proprement dit augmente dans tous les pays à mesure qu’ils se civilisent ou se peuplent davantage. Il déclarait qu’il admettait « pleinement la théorie de Ricardo quant à l’application du phénomène de la rente. Il n’en est pas de même, ajoutait-il, de toutes les conséquences que Ricardo a pu en tirer. »
Carey, dont l’humeur paraît avoir été assez batailleuse, n’eut pas plutôt reçu le compte-rendu de la réunion de novembre de la Société d’économie politique qu’il adressa de Philadelphie au Journal des Économistes une note dans laquelle il relevait certaines des appréciations de Coquelin sur son ouvrage Le Passé, le Présent et l’Avenir. Cette note fut publiée, avec une réponse de Coquelin, dans le fascicule de mai-juin 1852. Elles ne contiennent, ni l’une ni l’autre, d’arguments nouveaux ni bien saillants. Le débat était bien près d’être épuisé.
Cependant la réponse de Coquelin provoqua une nouvelle lettre de Carey qui refusait de reconnaître comme siens les principes que Coquelin lui avait attribués. Il n’admettait pas que la valeur des produits bruts tende à augmenter avec l’accroissement de la population ; il attribuait les avantages de situation des parcelles terriennes au travail de l’homme et il engageait une nouvelle discussion sur l’ordre chronologique dans lequel les diverses parties du sol ont été mises en culture.
Quand cette lettre parvint au Journal des Économistes, Coquelin était mort. En l’insérant dans le fascicule de septembre-octobre 1852, Joseph Garnier la fit suivre d’une note disant que Coquelin n’aurait sans doute pas répondu et qu’il « se réservait de traiter la question à fond dans une étude sur Ricardo dont il avait beaucoup médité les écrits et qu’il avait en très haute estime. » Le travail annoncé ici aurait sans doute pris place dans le Dictionnaire de l’Économie politique au mot Ricardo ou à celui Rente du sol. Mais cette partie du Dictionnaire ne fut préparée qu’après la mort de Coquelin, et c’est Hippolyte Passy qui se chargea de traiter cette importante question.
IV. Le Crédit et les Banques. — Organisation des banques. — Partisans et adversaires de la liberté. — Le volume de Coquelin présenté à l’Académie des sciences morales et politiques par Ad. Blanqui[22].
À la Revue des Deux-Mondes, au Journal des Économistes, dans le Dictionnaire de l’Économie politique, Coquelin n’avait jamais cessé d’élever la voix en faveur de la liberté des banques. C’était une des idées auxquelles il était le plus attaché, celle qu’il avait soutenue dès le début de sa carrière, aux Annales du Commerce. On apprécierait mal l’importance de cette question si l’on se contentait d’établir une comparaison entre l’état de choses actuel et la thèse de Coquelin. Il faut donc jeter un coup d’œil rapide sur le passé et rappeler quelle était l’organisation alors existante. Après la Terreur, il s’était formé à Paris plusieurs établissements pour pratiquer l’escompte et l’émission des billets. Ils s’étaient organisés librement, sans autre loi que leurs statuts, la liberté des banques résultant directement, comme le fait remarquer Courcelle-Seneuil, de la loi de 1791 sur la liberté du travail et du commerce intérieur. Malgré le souvenir tout récent des assignats, ils avaient fonctionné de façon satisfaisante et ils se développaient, lorsque le gouvernement consulaire jugea qu’une banque unique privilégiée rendrait plus de services que des banques libres. La loi du 14 avril 1803 (24 germinal-4 floréal an XI) établit la Banque de France et lui conféra le privilège exclusif d’émettre des billets, par coupures de 500 francs au minimum. Le capital était de 45 millions divisé en actions de mille francs. Le dividende était fixé à 6% au maximum. L’excédent de bénéfice formait un fonds de réserve converti en 5% consolidés ne pouvant être vendus sans autorisation pendant la durée du privilège. Par son article 30, la loi interdisait « à la Caisse d’escompte du Commerce, au Comptoir commercial, à la Factorerie et aux associations qui ont émis des billets à Paris » d’en émettre de nouveaux. Ils étaient tenus de retirer ceux qu’ils avaient en circulation avant le 1er vendémiaire suivant. Le gouvernement se réservait d’autoriser la création de banques dans les départements et de déterminer le montant de leurs émissions par coupures de 250 francs.
La Banque fut obligée presque immédiatement d’affecter une partie de son capital à l’achat de rentes, afin de soutenir le cours des fonds publics. Un peu plus tard, Napoléon en prenait une autre partie, en échange de laquelle il contraignait la Banque à accepter des délégations sur les receveurs généraux. À ce régime, la Banque se vit bientôt forcée de suspendre ses paiements.
La loi des 12 avril-2 mai 1806 reconstitua la Banque en portant son capital à 90 millions et donna au gouvernement le droit d’autoriser ou d’interdire la distribution de dividendes aux actionnaires. Le décret du 18 mai 1808 organisa les comptoirs de la Banque de France, fixa le taux de l’escompte à 5% l’an et autorisa l’émission de billets de 250 francs, portant en titre le nom du comptoir d’émission, payables aux caisses des comptoirs. Le décret stipule que ces billets pourront être échangés à la Banque de France et escomptés par tous les comptoirs d’escompte. Des comptoirs furent établis à Rouen et à Lyon. Un autre, ouvert à Lille, n’eut qu’une existence obscure.
La Restauration ferma les comptoirs et créa des banques départementales avec privilège d’émission. Plus tard, la Banque de France fut autorisée à former des succursales. Six furent fondées de 1836 à 1840.
Le privilège de la Banque de France expirait le 22 septembre 1843. Le 28 janvier 1840, le gouvernement présentait à la Chambre un projet de loi renouvelant ce privilège jusqu’au 31 décembre 1867. Il fut voté par la Chambre le 21 mai 1840 sur le rapport de Dufaure.
À la Chambre des pairs, le rapport de Rossi fut déposé le 22 juin 1840. Ce rapport nous montre combien peu l’usage du billet de banque était encore répandu : « La majorité des départements, dit Rossi, ne connaît guère le billet de banque et s’ils voyaient paraître des billets émanés du gouvernement, ils ne seraient que trop disposés à les regarder comme des assignats. » Passant à l’examen du taux de l’escompte, Rossi combat le régime de la concurrence. Cependant cette partie de son rapport n’est pas très nette et il serait facile d’y relever de graves contradictions.
Cette loi des 30 juin-8 juillet 1840, en même temps qu’elle prorogeait le privilège, préparait l’établissement des comptoirs et la suppression des banques départementales. L’organisation de ces comptoirs fut réglementée par l’ordonnance des 25 mars-17 avril 1841. Le privilège exclusif était donné à la Banque de France d’émettre des billets dans les villes où elle a établi des comptoirs. Ces billets portent en titre le nom du comptoir d’émission avec minimum de coupure de 250 francs. Ils sont payables à la caisse de ce comptoir et peuvent être remboursés à Paris par la Banque de France « lorsque le conseil général le trouve convenable ». Les billets de la Banque peuvent également être remboursés par les comptoirs avec l’autorisation du conseil général et aux conditions qu’il détermine.
Alors, comme aujourd’hui, la Banque ne pouvait escompter que des effets à trois signatures. Elle ouvrait des comptes-courants aux particuliers pour recevoir leurs fonds, recouvrer les effets qu’ils remettaient, faire leurs paiements à concurrence des sommes déposées à leur nom, mais jamais pour leur faire des avances et elle ne payait aucun intérêt pour les sommes déposées à sa caisse.
Telle était, dans son ensemble, la situation au moment où Coquelin écrivait son article de la Revue des Deux-Mondes sur le crédit et les banques dans l’industrie[23]. D’importants fragments de ce travail ont passé dans les articles du Dictionnaire de l’Économie politique que Coquelin consacra aux questions de banque, de circulation, de crédit, ainsi que dans le volume Le Crédit et les Banques.
Mais un article de Revue ne saurait, comme un dictionnaire ou un livre, examiner les questions à un point de vue purement doctrinal. Il doit porter la trace des circonstances, se motiver par la corrélation avec les faits qui intéressent l’opinion. Aussi, Coquelin se livre-t-il à l’examen de la loi du 30 juin 1840 et des conditions dans lesquelles le privilège de la banque de France avait été renouvelé. Tout en regrettant ce renouvellement, il ne dissimule pas qu’il n’y avait guère à espérer une autre solution ; mais il s’étonne qu’on n’ait même pas songé à étendre le privilège et que les choses aient été « maintenues dans l’état misérable où elles étaient auparavant ». Il conclut en demandant, non pas d’abolir le privilège, « mais de faciliter l’établissement des banques dans les départements ; quant aux banques existantes, de favoriser, au lieu de les défendre, les relations qu’elles peuvent former entre elles ; de les autoriser à recevoir des dépôts à intérêts de 2 000 francs au minimum ; de leur permettre, en conséquence, d’ouvrir des crédits à découvert dans une certaine limite ; enfin d’abaisser le minimum des coupons de billets non pas au taux de 250 francs comme on l’a proposé pour la Banque de France, non pas même au taux de 125 francs comme en Angleterre, mais au taux de 25 francs comme en Écosse. »
Quelques années après la publication de cet article, en 1847, le minimum de la coupure était abaissé de 500 francs à 200 francs. Le projet de loi avait proposé de le fixer à 250 francs et Léon Faucher demandait qu’il fût réduit à 100 francs. Mais en cette mesure avait consisté la seule modification apportée à la situation que Coquelin qualifiait de misérable et que Léon Faucher résumait devant la Chambre en disant, le 21 février 1848 : « Notre système de banque — et je ne sais si je dois me servir ici du mot système — est un édifice incohérent et formé de pièces de rapport. On y trouve en effet tous les systèmes moins les garanties que présenterait isolément chacun de ces systèmes. Nous avons un commencement de banque unique, de banque centrale qui est la Banque de France avec ses onze comptoirs. Nous avons, à côté de ces grands établissements, les banques départementales qui possèdent le privilège de l’émission borné à un département ou à une seule ville. La Banque de France ne suit pas d’autre règle dans ses opérations que la prudence des hommes qui la dirigent ; les banques départementales sont soumises à des règles diverses ; souvent même elles ne tiennent aucun compte des règles qui président à leur organisation et ne se font pas scrupule de les enfreindre ». Il insistait sur les inconvénients d’une organisation qui, hors de la circonscription de la banque d’émission, rendait le billet inutilisable. Il considérait cette diversité de signes monétaires comme une affliction. « Elle rétablit les douanes intérieures, disait-il. L’organisation actuelle du crédit n’est ni la monarchie ni la république ; c’est l’anarchie pure et simple ; c’est la confusion des langues, la tour de Babel. » Il reprochait à la Banque de France de conserver les mœurs d’une banque locale, de ne pas se dégager assez de l’intérêt de ses actionnaires. « Vous en avez eu la preuve dans l’année qui vient de s’écouler. Vous avez vu la Banque de France, après avoir élevé le taux de l’intérêt à 5% par une mesure de circonstance que je suis loin de blâmer, ne pas le ramener ensuite assez promptement à 4% lorsque les circonstances sont devenues plus favorables. Elle a attendu que le public se retirât d’elle, que les escomptes se rétrécissent de 50% comme il est arrivé dans le mois de décembre dernier. Il est fâcheux que cette lenteur se traduise — je ne dis pas s’explique — par un dividende de 270 francs, ou de 27% du capital nominal, dividende le plus élevé que la Banque ait encore distribué à ses actionnaires. »
Trois jours plus tard, le trône de Louis-Philippe était renversé. La crise économique prenait les proportions les plus menaçantes. La propriété foncière était avilie ; le cours des valeurs mobilières s’effondrait ; le numéraire se cachait ; le crédit n’existait plus. Une des premières préoccupations du Gouvernement provisoire dut être de remédier, dans la mesure du possible et par les moyens à sa disposition, à cette situation. Le 15 mars, il rendait un décret dispensant la Banque de France de l’obligation de rembourser ses billets en espèces, créant des coupures de 100 francs, prescrivant que les billets seraient reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers. Le 25 mars, un autre décret étendait ces mesures aux banques départementales « dans la circonscription du département où chacun de ces établissements a son siège. » Enfin un décret du 27 avril :
« Considérant que les billets des banques départementales forment aujourd’hui pour certaines localités des signes monétaires spéciaux dont l’existence porte une perturbation déplorable dans toutes les transactions ;
« Considérant que les plus grands intérêts du pays réclament impérieusement que tout billet de banque déclaré monnaie légale puisse circuler également sur tous les points du territoire », ordonnait la réunion des banques départementales, qui devenaient des succursales de la Banque de France.
L’établissement du cours forcé éveillait dans beaucoup d’esprits le souvenir des assignats et il se produisit, ainsi qu’il était à prévoir, une dépréciation sensible du billet de banque.
Tout concourait donc à rendre aussi grande que pressante l’importance de la question des banques et du crédit au moment où Coquelin, mettant à profit les loisirs forcés que lui faisaient la disparition du Libre-Échange, celle de l’Association pour la liberté des échanges et les événements politiques, rassemblait, pour les condenser en un volume, les idées qu’il n’avait cessé de défendre dans les journaux, dans les revues et dans le Dictionnaire de l’Économie politique.
Coquelin était du reste à peu près leur seul défenseur. S’il est permis de penser que Bastiat les partageait en vertu de son penchant à se prononcer toujours pour les solutions libérales contre toutes les restrictions, il n’a pas pris part au débat, se faisant peut-être scrupule de paraître empiéter sur le domaine propre de son collaborateur et ami.
Cette question de la liberté des banques est de celles qui partagent les économistes. La cause de la liberté compte parmi ses ardents soutiens Michel Chevalier[24], Mannequin[25], Courcelle-Seneuil qui, outre son ouvrage spécial : Les Opérations de Banque, a écrit pour le volume de Coquelin une magistrale introduction. Mais elle a contre elle Rossi, Ad. Blanqui, Léon Faucher, V. Bonnet[26], Bartholony, G. d’Eichthal, Thiers, qui comme président du conseil, en 1840, prononça un discours qui entraîna le vote de la Chambre en faveur du renouvellement du privilège, Wolowski, au volume duquel : La Question des Banques, Courcelle-Seneuil répondit par La Banque libre[27].
Le désaccord entre les économistes tient à des causes fondamentales et à la conception qu’ils se font du rôle des banques d’émission. Celle des partisans du privilège a pour elle l’autorité du fondateur de la Banque de France, de Napoléon qui disait au Conseil d’État, le 27 mars 1806 : « La Banque n’appartient pas seulement aux actionnaires ; elle appartient aussi à l’État puisqu’il lui donne le privilège de battre monnaie… Je veux que la Banque soit assez dans la main du gouvernement et n’y soit pas trop. Je ne demande pas qu’elle lui prête de l’argent, mais qu’elle lui procure des facilités pour réaliser, à bon marché, ses revenus aux époques et dans les lieux convenables. Je ne demande en cela rien d’onéreux à la Banque puisque les obligations du Trésor sont le meilleur papier qu’elle puisse avoir. » Déclaration qu’il accentuait le 2 avril 1806 en disant : « Je dois être le maître dans tout ce dont je me mêle et surtout dans ce qui regarde la Banque qui est bien plus à l’empereur qu’aux actionnaires puisqu’elle bat monnaie. »
C’est la théorie de Wolowski lorsqu’il soutient que « l’État ne saurait demeurer étranger à l’émission des billets faisant office de monnaie, car il ne s’agit point ici d’une industrie proprement dite, mais d’un élément de l’ordre. » Il raille ceux qui n’ont vu dans le problème des banques qu’un élément de liberté : « La faculté de battre monnaie ou de créer l’instrument fiduciaire qui la remplace, dit-il, n’est pas inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme. La liberté des banques n’emporte pas avec elle la liberté d’émission des billets de banque faisant office de monnaie. » À son avis les banques deviennent un admirable instrument de production en mettant les capitaux à la disposition de ceux qui travaillent. Les institutions de crédit répondent à leur titre en substituant aux paiements les méthodes perfectionnées de comptes-courants, de chèques, de compensation, de virement, « au lieu de concentrer leurs efforts sur la périlleuse et décevante ressource du billet payable au porteur et à vue… Tout ce qui tend, dit-il encore, à refléter la monnaie, à lui emprunter son mode d’action, à la remplacer, devient une affaire d’État, car la sécurité et la commodité des transactions s’y rattachent. »
Cette sécurité et cette commodité ne sont pas seules en cause. Cela ressort de ce passage des Mémoires de Mollien, cité par Wolowski, dans lequel est ainsi rapportée une conversation de Napoléon avec son ministre : « J’avoue que je me méfie de l’esprit aventurier des commerçants actuels. Les bonnes traditions du commerce sont perdues ; il a aussi abusé de la liberté et il a besoin maintenant que le gouvernement veille sur lui et pour lui. Je n’aime pas non plus ce conflit de trois banques qui fabriquent concurremment une monnaie de papier… Ne m’avez-vous pas dit que, pour conserver son crédit, il fallait en général qu’une monnaie artificielle comme celle des banques ne sortît que d’une seule fabrique ? J’adopte cette pensée. Une seule banque est plus facile à surveiller que plusieurs et pour le gouvernement et pour le public. Quoi qu’en puissent dire les économistes, ce n’est pas en ces cas que la concurrence peut être utile. »
Il s’agit donc d’une forme spéciale de protectionnisme. Le gouvernement se substitue aux commerçants pour défendre leurs intérêts. Du haut de son infaillibilité et de sa compétence universelle, il décide quelles sont les bonnes traditions et en quoi consiste « l’esprit aventurier ». Mais sa vigilance n’est pas gratuite et il commence par se faire payer ses bons offices. Dans la note expédiée du Havre le 29 mai 1810, Napoléon, inspiré par Mollien, explique que « la destination du capital de la Banque de France n’a pas été de donner à la Banque les moyens propres d’exploiter son privilège ; ce capital n’est pas l’instrument de ses escomptes, car ce n’est pas avec son capital qu’elle peut escompter. Son privilège consiste à créer, à fabriquer une monnaie particulière pour ses escomptes… C’est indépendamment de son capital qu’elle crée par ses billets son véritable et son unique moyen d’escompte. Une banque n’émettant et ne pouvant émettre des billets qu’en échange de bonnes et valables lettres de change à deux ou trois mois de terme au plus, doit avoir constamment dans son portefeuille, en lettres de change, une somme au moins égale aux billets qu’elle a émis. Elle est donc en situation de retirer tous ses billets de la circulation dans un espace de trois mois par le seul effet de l’échéance successive de ces billets, sans avoir entamé aucune partie de son capital. »
À ce point, le raisonnement de Mollien parut tellement confus que Napoléon renvoya la note à son ministre avec cette observation : « S’il en est ainsi, les billets de la Banque ne font que se substituer dans la circulation aux lettres de change. Pourquoi le monopole accordé à un établissement d’avoir cette facilité ? Et que devient le remboursement à vue des billets de banque ? » Questions embarrassantes auxquelles Mollien fit cette réponse : « Le capital fourni par les actionnaires d’une Banque n’étant à proprement parler qu’une espèce de cautionnement qu’ils donnent au public, on pourrait presque dire qu’une Banque qui serait parvenue à se faire une réputation d’infaillibilité n’aurait pas même besoin de capital pour exploiter son privilège, c’est-à-dire pour escompter avec les billets fabriqués par elle les lettres de change qui lui seraient apportées par le commerce. »
Étant ainsi établi qu’une banque privilégiée n’a pas besoin de capitaux pour faire des avances, l’État jugea immédiatement et a continué à juger que la Banque de France ne pouvait faire un meilleur usage de son capital que de le lui avancer, tantôt contre des obligations à court terme et tantôt par des achats de fonds publics. Ainsi se trouve réalisée la pensée de mettre, dans une certaine mesure, la Banque dans la main du gouvernement, mesure très variable suivant les circonstances puisque, dans certains cas, l’État pourrait, en décrétant le cours forcé, faire des billets de banque une monnaie légale et remplacer tout ou partie de l’encaisse métallique par des obligations du Trésor.
Les partisans de la liberté considèrent la question d’un point de vue tout différent. Avec Coquelin, ils estiment que la liberté de la banque n’est qu’une forme particulière de la liberté générale du travail qu’a garantie la Constituante. Ils regardent le billet de banque non pas comme une monnaie, car il lui manque la valeur intrinsèque, la valeur marchande, mais comme une obligation commerciale, échangée contre d’autres obligations commerciales à terme et entrant dans la circulation parce que, étant payable au porteur et à vue, celui qui en est détenteur est certain qu’il peut, à tout moment, la convertir en espèces. C’est, de la part du public, une question de confiance, laquelle est tout à fait distincte du monopole, et l’on peut concevoir un régime dans lequel plusieurs banques, fonctionnant librement, inspireraient une confiance assez grande pour que leur papier fût accepté concurremment par le public.
Est-il à craindre que des banques concurrentes émettent plus de billets qu’il n’est utile ? On l’a soutenu et on a allégué que cette surabondance aurait pour effet de déprécier leurs billets. Coquelin et après lui Courcelle-Seneuil ont réfuté cette allégation et montré que l’émission des billets a ses limites qui sont les limites mêmes de la circulation monétaire. Qu’une banque unique ait le privilège de l’émission ou que plusieurs banques essaient de forcer les émissions, il est impossible de dépasser le chiffre fixé par les besoins des échanges. Pour aller au-delà de la limite naturelle des besoins commerciaux, il faudrait que les billets de banque cessassent d’être remboursables contre espèces ; auquel cas, une fabrique de papier-monnaie prend la place de la banque de circulation.
Mais cette émission de papier, que l’on a considérée, ainsi que le dit Coquelin, « comme tellement caractéristique de l’action des banques qu’on a presque oublié les autres fonctions que ces institutions remplissent pour ne voir en elles que des fabriques de billets », ne joue cependant dans l’ensemble des opérations d’une banque « qu’un rôle pour ainsi dire subordonné, comme étant l’indispensable complément d’une autre fonction plus essentielle. »
Cette fonction consiste à développer le crédit. Coquelin en vante les bienfaits avec une chaleur qui peut surprendre un peu aujourd’hui mais qui se comprend mieux, si l’on se reporte au temps où il écrivait et où ce procédé était d’un usage beaucoup moins général. On en était encore à la théorie de J.-B. Say : « Le crédit ne crée pas les capitaux ; c’est-à-dire que si la personne qui emprunte pour employer productivement la valeur empruntée acquiert par là l’usage d’un capital, d’un autre côté, la personne qui prête se prive de l’usage de ce même capital. » D’où il conclut que l’exercice du crédit n’opère qu’un déplacement et procure de médiocres avantages. J.-B. Say ne considère ici que le prêt en numéraire. À cet égard déjà, sa théorie peut paraître un peu étroite. Le prêteur, en effet, ne se dessaisit que de capitaux inactifs, enfouis au fond du « bas de laine ». L’emprunteur emprunte, non pas pour le plaisir de contracter une obligation, mais pour monter une usine, pour développer son industrie. Il paie au prêteur l’intérêt de son argent ; il trouve lui-même meilleur emploi de son activité. L’avantage est donc certain pour l’un comme pour l’autre.
Mais le crédit a devant lui de plus vastes horizons si on le place « là où est son véritable siège, dans les avances mutuelles des producteurs. » Ce qu’ils s’avancent les uns aux autres, ce sont des produits, des marchandises. Tant que ces marchandises sont dans les magasins des producteurs, elles ne représentent qu’un capital inactif. Par la vente à crédit, ce capital inactif passe, tout comme les écus tirés du « bas de laine », entre les mains d’un homme qui le fera travailler pour son avantage.
Quelle que soit son admiration pour les effets du crédit, Coquelin se garde bien cependant de lui attribuer le pouvoir de rien créer, rien enfanter par lui-même. Il reconnaît que, vulgairement parlant, il n’ajoute par lui-même « aucune valeur nouvelle à la masse des valeurs qu’un pays possède. » Il lui attribue seulement cette fonction de « rendre à des emplois féconds toutes celles de ces valeurs qui dorment inactives », et d’augmenter ainsi le « capital productif ». Ses bienfaits procèdent de ce seul fait qu’il « active le service des capitaux ». Il amène « une circulation plus générale et plus active. Mais que de choses dans ces seuls mots ! Pour l’homme qui sait voir, tout est là : puissance productive, travail, richesse, bien-être de tous et de chacun. »
C’est à cette généralisation, à cette activité de la circulation que les banques contribuent efficacement, soit en réduisant par les divers procédés de compensation, de virement, les besoins monétaires, soit en donnant la faculté de négocier les billets et les traites de commerce. Sans doute ces billets et ces traites servent eux-mêmes, par voie de transmission, à payer les achats et ils circulent de main en main. Mais pour qu’ils se suffisent à eux-mêmes et qu’une compensation exacte puisse s’établir entre le débit et le crédit de chacun, il faudrait admettre bien des circonstances dont la concordance, comme sommes ou comme date d’échéance, ne se présente pas toujours. Le commerçant n’a-t-il du reste pas besoin de numéraire pour payer son personnel, ses dépenses de maison, même pour acheter au comptant certaines matières ? C’est ici que la banque intervient en escomptant les billets de commerce, c’est-à-dire en échangeant les effets à terme, déduction faite de l’intérêt jusqu’à l’échéance, contre du numéraire, ou des billets payables à vue et au porteur, c’est-à-dire immédiatement réalisables.
Ceci n’est, naturellement, que la théorie réduite à ses éléments essentiels. Dans la pratique, la banque individuelle ne saurait avoir ni un champ d’action assez vaste, ni une notoriété assez générale pour que son papier inspirât la confiance publique sans laquelle il ne sortirait de ses guichets que pour être présenté aussitôt au remboursement. Aussi Coquelin ne songe à ériger en établissements d’émission que de grandes compagnies de banque, ayant des relations étendues, une situation indiscutée. Or, jusqu’au moment où Coquelin publiait son volume, aucune compagnie de ce genre n’avait pu se constituer en France. Pendant cinquante ans, le Conseil d’État avait refusé d’autoriser des sociétés anonymes ayant la banque d’escompte pour objet, sous le prétexte que l’on pouvait donner à toute opération commerciale, quelle qu’elle fût, la forme de l’escompte. C’est seulement en mars 1848 que fut décrété l’établissement des comptoirs d’escompte. Celui de Paris, avec un capital de garantie de vingt millions, fourni un tiers par les souscriptions d’actions de 500 francs, un tiers en bons du Trésor par l’État et un tiers en obligations par la ville de Paris, était autorisé à escompter les effets à deux signatures à l’échéance de 105 jours au plus pour le papier payable à Paris, de 90 jours pour les villes de province possédant soit une banque locale, soit un comptoir de la Banque de France et de 60 jours pour le reste de la France. C’était la première brèche faite à la législation qui, pour mieux défendre le monopole de la Banque de France, interdisait la formation de banques aux associations de plus de six membres.
Depuis, la législation a été refondue ; d’autres grandes compagnies se sont constituées avec des succursales et des correspondants sur tous les points du territoire et à l’étranger. Si l’obligation des trois signatures a été maintenue pour les escomptes de la Banque de France, si la plupart des restrictions qui empêchent cet établissement de rendre tous les services dont le commerce aurait besoin subsistent, si même, malgré le développement considérable de la circulation des billets de banque, aujourd’hui universellement connus et acceptés avec une entière confiance, le vieil esprit de réglementation, qui montre son zèle protecteur en mettant à ses protégés des lisières et des entraves, n’a pu se résigner à supprimer la limitation légale du chiffre d’émission et se contente de reculer, de mauvaise grâce, les barrières quand il n’y a plus moyen de faire autrement, il convient de reconnaître que la situation est très différente de celle qui justifiait les critiques et les alarmes de Coquelin.
Non seulement par l’abaissement du chiffre des coupures, le billet de banque est devenu d’un usage plus pratique, mais il circule librement sur tout le territoire. La Banque de France a augmenté considérablement le nombre de ses succursales et de ses bureaux en province ; à côté d’elle, de grandes compagnies, maîtresses de leurs statuts, indépendantes de l’ingérence de l’État, ont ouvert sur tous les points des comptoirs qui rendent au public tous les services que la tutelle de l’État empêche sa protégée, la Banque de France, de lui rendre.
L’un des plus considérables consiste dans l’acceptation de dépôts portant intérêt, même s’ils sont remboursables à vue et produisant un intérêt d’autant plus élevé qu’ils sont remboursables à plus long terme. Les grandes compagnies de banque font en cela ce que Coquelin demandait. Elles réunissent dans de larges courants les minces filets de l’épargne individuelle ; elles attirent, pour les rejeter dans la circulation, dans le mouvement de l’industrie, les capitaux qui dormaient improductifs dans le bas de laine. Ils ne pouvaient guère faire autrement que d’y dormir, il y a soixante ans. Les banques ne les acceptaient que pour les laisser improductifs. Les caisses d’épargne étaient loin d’avoir l’importance qu’elles ont prise et d’être aussi facilement accessibles aux habitants des petites villes ou des villages qu’elles le sont maintenant. Le nombre des valeurs mobilières était assez faible. La difficulté des communications ne permettait guère à beaucoup de gens de recourir à ce mode de placement. Du reste, l’éducation du public était si peu faite que les petits épargnants ne se rendaient à peu près aucun compte de cet emploi de leurs économies. Cette ignorance est en quelque sorte symbolisée par un dessin d’un journal satirique de 1847 ou 1848, qui représente la femme d’un savetier en train de raccommoder un carreau cassé avec des obligations de chemins de fer. Au surplus, l’effondrement de quelques affaires dans lesquelles la crédulité publique avait été outrageusement exploitée avait englobé la plupart des valeurs mobilières dans une commune méfiance.
Avec beaucoup de clairvoyance, Coquelin signalait les effets fâcheux de cet état de choses qui tantôt avait pour résultat d’immobiliser une quantité importante de capitaux, tantôt de les grouper, et de les perdre dans des consommations improductives, ou encore de leur faire chercher un refuge, « faute de mieux, dans les caisses des banquiers particuliers ou des notaires où ils ne jouissent que d’une sécurité problématique et ne profitent guère ni à leurs possesseurs ni au public. »
« On se plaint, dit-il encore, de voir les capitaux se précipiter à la Bourse et on ne voit pas qu’on les y force en leur fermant toute autre route. On crie contre l’agiotage ; on invoque contre ce fléau la répression des lois et on ne voit pas qu’on l’alimente soi-même par d’injustes restrictions. Tant que vous n’aurez pas accordé une liberté entière pour l’institution des banques, n’espérez pas que le mal cesse, quelque effort que vous puissiez faire pour le contenir ou le réprimer. »
C’est encore sur l’institution des banques que Coquelin compte pour canaliser, dans les campagnes, les épargnes qui ne sortent de la tirelire où elles se sont lentement accumulées que pour être employées à l’achat d’un lopin de terre, à cet émiettement du sol en parcelles trop petites qui, par l’effet de la concurrence acharnée, montent à des prix fous, ruinant souvent leurs possesseurs et, en tous cas, engloutissant, dans le prix vénal du sol, des capitaux qui eussent si bien servi à le féconder.
Certes, ces considérations ne manquent pas de justesse. Peut-être toutefois Coquelin, dominé par son idée, a-t-il attribué à l’institution des banques une toute-puissance excessive. L’épargne n’a aujourd’hui que l’embarras du choix entre les destinations qu’elle peut prendre. Cela n’a diminué ni le nombre des agioteurs, ni l’amour du paysan pour la terre. On pourrait même se demander jusqu’à quel point il serait bon que cet amour s’atténuât. S’il entraîne parfois quelque excès et quelques emplois défectueux de capitaux, il peut apparaître comme la sauvegarde sociale contre l’expansion de certaines théories et la vulgarisation du communisme.
Nous ne saurions entrer dans l’examen de toutes les questions auxquelles Coquelin touche dans son livre. Principes ou points de fait soulevés par les circonstances, on peut dire qu’il a examiné à peu près tout et montré que la liberté fournit la meilleure des solutions parce qu’elle ne laisse aucune place à l’arbitraire qui, à des degrés et dans des sens divers, est la règle commune de toutes les autres méthodes.
Au moment où Coquelin publia son volume, l’heure n’était guère propice aux discussions doctrinales. À quoi bon, au surplus, s’attarder à des réformes partielles quand il s’agissait de refondre la société tout entière, sans en excepter l’homme lui-même ? Qu’importait que la concurrence promît au crédit de nouvelles facilités et un prix moins élevé ? N’allait-on pas avoir le crédit gratuit ? Les nouvelles écoles le réclamaient ; Proudhon en faisait son affaire. Ceux qui élevaient quelques doutes sur la possibilité de réaliser ce projet étaient des attardés, dignes des mêmes injures que Bastiat.
Les crises qui venaient de se produire avaient eu, d’autre part, pour effet de déterminer un revirement d’opinion chez d’anciens partisans de la liberté des banques. En présentant en 1849 à l’Académie des sciences morales et politiques le volume de Coquelin, Ad. Blanqui disait : « Pour moi, je ne saurais aujourd’hui adopter cette conclusion (en faveur de la multiplicité des banques libres). À la veille des évènements de février, je soutenais, il est vrai, l’opinion contraire. Mais l’expérience qui vient de s’accomplir a modifié mes idées et je vois que la centralisation du crédit a des avantages. Elle prévient les inquiétudes qu’inspirent les billets des banques locales. Naguère encore, les billets des banques de Nantes, de Bordeaux, n’étaient pas reçus sans une certaine appréhension ; et cependant nous n’approchions point encore des États-Unis au point de vue de l’établissement des banques locales. » Ce rapport donnait naissance à une discussion dans l’Académie. Léon Faucher et Cousin se prononçaient dans le même sens que Blanqui. Dunoyer et de La Farelle[28], partisans de la liberté des banques indépendantes, repoussaient l’argument tiré de la récente expérience, laquelle, suivant eux, ne pouvait être concluante, à raison de la brièveté du temps écoulé et des circonstances dans lesquelles elle s’était produite. Gustave du Puynode, dans le Journal des Économistes, faisait remarquer que l’extension de la circulation des billets de banque était due avant tout au cours forcé et que Léon Faucher avait lui-même reconnu à la Chambre (22 novembre 1849) que cette mesure extraordinaire avait accru l’émission. Il ajoutait qu’il en aurait été de même avec les banques départementales, lesquelles, du reste, avant le 24 février, « s’abritaient derrière un privilège profitable. Non seulement elles n’avaient pas de concurrence à craindre dans les circonscriptions qu’elles exploitaient, mais elles n’avaient entre elles, non plus qu’avec la Banque de France, nulle relation, aucun lien, aucune attache… C’était le régime des anciennes douanes provinciales appliqué au crédit. » On pourrait remarquer encore que, même sans le cours forcé, la création de coupures de 100 francs et la suppression de ces douanes provinciales, en donnant au billet de banque la faculté de circuler sur tout le territoire, étaient de nature à développer la circulation.
Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que, malgré le succès qu’il obtint auprès des économistes, le volume de Coquelin n’ait pas eu le retentissement auquel il avait le droit de prétendre. Il n’est cependant pas tombé dans l’oubli. Les idées qui y étaient défendues ont fait du chemin. Même sous le régime du monopole, des barrières sont tombées et il n’est que juste de reporter l’honneur de la réalisation de ces progrès à celui qui soutint la cause de la liberté aux heures où la liberté était le plus étouffée.
V. L’Association pour la Liberté des échanges. — Le Libre-Échange. — L’organisation du travail. — Discours de Coquelin à la salle Montesquieu. — Le club de la liberté du travail. — Coquelin candidat. — Jacques Bonhomme. — Le Dictionnaire de l’Économie politique. — Mort de Coquelin. — Projets inexécutés. — Conclusion.
Quelque importante que soit l’œuvre doctrinale de Coquelin, elle ne constitue pas toute la part qu’il prit
à la défense des idées libérales. Lorsque se fonda, en 1846, l’Association pour la Liberté des échanges, Wolowski le présenta au comité dont le duc d’Harcourt était le président et Bastiat le secrétaire général et dont les membres s’appelaient Anisson-Duperron, Ch. Dunoyer, Ad. Blanqui, Denière, Léon Faucher, Horace Say, Renouard, Michel Chevalier, Riglet, Potonié, Paillottet, Peupin. Coquelin fut, avec Joseph Garnier et M. G. de Molinari, désigné pour remplir les fonctions de secrétaire adjoint et il ne tarda pas, par l’étendue et la variété de ses connaissances, par la rectitude de son jugement, à prendre une grande influence au sein du comité.
Le 29 novembre 1846 paraissait le premier numéro du Libre-Échange, titre qui s’accompagnait de ces devises : « La vie à bon marché. — On ne doit payer d’impôt qu’à l’État. — Les produits s’achètent avec des produits ». Le rédacteur en chef était Frédéric Bastiat. Coquelin est mentionné parmi les collaborateurs. Beaucoup d’articles sont anonymes ; on ne peut donc déterminer la part de collaboration courante de Coquelin. Mais il faut signaler l’étude en trois articles[29] qu’il publia sur l’un des défenseurs du protectionnisme allemand : Le Dr Frédéric List et sa doctrine, ainsi que la série de quatre articles intitulés : Les intérêts maritimes[30], dans laquelle il s’attacha à réfuter la réponse du comité protecteur de Paris à la Lettre de la Chambre de commerce de Bordeaux, réponse dans laquelle le comité Miremel prétendait que tous les traités de commerce ont été désavantageux pour notre marine et que l’égalité de conditions établie par ces traités a fait reculer notre pavillon.
On sait par la correspondance de Bastiat et par les ouvrages récents qui ont été publiés sur lui combien la rédaction du Libre-Échange avait fini par lui être à charge. Fatigué, malade, il prit le parti de l’abandonner et, pour la première fois, le numéro du 20 février 1848 porte la mention : « Le Rédacteur en chef gérant : Charles Coquelin ». Le journal ne parut pas le 27 février. Le numéro du 5 mars publie cette déclaration : « Rien n’est changé dans notre position ni dans notre marché. L’extension illimitée de la base électorale a singulièrement facilité le succès de notre cause. » Le même numéro publie sur l’organisation du travail un article ironique où sont raillées les promesses et les rêveries du sentimentalisme organisateur qui coûteraient trois ou quatre milliards d’impôts prélevés sur la propriété réalisée.
Les libéraux avaient l’illusion de croire que le premier acte de la démocratie serait de profiter de sa victoire pour renverser les barrières protectionnistes élevées dans le but de favoriser contre elle quelques intérêts particuliers. On avait assez dit que la monarchie était un régime ploutocratique, que le système censitaire avait concentré dans les mêmes mains le pouvoir politique et le pouvoir financier et que la formule de cet état de choses où une infime minorité composait le pays légal en face d’une nation réduite à l’impuissance se résumait dans le cri de Lamennais : « Silence aux pauvres ! » auquel on opposait, en le détournant de son véritable sens, le mot de Guizot : « Enrichissez-vous ! » Le règne des riches était fini. La masse populaire avait pâti des monopoles : les monopoles allaient être brisés !
Pour appeler l’attention publique sur cet ordre d’idées, l’Association faisait afficher le 12 mars un placard réclamant l’abolition des droits sur les denrées alimentaires. Mais la démocratie avait bien d’autres préoccupations. Elle attendait tout de l’organisation du travail, c’est-à-dire que, fidèle à une tradition pieuse, elle tendait vers l’État des bras suppliants comme à l’époque où le pouvoir royal était tout et la nation rien, sans se rendre compte qu’ayant, par des luttes séculaires, supprimé les pouvoirs qui la dominaient et conquis la liberté, elle n’usait de celle-ci que pour demander à des chefs improvisés de l’en débarrasser, de penser et d’agir pour elle. Cet ordre d’idées s’était à ce point imposé à l’opinion publique qu’elle n’admettait guère que d’autres questions fussent discutées. L’Association pour la Liberté des Échanges poursuivant sa campagne avait organisé le 15 mars un meeting afin de montrer combien le libre-échange était conforme aux intérêts de la démocratie. Coquelin, dont les qualités oratoires étaient remarquables et dont le premier discours, à la salle Montesquieu, le 7 janvier[31], avait obtenu le plus vif succès, était désigné pour prendre la parole. L’assemblée était présidée par Horace Say et Coquelin avait, à l’appui des réclamations de l’Association, insisté sur la prudence avec laquelle celle-ci ménageait les intérêts, même les préjugés des protectionnistes. Il avait montré qu’elle ne demandait un abaissement notable des droits sur la houille, le blé et les bestiaux que dans l’intérêt de tous sans que cet abaissement nuisît aux cultivateurs et aux mineurs, sans que les propriétaires de houille et de terre perdissent leur revenu naturel, mais seulement l’excédent de revenu que leur créait le monopole. Il avait fait valoir qu’en peu d’années de liberté nos industries, par la diminution des frais de production, par la division du travail, deviendraient aussi fortes que leurs rivales anglaises. Il avait soulevé un vif enthousiasme en s’élevant contre la pusillanimité des protectionnistes et en s’écriant qu’il « n’y a pas de raison pour penser que nous sommes de ce côté du détroit, 36 millions de crétins et que la vigueur, le génie, l’habileté et le courage sont de l’autre côté. »
Mais la discussion n’avait pas tardé à dévier vers le sujet qui passionnait tous les esprits. Se levant de
nouveau : « Mon opinion, s’écria Coquelin, c’est que l’organisation du travail est une question futile et émise par des gens qui n’ont pas réfléchi sur les premiers principes de l’économie politique. » Cette parole, véhémente autant que courageuse, car, ainsi que le remarque M. de Molinari, ces « gens-là » étaient alors tout-puissants, fut saluée par de chaleureux applaudissements et Coquelin, développant sa pensée dans une improvisation éloquente, s’attacha à montrer comment l’organisation naturelle de l’industrie, qui est le résultat de l’expérience des siècles, a été contrariée par les organisateurs de tous les temps, qui ont multiplié les abus qu’il faut supprimer aujourd’hui. Au premier rang de ces abus, Coquelin plaçait les entraves de l’administration douanière : « La liberté des échanges, poursuivait-il, est un des premiers moyens d’améliorer le sort de l’industrie et de la classe ouvrière. C’est un moyen palpable et tangible qui n’a rien de commun avec toutes ces théories en l’air dont on nous inonde. »
Il avait été décidé dans cette réunion qu’une démarche serait faite par le conseil de l’Association auprès du Gouvernement provisoire pour demander la suppression des droits sur le blé, la viande, la houille et le fer. La délégation, conduite par Horace Say, se rendit le 16 mars à l’Hôtel de Ville. Armand Marrast lui donna de belles paroles qu’aucun acte ne vint confirmer. Malgré ses efforts pour appeler l’attention sur les questions douanières, l’Association devait bien s’avouer qu’elle dépensait stérilement sa bonne volonté.
Elle se dissolvait et le dernier numéro de son journal paraissait le 16 avril 1848.
Quelques jours auparavant, Coquelin et quelques-uns de ses amis, parmi lesquels M. de Molinari, que l’on retrouve toujours quand il s’agit de défendre les idées libérales, avaient ouvert le Club de la liberté du travail dont l’inauguration eut lieu le 1er avril, et dont Coquelin fut le président. L’existence de ce club fut courte. Il eut, nous dit M. de Molinari, quelques séances pleines d’intérêt. Mais, un beau soir, il fut envahi par une troupe de communistes qui dispersèrent les amis de la liberté. Avant de se séparer toutefois, ils engagèrent Coquelin à se présenter aux élections qui étaient fixées au 23 avril.
Répondant à leurs instances, Coquelin se fit entendre dans une réunion électorale à la Douane où il eut, paraît-il, beaucoup de succès. Il adressait en même temps, aux électeurs de la Seine, la circulaire suivante :
« Citoyens,
« En venant solliciter vos suffrages comme candidat à la représentation nationale, j’obéis à un sentiment patriotique et aux conseils de plusieurs d’entre vous. Je ne le ferais pas cependant, si je ne me croyais suffisamment préparé par des travaux antérieurs à remplir utilement le mandat que vous m’auriez confié.
« Je ne suis qu’un simple écrivain, mais, comme tel, j’ai voué ma vie tout entière à l’étude des grandes questions qui intéressent la prospérité matérielle et la grandeur morale du pays. De ces questions, j’en ai traité plusieurs, particulièrement dans la Revue des Deux-Mondes où j’écris depuis près de dix ans. Il en est peu d’autres dont je n’ai fait, en divers temps, l’objet d’une étude sérieuse et d’un examen approfondi.
« Quoique livré par devoir et par goût aux travaux du cabinet, je n’ai pas laissé cependant de me mêler accidentellement aux travaux actifs de l’industrie, notamment dans les années 1839 à 1844, où, mettant
à profit quelques connaissances acquises et voulant rendre service à une industrie naissante, j’ai organisé et dirigé pendant un certain temps, pour le compte d’autrui, plusieurs établissements industriels. Cette circonstance m’a permis de joindre aux enseignements de la théorie les leçons puisées dans la pratique ; elle m’a appris en même temps à mieux connaître ces classes ouvrières vers lesquelles j’avais souvent tourné mes regards émus, et qui doivent être pour les hommes publics l’objet d’une sollicitude constante.
« Mes sympathies pour les classes ouvrières sont anciennes ; elles n’ont pas attendu la dernière révolution pour se produire. Plus d’une fois, j’ai réclamé en faveur de cette partie souffrante de la nation toutes les améliorations possibles. Mais, en la servant dans ses intérêts véritables, je ne l’ai jamais flattée dans ses préjugés ou ses erreurs.
« C’est avec raison, selon moi, qu’en France les ouvriers se plaignent. Leur condition n’est pas ce qu’elle pourrait et ce qu’elle devrait être. Il est très possible de l’élever et de l’améliorer. Mais en réclamant une part plus grande de jouissances et de bien-être, les ouvriers se trompent souvent sur les moyens de l’obtenir. Ils se trompent surtout quand ils mettent leurs intérêts en opposition avec les intérêts généraux de l’industrie dont ils sont foncièrement inséparables.
« C’est en agrandissant la sphère de l’industrie, en multipliant l’action des capitaux et du travail que l’on peut améliorer le sort des masses. Là où le travail abonde, la rémunération s’élève ; il n’y a pas d’autre voie qui conduise au même but. Mais est-il possible d’obtenir que le travail abonde constamment en France ? Je n’hésite pas à répondre : oui. Quant aux moyens d’y parvenir, ils sont nombreux et divers, mais ils se résument presque tous dans ce seul mot : Liberté.
« La liberté seule, la liberté du travail surtout, quand elle existera réellement en France, y accomplira des prodiges ; elle étonnera ses ennemis mêmes par sa fécondité. Mais nous en sommes fort éloignés encore et nous avons beaucoup à faire pour en recueillir tous les bienfaits.
« Il est un autre moyen d’augmenter le bien-être général : c’est d’alléger les impôts. On peut y parvenir en simplifiant les services publics et par d’autres procédés que j’ai indiqués dans un travail récent[32].
« À ceux qui me connaissent ou qui ont lu quelques-uns de mes écrits, je n’ai pas besoin de dire que je suis un ami de l’ordre, sans lequel il n’y a pas de bien-être ou de prospérité possible ; mais je conçois un ordre large et fécond, qui n’exclut ni la liberté ni le progrès, qui soit fondé sur toute autre chose qu’un système de compression, et qui résulte sans effort de l’heureuse harmonie de nos institutions futures.
« Homme nouveau dans la carrière politique, exempt de tout engagement envers le passé, je puis m’associer, sans arrière-pensée comme sans scrupule, à toutes les saines directions du passé et à toutes les espérances de l’avenir.
« Je crois à la possibilité d’établir en France une république démocratique, une république grande et forte, riche et prospère, qui réalise dans son sein cette heureuse alliance de l’ordre et de la liberté. Je ne me dissimule pourtant pas les difficultés de cette tâche dans la situation présente du pays et je n’oublie pas non plus que nos pères y ont échoué une première fois. Si ce n’est pas une raison pour désespérer du succès, c’en est une du moins pour apporter à cette grande œuvre une pensée mûre et pour mettre à profit toutes les leçons de l’expérience.
« Peut-être est-il de mon devoir d’ajouter à cela qu’une constitution républicaine me paraît devoir échouer en France tant qu’on n’y aura pas fondé sur une plus large base les institutions secondaires et particulièrement ces institutions locales dont le pays est dépourvu. Je crois que, dans un grand État, les institutions locales doivent entrer comme un élément essentiel dans l’édifice de la constitution politique, et que c’est surtout pour avoir méconnu cette vérité que la France n’a pu parvenir, depuis soixante ans, à fonder chez elle un ordre politique durable. »
Ch. Coquelin
9, rue de Provence.
Quelque judicieuse qu’elle pût paraître à une élite intellectuelle, cette circulaire n’avait rien d’entraînant pour les masses auxquelles on faisait de toutes parts les promesses les plus alléchantes. La foule ignorait Coquelin ; il se présentait seul et les élections avaient lieu au scrutin de liste. Il s’entendait peu à se faire valoir et dans la course au mandat il fallait jouer des coudes. Aussi ne semble-t-il pas qu’aucune suite ait été donnée à cette candidature. Le résultat intégral du dépouillement du scrutin ne figure pas dans le dossier conservé aux archives de la Chambre des députés. Le Moniteur relate le nombre de suffrages obtenus par ceux des candidats qui ont eu environ 5 000 voix et il ne fait pas mention de Coquelin. Quelques-uns de ses compatriotes voulaient le présenter dans le Nord. Le projet fut abandonné. Il est regrettable que Coquelin n’ait pas pris place dans la Constituante. Par ses facultés oratoires, par la rectitude de son jugement, par l’étendue de ses connaissances, par le libéralisme de son esprit, il y aurait certainement joué un rôle important et défendu avec chaleur les causes que la faible santé de Bastiat ne lui permettait, la plupart du temps, pas de soutenir.
Ne pouvant pas le seconder à l’Assemblée, Coquelin se joignit à lui, à Fonteyraud, à Joseph Garnier et à M. G. de Molinari pour reprendre en faveur de la liberté du travail la propagande interrompue par la dispersion du club. Le 11 juin 1848, ils fondaient tous les cinq un journal qui devait paraître deux fois par semaine : Jacques Bonhomme, titre qu’encadraient ces devises : « La vie à bon marché. — Il ne s’agit pas de raccourcir les habits pour en faire des vestes, mais d’allonger les vestes pour en faire des habits (Garnier Pagès l’ancien). —
Peuples, formez une Sainte-Alliance
Et donnez-vous la main (Béranger). »
Ce journal n’eut qu’une existence éphémère. Le numéro 4 et dernier parut le 9 juillet, après une suspension de quinze jours qu’explique l’insurrection de juin. Ici encore, l’absence de signature ne permet pas de préciser la part de collaboration de chacun. Notons cependant un article qui demande l’abrogation de la loi sur le taux de l’intérêt, de la loi sur les sociétés commerciales et du privilège de la Banque de France. Ces idées sont trop celles de Coquelin pour qu’il y ait aucun doute sur la paternité de l’article.
La disparition de Jacques Bonhomme marque la fin de la collaboration de Coquelin à des journaux de polémique. Après son étude « sur les douanes et les finances de la France », il ne donne plus à la Revue des Deux-Mondes qu’un article sur les crises commerciales et la liberté des banques dont il a repris une grande partie dans le dernier chapitre du volume à la préparation duquel il donne alors ses soins. En dehors de ce travail, il se renferme dès lors d’une part dans sa collaboration au Journal des Économistes et d’autre part dans la direction du Dictionnaire de l’Économie politique.
L’éditeur Guillaumin, qui était en même temps un économiste et qui a largement contribué au développement de la science économique, avait eu la pensée de réunir dans un ouvrage de proportions restreintes ce qu’il est le plus essentiel de connaître des principes de la science, des doctrines, des ouvrages et de la vie des économistes. L’entreprise était considérable car c’est, en définitive, l’histoire de l’économie politique et l’étude de toutes les questions qui ont trait à l’économie politique qu’il s’agissait de présenter en raccourci. Guillaumin était particulièrement bien placé pour mener à bien cette œuvre. Par sa maison d’édition, par le Journal des Économistes, il était en relations avec tous les hommes compétents et il peut aisément grouper les collaborateurs les plus éminents, parmi lesquels Hippolyte Passy, Léon Faucher, Ch. Dunoyer, Joseph Garnier, Horace Say, Léon Say, L. Reybaud, Baudrillart, Wolowski, Michel Chevalier, Courcelle-Seneuil, M. G. de Molinari, Coquelin et bien d’autres encore. La direction scientifique fut tout d’abord confiée à Ambroise Clément. Mais celui-ci ayant dû quitter Paris fut remplacé par Coquelin auquel, dans la préface de l’éditeur, Guillaumin rend hommage en ces termes : « Il a mis au service du Dictionnaire les brillantes qualités dont la nature l’avait doué et la science profonde qu’il avait acquise, une vaste mémoire, une raison sûre, une grande facilité de travail, une connaissance complète des chefs-d’œuvre de l’économie politique, un grand respect pour les fondateurs de la science, une saine appréciation des théories et une remarquable connaissance de l’industrie et des faits en général. »
Il ne semble pas que, sous la direction de Clément, la préparation du Dictionnaire ait dépassé les premiers articles de la lettre B. Dans cette partie, Coquelin avait déjà donné un assez grand nombre d’articles importants[33], dont celui de l’Acte de navigation auquel il avait consacré ses articles de début au Journal des Économistes et celui des Assignats, question connexe à celles qui l’avaient le plus particulièrement occupé.
A. Clément avait écrit un article sur la Balance du commerce. Il est à supposer que Coquelin ne jugea pas cet article suffisant pour réfuter cette théorie dont Bastiat en quelques lignes célèbres avait déjà montré l’inanité. Coquelin ajouta un nouvel article à celui de Clément, et se plaçant au point de vue qui lui était familier du crédit et de la circulation monétaire, il entreprit de soutenir cette opinion originale mais juste que toute demande nouvelle de numéraire se manifestant par un accroissement d’exportation et la cessation de ce besoin momentané entraînant un accroissement d’importation, il en résultait que ce qu’on appelle une « balance favorable » est « l’effet et le symptôme de la détresse d’un pays ». Il continuait en donnant cette recette que les partisans actuels de la balance de commerce pourraient méditer : « Voulez-vous procurer au pays une balance favorable ? Tuez-y le crédit ; faites que les banquiers n’escomptent plus, que les lettres de change, les billets à ordre, les billets de banque même n’y aient plus cours, qu’on ne puisse plus enfin y opérer aucune transaction qu’au comptant ; alors, le besoin du numéraire venant à augmenter dans une proportion considérable malgré la diminution de la somme des échanges, le commerce forcera ses ventes à l’étranger pour en appeler du dehors ; il y restreindra par la même raison ses achats et le résultat désiré sera atteint. Cet état de choses ne durera pas longtemps, il est vrai. Une fois ce besoin extraordinaire satisfait, l’équilibre naturel entre l’exportation et l’importation se rétablira ; mais vous aurez du moins le plaisir de croire, selon les données de votre système, que, durant ce temps, le pays s’est enrichi. »
À partir de cet endroit du Dictionnaire, les articles de Coquelin deviennent plus nombreux. C’est un labeur énorme qu’il fournit, se réservant tout ce qui a trait aux questions de banque, de circulation, de crédit, de finances publiques, sans parler des articles de doctrine générale comme le mot : Économie politique. Son article : Banque forme un véritable traité dont certaines parties sont même plus développées que les morceaux correspondants de son volume spécial, à ce point que, dans les dernières éditions de celui-ci, Courcelle-Seneuil a substitué la rédaction du Dictionnaire au texte primitif pour tout ce qui concerne les banques antérieures à celle d’Angleterre.
En dehors de cette part de travail personnel, il est visible que Coquelin exerçait un contrôle actif sur les articles de ses collaborateurs, car cette œuvre faite de l’assemblage de morceaux détachés frappe par son caractère d’unité et par la coordination de l’ensemble. Il est piquant de constater qu’une notice biographique est erronée, c’est celle qui concerne Coquelin lui-même. Le Dictionnaire lui donne pour date de naissance le 27 novembre 1805.
Coquelin n’eut pas la satisfaction de voir l’achèvement de cet ouvrage auquel il avait donné tant de soins et où il avait mis tout ce qu’il avait amassé d’érudition au cours de vingt-cinq ans de travail et de méditation. Son dernier article est le mot : Instruments du travail et de l’industrie.
Il mourut le 12 août 1852[34], emporté en quelques jours par un rhumatisme articulaire. Il n’avait pas cinquante ans !
Il succombait au moment où, après une longue période de luttes, il pouvait à bon droit penser que la route allait s’ouvrir plus large et plus facile devant lui. Il avait conquis une grande notoriété. Ses travaux l’avaient placé haut dans l’estime de la science, et il projetait d’autres ouvrages qui, rapidement, auraient mis le sceau à sa réputation. Non seulement il se proposait de refondre entièrement son volume Le Crédit et les Banques qui ne le satisfaisait pas, malgré le succès qu’il avait obtenu, mais il réunissait les matériaux d’une Histoire des Banques, après laquelle il avait l’intention d’écrire un traité d’économie politique qui aurait été comme le résumé des études et des méditations de sa vie. Sa grande facilité de travail lui aurait permis d’accomplir en peu d’années cette tâche dont les matériaux s’étaient amassés et classés dans son esprit au cours de sa carrière. Il avait encore un ouvrage tout prêt sur la pairie ou Chambre haute. La Révolution de 1848 — qui s’y trouvait prédite — l’avait empêché de le publier ; mais il comptait le reprendre en le modifiant. Il y décrivait le fonctionnement rationnel du gouvernement représentatif et il y signalait les inconvénients du régime parlementaire qu’il considérait cependant comme préférable à tous les autres. À la valeur intrinsèque des idées, un tel livre aurait joint celle d’un bel acte de courage civique, d’une protestation du droit et de la conscience contre la violence triomphante. À ce moment où la compression était portée à son comble, où la dictature renversait la tribune et supprimait la presse, où la liberté était détruite, Coquelin ne songeait-il pas encore à décrire et à comparer les institutions civiques, politiques et économiques de la France et des États-Unis, et à faire ressortir la nécessité d’établir en France de fortes institutions municipales et départementales. Il est bien vraisemblable que l’exposé d’idées aussi subversives aurait valu à Coquelin la fréquentation des procureurs impériaux, et qu’au lieu du repos du foyer domestique qu’il se préparait à goûter par l’union avec une compagne de son choix, il aurait connu le régime de Sainte-Pélagie, sinon même les rigueurs de la loi de sûreté générale.
Si la mort aveugle a pris cet ardent défenseur de toutes les libertés au moment où la liberté avait le plus besoin d’être défendue, si elle l’a empêché de joindre sa voix aux voix éloquentes qui s’élevèrent en faveur du droit, si, même dans l’ordre des études économiques, elle ne lui a pas laissé le temps de remplir toute sa destinée et de prendre le rang auquel il pouvait légitimement prétendre, il en a fait assez cependant pour que son nom soit sauvé de l’oubli. Il a semé des idées qui ne sont pas descendues dans la tombe avec lui, qui, au contraire, ont grandi et se sont transformées sous la poussée de circonstances que la prévoyance humaine ne peut jamais connaître. Elles subiront sans doute encore d’autres transformations dans l’application. Mais ces transformations ne leur ont enlevé ni ne leur enlèveront rien de leur justesse fondamentale. Elles ne diminuent pas l’honneur qui revient à Coquelin d’avoir eu confiance dans la liberté et d’avoir montré que celle-ci, par le jeu naturel des forces qui s’équilibrent et se compensent, assure la véritable solution des problèmes que les réglementations restrictives rendent régulièrement plus ardus. Dans la lutte engagée de son temps et qui se poursuit, peut-être plus âprement encore sous nos yeux, entre l’esprit de monopole, l’étatisme, le protectionnisme, le socialisme déclaré ou dissimulé, d’une part, et les idées libérales de l’autre, il a vaillamment, sans une heure d’hésitation et de faiblesse, soutenu le bon combat. Ceux qui le soutenaient avec lui n’étaient pas les plus nombreux. Ceux qui le soutiennent à l’heure présente sont encore en minorité. Raison de plus pour que nous rendions à nos morts un hommage mérité et que nous honorions pieusement leur mémoire.
APPENDICE
Liste des articles de Charles Coquelin
REVUE DES DEUX-MONDES
| De l’industrie linière en France et en Angleterre | 1er et 15 Juillet 1839 |
| Du crédit et des banques dans l’industrie | 1er Septembre 1842 |
| Des sociétés commerciales en France et en Angleterre | 1er Août 1843 |
| Des monnaies en France et d’une Réforme de notre régime monétaire | 15 Octobre 1844 |
| De la conversion de la Rente
|
1er Avril 1845 |
| Les chemins de fer et les canaux : I. De la rivalité des chemins de fer et des canaux en France, en Angleterre et en Belgique | 15 Juillet 1845 |
| II. Des travaux de canalisation
|
15 Septembre 1845 |
| La question des céréales en France et en Angleterre | 1er Décembre 1845 |
| Du commerce extérieur de la France
|
15 Mars 1846 |
| La Liberté du commerce et les systèmes de douane : I. Le système restrictif et l’industrie française | 15 Août 1846 |
| II. Les douanes et la politique commerciale des principaux États | 1er Septembre 1846 |
| III. L’industrie des houilles et des fers
|
15 Janvier 1847 |
| IV. L’industrie métallurgique en France | 1er Mars 1847 |
| V. L’agriculture et les produits agricoles | 1er Mai 1847 |
| Les douanes et les finances de la France ; de l’accroissement possible des recettes et de la révision des tarifs : I. Principes généraux d’une réforme douanière | 1er Mai 1848 |
| II. Analyse du tarif et diminutions praticables | 15 Mai 1848 |
| III. Des denrées coloniales comme sources de revenu | 15 Juin 1848 |
| Les crises commerciales et la liberté des banques | 1er Novembre 1848 |
JOURNAL DES ÉCONOMISTES
| Tome | Page | |
| Des lois de navigation en Angleterre, leurs dispositions essentielles, leur altérations successives et leur état actuel | XVII
XVIII |
376
12 |
| Discours à la séance de l’Association pour la liberté des échanges | XIX | 213 |
| Deuxième séance publique de 1848 (15 mars), salle Montesquieu | 409 | |
| L’organisation du travail et la liberté | XX | 3 |
| Compte-rendu de : Du crédit et de la circulation de M. Cieszkowski | XXI | 71 |
| Les machines à l’exposition des produits de l’industrie en 1849 | XXIV | 58 |
| Compte-rendu de l’Aperçu sur les intérêts matériels dans le Midi de la France | 197 | |
| Opinion sur les fonctions naturelles de l’État | 315 | |
| Encore un mot sur les machines, les fils, etc., à l’exposition | 352 | |
| Compte-rendu des Soirées de la rue Saint-Lazare par M. G.de Molinari | 364 | |
| Du crédit et des banques, apprécié par Ad. Blanqui | 383 | |
| Opinion sur les fonctions de l’État | XXV | 205 |
| Des associations ouvrières et des associations en général ; appréciation du rapport de M. Lefebvre-Duruflé ; de la proposition de MM. Nadaud, Morellet, etc. | 341 | |
| À propos de la situation de la Banque de France | XXVI | 1 |
| De la prétendue décadence de la France et de l’Angleterre et des ouvrages de MM. Raudot et Ledru-Rollin | XXVII | 56 |
| Notice sur les Banques de l’État de New-York | 235 | |
| Opinion sur l’intervention de l’État dans l’organisation des institutions de crédit foncier | 309 | |
| Introduction à la dixième année du Journal, 1851 | XXVIII | 1 |
| De la dépréciation de l’or et du système monétaire français | 55 | |
| La marine anglaise en 1850. Conséquences de l’acte d’abrogation des lois de navigation | 358 | |
| Compte-rendu sur le sol et la haute banque ou les intérêts de la classe moyenne de M. P. Coq | XXIX | 169 |
| Analyse des écrits de M. Carey au sujet de la rente | XXX | 298 |
| Compte-rendu de l’Idée générale de la Révolution au XIXe siècle par M. Proudhon | 359 | |
| Compte-rendu des Lettres sur l’Exposition universelle de Londres d’Ad. Blanqui | XXXI | 87 |
| Compte-rendu des Moyens proposés pour améliorer le sort des ouvriers agricoles et mettre un terme à la dépopulation des campagnes par le colonel Répécaud | 91 | |
| Ses observations sur la question de la rente | 98 | |
| Sur les sociétés de crédit foncier | 337 | |
| Note et réponse à M. Carey | XXXII | 89 |
| Compte-rendu sur la Suède et son commerce de M. Knut Bonde | 129 | |
| Compte-rendu des États-Unis d’Amérique par M. S.-G. Goodrich | 415 | |
| Sa mort | 419 | |
| Notice sur sa vie et ses écrits par M. G. de Molinari | XXXIII | 167 |
| Sa mort est annoncée à la Société d’économie politique | 177 | |
| Part qu’il a prise au Dictionnaire de l’Économie politique | XXXVII | 431 |
DICTIONNAIRE DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE
Acte de navigation
Adjudication
Agents naturels
Agio
Aides
Alliage
Annuité
Anticipation
Appropriation
Arbitrage
Artisans
Assignats
Ateliers nationaux
Balance du commerce
Banque
Billet à ordre
Billet de Banque
Billet de l’Échiquier
Bons de Trésor
Brevets d’invention
Budget
Cabotage
Cadastre
Caisse d’amortissement
Caisse des dépôts et consignations
Caisse d’épargne — L. Leclerc et Coquelin
Capital
Centralisation
Circulation
Clearing House
Coalitions industrielles
Commerce
Commune
Compagnie anglaise des Indes Orientale — J. B. S. et Ch. C.
Compagnies privilégiées
Concurrence
Contrainte par corps
Corporations privilégiées
Cours forcé
Crédit
Crises commerciales
Dimanche
Distribution des richesses
Domesticité
Droits réunis
Échange
Écoles professionnelles
Économie politique
Effets de commerce
Effets publics
Embargo
Emphytéose
Encouragements
Épaves
Établissements de bienfaisance ;
État
État-civil
Évaluation des sommes historiques
Fermage
Fonds productifs
Fortune publique
Frais de production
Franchise
Gabelle
Greniers d’abondance
Harmonie industrielle
Hérédité
Industrie
Industrie manufacturière
Instruction publique et privée — Vergé et Ch. C.
Instruments du travail ou de l’industrie.
_______________
[1] Cette date a été relevée sur les registres de l’état-civil de Dunkerque.
[2] Jacques-François Coquelin — le nom est orthographié Coquelin à l’état civil — est mort à Dunkerque le 12 décembre 1844. Son acte de décès le qualifie rentier.
[3] Elle était fille de cultivateurs. Elle mourut à Dunkerque le 8 novembre 1858 à l’âge de 82 ans.
[4] Édouard-Romain Coquelin, né à Dunkerque, le 11 avril 1820. Nommé juge de paix à Alger le 10 septembre 1846, il quitte la magistrature au 2 décembre 1851 et exerça la profession d’avocat à Saint-Omer et à Douai. Réintégré comme juge à Lille le 7 août 1877, il prit sa retraite en mai 1890 et mourut en 1898. Son fils, M. Maurice Coquelin, est actuellement avocat à la Cour de Paris.
[5] Septembre 1852. Cette notice a été reproduite en tête des éditions ultérieures du volume : Le crédit et les banques.
[6] Nous devons à l’obligeance du proviseur du lycée de Douai l’énumération des récompenses scolaires de Coquelin :
- Classe de sixième. — 1er prix de version latine ; 2e accessit de thème latin.
- Classe de cinquième. — Prix d’excellence ; 2e prix de version latine ; 1er accessit de thème latin.
- Classe de quatrième. — Prix d’excellence ; 1er prix de version latine ; 5e accessit de version grecque.
- Classe de troisième. — 2e prix de version latine ; 1er accessit de version grecque.
- Classe de seconde. — 1er prix de narration française ; 1er prix de vers latins ; 2e accessit de version latine ; 4e accessit de version grecque ; 4e accessit d’histoire et géographie.
- Rhétorique. — 1er accessit de discours latin ; 1er prix de discours français ; 1er prix de version latine.
On peut constater que Coquelin ne fut pas un élève précoce. Les évènements de l’époque inspiraient sans doute aux familles, surtout dans les régions voisines de la frontière, de vives anxiétés lorsqu’il s’agissait d’envoyer leurs enfants à une grande distance.
[7] L’exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale (V.3.382) est incomplet ; les nos du 18 décembre 1827 au 19 février 1828 manquent.
[8] Son fils, Adolphe Coste, a été un économiste de valeur. Il faisait partie de la Société d’Économie politique depuis 1883. Il est mort en 1901.
[9] Le Temps des 29 septembre, 15 et 22 octobre et 1er novembre 1832.
[10] Le premier numéro du Monde est du 16 novembre 1836 ; le dernier est du 1er novembre 1837.
[11] Cette étude forma deux articles. Le second est du 14 février 1839.
[12] 1er et 15 juillet 1839.
[13] Essai sur la filature mécanique du lin et du chanvre, par Charles Coquelin, Paris, Carillon jeune, éditeur, 1840, 1 vol. in-8°.
[14] Nouveau traité complet de filature mécanique du lin et du chanvre, par Charles Coquelin, avec 37 planches gravées en taille-douce sur les dessins fournis par M. P. Decoster, mécanicien-constructeur. — Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1846. Un vol in-8° et un album (Bibliothèque nationale, V. 35324).
[15] Voir à l’appendice in fine.
[16] Livraison de juillet et août 1847.
Voir à l’appendice la liste des articles de Ch. Coquelin dans le Journal des Économistes.
[17] Voir Journal des Économistes, 15 novembre, 15 décembre 1840, les articles de Paillottet : De l’encouragement aux associations ouvrières voté par l’Assemblée constituante. Paillottet y signale les formalités tracassières du fisc et souhaite une réforme de la législation sur les sociétés commerciales « suivant les principes exposés par M. Coquelin dans la Revue des Deux-Mondes en 1843 ».
[18] Voir Frédéric Bastiat par Georges de Nouvion, p.248-251.
[19] Journal des Économistes, janvier 1851.
[20] Journal des Économistes, juin 1851.
[21] La deuxième partie fut publiée dans le numéro de novembre 1851.
[22] Ce chapitre a été lu à l’Académie des sciences morales et politiques dans sa séance du 17 août 1907.
[23] 1er septembre 1843.
[24] Notamment Journal des Débats, 4-11 février 1864.
[25] Journal des Économistes, janvier 1864.
[26] Revue des Deux-Mondes, 1er janvier 1864.
[27] Publiés tous deux en 1864.
[28] Correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques pour la section d’économie politique. Magistrat démissionnaire en 1830, avocat à la Cour de Nîmes, député du Gard de 1842 à 1848, F. de la Farelle a publié quelques articles dans le Journal des Économistes. Son ouvrage : Du progrès social au profit des classes populaires non indigentes, remporta à l’Académie française le prix Montyon. Il a également publié : Coup d’œil sur le régime répressif et pénitentiaire des principaux États de l’ancien et du nouveau monde et : Plan d’une réorganisation disciplinaire des classes industrielles de la France, ouvrage dans lequel il proposait l’établissement d’un régime analogue à celui des maîtrises et des jurandes. Félix de La Farelle a été l’un des premiers membres de la Société d’Économie politique. Il est mort en 1872, âgé de 70 ans.
[29] 11 et 18 avril, 23 mai 1847.
[30] 4, 11, 18 et 25 juillet 1847.
[31] Ce discours a été reproduit partiellement, avec ceux de Joseph Garnier et de Bastiat dans le Libre-Échange du 9 janvier 1848 et le compte rendu de la séance, la septième de l’Association, a été publié par le Journal des Économistes (tome XIX). C’était la première fois que Coquelin prenait la parole en public.
[32] La série des cinq articles de la Revue des Deux-Mondes intitulée : « La liberté du commerce et les systèmes de douane ».
[33] Voir à l’appendice la liste des articles de Coquelin.
[34] Au moment de sa mort, Coquelin habitait aux Batignolles, 22 rue d’Antin. Après l’annexion des communes suburbaines le nom de cette rue fut changé (décret du 24 août 1864). C’est aujourd’hui la rue Biot. Coquelin fut inhumé le 13 août 1852 au cimetière des Batignolles. La Société d’Économie politique était représentée aux obsèques par Ch. Dunoyer, président, H. Say, Renouard, Louis Reybaud, Joseph Garnier, Wolowski. Sur la tombe, Ch. Dunoyer prononça une allocution qui a été reproduite dans le Journal des Économistes (septembre 1852). Le numéro du mois d’août publiait un article de Coquelin sur l’ouvrage de Goodrich : Les États-Unis d’Amérique et, à la page suivante, Joseph Garnier commence sa chronique en annonçant la mort de son collaborateur : « C’était, dit-il, un esprit lucide et ferme, un caractère plein de droiture et de noblesse ; il mettait au service de la vérité en général et des idées économiques en particulier une âme ardente, un cœur généreux et d’éminentes facultés. Peu de temps lui eût encore été nécessaire pour être connu comme une des illustrations scientifiques de notre époque. »
À la Société d’Économie politique, la mort de Coquelin fut annoncée le 10 septembre 1852 par Horace Say qui présidait la séance et qui rendit hommage à « l’homme au cœur droit, aux convictions profondes, qui savait revêtir sa pensée d’une forme élégante et précise. Nous avons perdu, dit-il, un précieux collaborateur. Nous regretterons toujours en lui un bon confrère et un excellent ami. »


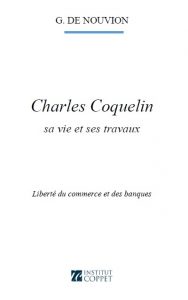
Laisser un commentaire