 CHARLES COMTE, ancien secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques.
CHARLES COMTE, ancien secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques.
Par M. Mignet
Notice lue dans la séance publique du 30 mai 1846.
Messieurs, il y a bientôt dix ans que vous avez perdu votre premier secrétaire perpétuel. La mort, le frappant au milieu de ses travaux et lorsqu’il était encore dans toute sa force, l’a enlevé en même temps que ces célèbres vieillards, parvenus au terme de leurs jours comme de leurs œuvres, dont la plupart appartenaient à l’ancienne Académie, et qui tous illustraient la nouvelle. Ces représentants d’un autre âge, ces fondateurs laborieux de l’ordre social moderne et du droit commun, ces auteurs agités de notre expérience, devaient recueillir les premiers nos hommages et vos regrets; ainsi le voulaient l’importance de leurs services et l’antériorité de leur renommée.
J’aurais même incliné, je ne le cacherai pas, à vous entretenir de tous ceux de nos confrères auxquels se rattache le souvenir des grands événements de notre récente histoire, avant de retracer la vie des hommes plus jeunes qui leur ont succédé dans la carrière de la science ou de la politique ; mais il m’a paru qu’il convenait de ne pas différer davantage l’éloge de celui d’entre eux que, par un libre choix, vous aviez appelé aux fonctions de secrétaire perpétuel, et que j’ai eu pour prédécesseur dans votre confiance. D’ailleurs, M. Charles Comte, que la générosité de ses doctrines et l’énergie de sa conduite rapprochent des penseurs du dernier siècle et des acteurs de la Révolution, a naturellement sa place dans leur compagnie, qu’il ne dépare pas par ses talents, et qu’il honore par son caractère.
Entré dès 1804, avec l’ardeur de la jeunesse, dans les voies où la fatigue et les déceptions venaient d’arrêter ses devanciers, il y a marché d’un pas hardi et ferme tant qu’il a vécu. Adversaire déclaré du pouvoir militaire sous l’Empire, défenseur courageux des institutions populaires sous la Restauration, il s’est montré polémiste indomptable dans la presse, dont il a, plus qu’un autre, contribué à rétablir l’indépendance, théoricien inflexible dans ses ouvrages, où, à la philosophie du dix-huitième siècle, il a ajouté la science du dix-neuvième, et il lie en quelque sorte la génération qui a opéré la conquête révolutionnaire des droits sociaux de notre pays -à la génération qui a procédé au rétablissement régulier de ses libertés légales.
François-Charles-Louis Comte naquit le 25 août 1782, à Sainte-Énimie, très-petite ville située dans la partie la plus montagneuse de la Lozère. Sans être riche, sa famille possédait quelques modestes domaines, dont elle surveillait la culture, et qui suffisaient à ses besoins. Le père du jeune Comte passait une partie de son temps à la chasse, avec les seigneurs du voisinage, lorsque la Révolution vint faire de ses nobles compagnons des émigrés, et, de lui, le chef de la garde nationale du canton.
Ayant, vers cette époque, perdu sa femme, il se consacra tout entier à l’éducation de ses quatre enfants. Mais il fallait, au milieu du désordre intellectuel de 1793, leur donner une instruction dont les anciennes sources étaient alors taries, sans que les nouvelles fussent encore ouvertes. Charles Comte avait déjà onze ans. Son père l’envoya, avec un frère un peu moins âgé que lui, a Salmon, sur une haute montagne couverte de neige pendant plus de six mois de l’année, auprès d’un prêtre fugitif, de qui il reçut les premières notions de grammaire, de latinité, de géographie et d’histoire. Son esprit ardent et avide se jeta avec une passion singulière sur cette science imparfaite, qu’il fut réduit à chercher, pour ainsi dire, de prêtre en prêtre, jusqu’à ce que, les écoles centrales ayant été instituées, il se rendit à Mende pour y compléter ses éludes.
Élevé par un père de mœurs rigides, formé, par la lecture assidue de Plutarque, à l’admiration des grands hommes les plus austères de la Grèce et de Rome ; de bonne heure aux prises avec des difficultés qui fortifient l’âme lorsqu’elles ne l’abattent point, Charles Comte vit se développer en lui les plus énergiques comme les plus nobles qualités : un courage à toute épreuve, une franchise un peu rude, une honnêteté Hère et forte, le respect du droit, le dévouement à la liberté et à la justice. Il donna une preuve bien précoce de l’indépendance de son caractère en 1804. À cette époque, comme on le sait, l’établissement de l’Empire fut mis aux voix. Désiré par le grand homme qui gouvernait si heureusement et si glorieusement la France depuis quatre années, adopté par tous les corps de l’État, l’Empire dut, en outre, recevoir l’approbation du peuple, qui, par besoin de stabilité autant que par admiration et par reconnaissance, lui accorda l’imposante sanction de plus de trois millions de suffrages. Le jeune Comte, à peine devenu majeur et entré en possession du droit de voter, fut au nombre des citoyens rares qui résistèrent à l’élan universel. Il trouvait qu’il y avait dans la république consulaire suffisamment d’ordre pour l’État, suffisamment de pouvoir pour le chef, et qu’une grande nation ne doit pas acquitter sa reconnaissance par sa servitude. Avec toute l’énergie de son âge et une jalousie de la liberté qui ressemblait à de la prévoyance, il se prononça contre l’Empire, déposant sur le registre public le témoignage d’une opposition alors impuissante, mais que devait suivre, plus tard, une autre opposition non moins hardie et plus heureuse.
En attendant le jour où la nation sortirait encore une fois de tutelle, jour qu’aucune clairvoyance ne pouvait entrevoir, M. Comte se rendit en 1806 à Paris, où il se forma dans la science du droit. Il se fit recevoir avocat, et il prit part à la rédaction du célèbre recueil d’arrêts que publiait M. Sirey, pour exposer la jurisprudence régulatrice de la cour suprême. Sou activité entreprenante se porta sur des travaux de nature bien diverse. On ne peut pas dire qu’il eut beaucoup d’imagination. Mais qui n’en a pas un peu dans la jeunesse ? Aussi, sans être précisément emporté par la sienne, M. Comte chercha quelquefois dans la poésie des délassements à l’étude sévère des lois. Selon l’usage du temps, il composa même sa tragédie.
Fidèle à ses sentiments politiques jusque dans ses distractions littéraires, il prit son sujet chez le peuple dont la liberté avait fait la grandeur ; remontant au berceau de la république romaine, il mit en cinq actes, et en vers, l’expulsion si morale et si dramatique des Tarquins. Sa pièce ne pouvait guère alors être jouée. Méritait-elle de l’être? Je l’ignore ; mais je me permets d’en douter. L’esprit plus sérieux que poétique de M. Comte et son talent, plus vigoureux qu’orné, l’appelaient sur une autre scène, et lui réservaient d’autres succès. Il dit donc aux muses un adieu qui ne dut pas être trop pénible pour lui, et il ajourna même un ouvrage considérable auquel il travaillait sur les législations, pour s’engager, en 1814, dans les mémorables luttes qu’il entreprit, a son éternel honneur et à notre grand avantage, en faveur des libertés publiques.
L’Empire venait de finir. Le dictateur militaire que son génie et la Providence avaient appelé à fonder sur ses vraies bases civiles la société de la Révolution en France, à défendre, en l’étendant, le principe de la Révolution en Europe, avait succombé à l’excès de ses entreprises. Il avait succombé, comme avait péri naguère le gouvernement républicain, qui, chargé de renverser toutes les barrières élevées dans le moyen âge contre la liberté humaine, avait voulu pousser si loin les effets de cette liberté, qu’il avait été contraint d’en suspendre l’usage, et avait brisé une fois de plus la démocratie triomphante sur l’écueil connu de l’anarchie. Mais la République et l’Empire n’avaient disparu qu’après avoir duré plus d’un quart de siècle. Ils avaient laissé à la France : la République, le souvenir de son droit ; l’Empire, le souvenir de sa force, et tous deux y avaient développé des intérêts indestructibles, créé des institutions civiles impérissables, fait naître des sentiments invincibles, l’amour de l’égalité et l’orgueil de la gloire.
C’est ainsi que la nation de 1780 et de 1804 entra en 1814 dans la nouvelle série d’épreuves qu’elle avait à traverser. Au moment où elle fut ramenée à la liberté par la mauvaise fortune, M. Comte, ayant conservé les patriotiques sentiments et les généreuses pensées de la Révolution, éleva un des premiers la voix pour redonner l’amour des institutions libres aux générations qui l’avaient perdu, et l’apprendre aux générations qui ne l’avaient point encore éprouvé. La charte, œuvre d’une prudence habile et d’une nécessité nationale, venait à peine d’être promulguée, qu’elle était en butte aux mépris et aux agressions d’un parti inconsidéré, qui ne sut pas y voir l’indispensable contrat d’union entre la France nouvelle et l’ancienne famille de ses rois. C’est pour combattre les doctrines et les écarts de ce parti, pour s’opposer aux mesures arbitraires, pour résister aux mouvements rétrogrades d’un pouvoir ramené, par la nature et l’origine de son droit, aux souvenirs comme aux pratiques du passé, que M. Comte, trois jours après la promulgation de la charte, publia, le 12 juin 1814, le Censeur, journal destiné à paraître toutes les semaines.
« Les journaux , dit-il fièrement en annonçant son dessein, pourraient être d’une grande utilité; mais la haute importance qu’ils attachent à de simples discussions littéraires, l’indifférence qu’ils ont pour tout ce qui tient à la morale ou à la législation, et l’habitude qu’ils ont contractée de l’adulation ne permettent pas d’espérer qu’ils s’occuperont d’éclairer les citoyens sur leurs véritables intérêts. Ce qu’ils ne font point, j’ose l’entreprendre. » Il se servit en effet de cette liberté hardie, ombrageuse, qui, à l’aide de la presse, recueille les plaintes, garde les droits, expose les besoins, propage les idées, de mille sentiments divers forme l’opinion générale ; liberté qui agile quelquefois les peuples, mais les élève et les fortifie; contredit les gouvernements, mais leur est encore plus utile qu’incommode, par la retenue qu’elle leur impose et les fautes qu’elle leur épargne ; et qui, malgré ses erreurs et ses injustices, conduit à la longue par la discussion a la vérité, par la défense du droit de chacun à la justice pour tous, ne laisse pas les désirs publics trop longtemps méconnus éclater en passions irrésistibles, et prépare lentement les réformes qui préservent les États des révolutions. Personne n’en fit usage avec plus de courage et d’honnêteté que M. Comte. Il se considéra comme investi d’une magistrature véritable, qu’il exerça en prenant la loi pour règle et le patriotisme pour guide.
Il attaqua tout d’abord deux ordonnances, dans lesquelles le directeur général de la police prescrivait a tous les habitants du royaume, quelle que fût leur croyance, et sous des peines qu’il déterminait lui-même, de prendre part à certaines cérémonies extérieures de la religion catholique, et d’observer scrupuleusement les dimanches et les fêles. Dans une adresse aux Chambres, M. Comte le dénonça comme ayant violé la charte, attenté à la liberté des cultes, usurpé l’autorité législative, créé arbitrairement des délits, établi tout seul des impôts en inventant des amendes ; et il obligea le gouvernement à demander une loi qui rendît ces mesures plus régulières, sans les rendre plus faciles à exécuter.
La liberté de la presse fut moins respectée encore que la liberté des cultes. Avec ce sophisme de langage, dont l’esprit se contente lorsqu’il profite à l’intérêt, le gouvernement soutint que prévenir les abus de la presse était la même chose que les réprimer, et il rétablit la censure par ordonnance. Cette étrange interprétation de l’article 8 de la charte, à laquelle tous les journaux se résignèrent, trouva M. Comte moins docile. Elle était fausse, il la réfuta; illégale, il lui désobéit. Tandis que les autres feuilles périodiques ne paraissaient qu’après avoir subi l’examen et les mutilations de la censure, lui continua à publier la sienne avec la même indépendance. Pendant plusieurs mois il demeura seul en possession de la liberté de la presse, comme d’un privilège de son courage.
Le gouvernement fut contraint de nouveau, par cette noble résistance, de renoncer au régime arbitraire des ordonnances. Il eut recours aux Chambres. Celles-ci ayant décidé à leur tour que prévenir signifiait réprimer, et que la charte avait permis d’écrire avec liberté dans un volume au-dessus de vingt feuilles d’impression, mais l’avait défendu dans un journal, M. Comte, qui avait bravé une ordonnance, dut se soumettre à une loi. Mais s’il se montra obéissant, il sut rester libre. Le Censeur prit la forme d’un volume ; il parut a des époques régulières, quoique non rapprochées, et M. Comte y poursuivit ces salutaires discussions qui devaient servir si puissamment a l’éducation constitutionnelle de notre pays.
Il ne les poursuivit pas seul. Il s’était associé, depuis la publication du second cahier du Censeur, un ami de sa jeunesse, un compagnon de l’École de droit, que l’amour de la liberté avait rendu tout aussi contraire a l’Empire, et que des relations de famille faisaient pencher un peu plus vers la Restauration ; un disciple, ainsi que lui, des doctrines du dernier siècle, doué de la même bonne foi, soutenu par la même constance, servant la même cause avec un dévouement semblable et un talent égal, M. Dunoyer, auquel il était réservé d’entrer en même temps que M. Comte dans votre compagnie, et de présider la séance où serait prononcé cet éloge qui est en grande partie le sien.
Le Censeur, que publièrent ensemble ces deux hommes de courage et de bien, eut un succès extraordinaire. On l’attendait avec impatience; on le lisait avec avidité. Instructif comme un livre, amusant comme un journal, tout rempli de savantes doctrines, tout empreint de la verve passionnée de ses deux rédacteurs, il offrait un habile mélange des enseignements les plus sérieux et des discussions les plus animées. L’histoire avec ses utiles exemples, la philosophie avec ses droites maximes, la législation avec ses règles tutélaires, la haute politique avec ses intérêts moraux, la grande critique littéraire avec ses belles directions, comparaissaient dans chaque volume à côté des débats des Chambres, vivement rendus et librement jugés, des actes des ministres sévèrement discutés, des entreprises de l’émigration hardiment combattues, des intolérances du clergé publiquement dénoncées, et de tous les droits nouveaux intrépidement soutenus. MM. Comte et Dunoyer s’y étaient faits les avocats des libertés comme des gloires récentes.
C’est alors qu’un des vaillants serviteurs de l’Empire, le lieutenant général Exelmans, mis en demi-activité et relégué loin de Paris, pour avoir écrit à un roi qui avait été son bienfaiteur et son chef, frappé d’arrestation pour n’avoir pas obéi à cet ordre d’exil, traduit devant un conseil de guerre pour s’être soustrait à une détention qu’il considérait comme arbitraire, chargea M. Comte de défendre en sa personne la liberté d’un citoyen et l’honneur d’un soldat. M. Comte l’avait déjà fait avec force dans le Censeur : il le fit avec succès devant le conseil de guerre de Lille. Les juges ne l’écoutèrent pas sans faveur. Convaincus par la solidité de ses raisons, entraînés par les nobles paroles de l’accusé, ils prononcèrent un acquittement unanime.
Ce procès fut un événement. Il émut le public, il agita l’armée. Celle-ci, privée de ses glorieuses couleurs, blessée dans son orgueil par de maladroites préférences et la consécration de souvenirs injurieux pour elle, frémissait en silence, prête, si l’occasion s’en offrait, à faire éclater ses redoutables mécontentements. M. Comte s’en aperçut bien; il demanda avec anxiété et ironie si on voulait par la préparer le retour de l’exilé de l’île d’Elbe.
Il revint, en effet, cet ancien élu du peuple, ce chef regretté des soldais, lorsqu’il crut qu’assez de fautes lui avaient de nouveau frayé la voie du trône, et que la France ne verrait en lui le soutien des intérêts ébranlés de la Révolution ; l’armée, le vengeur de sa gloire humiliée. Pendant sa marche rapide à travers les populations qui se pressaient sur son passage, à la tête des troupes qui avaient été envoyées pour le combattre, et qui s’étaient rangées avec acclamation sous ses aigles, M. Comte sentit renaître toutes ses animosités contre l’ancien dictateur, auquel il ne pardonnait pas d’avoir, durant quinze ans, suspendu l’exercice de la liberté. Il craignait beaucoup plus pour celle-ci l’ascendant du génie ambitieux et armé que les prétentions de la légitimité vieillie, et il publia un écrit foudroyant sous ce titre : De l’impossibilité d’établir une monarchie constitutionnelle sous un chef militaire, et particulièrement sous Napoléon.
On imagine sans peine tout ce qu’il trouva d’idées ardentes, de souvenirs amers, de reproches violents, de conseils pathétiques, pour persuader a la nation de ne pas se laisser remettre sous le joug, à l’armée de rester fidèle à ses devoirs, de préférer son pays à son général. Malgré la véhémence de ce manifeste, dont trois éditions s’épuisèrent en quelques jours, une feuille royaliste accusa M. Comte d’être complice de Napoléon, et prétendit que le Censeur avait favorisé son retour, parce qu’il l’avait prévu. MM. Comte et Dunoyer, qui agissaient toujours sans égard au moment ni au péril, poursuivirent devant les tribunaux le rédacteur du journal comme les ayant calomniés.
La cause fut appelée le 19 mars, lorsque Napoléon entrait déjà dans Fontainebleau. La position des juges était délicate. Placés entre le gouvernement qui existait encore et le gouvernement qui allait exister bientôt, ils devaient éprouver quelque embarras à se prononcer : ce qui était délit aujourd’hui pouvait être un titre d’honneur demain. La prudence du journaliste accusé les tira de ce cas difficile. Il demanda l’ajournement de la sentence, dans l’espoir qu’il serait plus tard aussi impossible de la provoquer que de la rendre. C’était mal connaître MM. Comte et Dunoyer et leur opiniâtreté intrépide. Appelés devant la justice lorsque l’empereur fut remonté sur le trône, pour retirer une plainte devenue sans objet, ils y persistèrent, en faisant inscrire sur le registre du greffe que, « si l’imputation d’avoir coopéré au rétablissement du gouvernement impérial ne les exposait à aucune peine, celle d’avoir cherché à renverser le gouvernement établi les exposait au mépris public. »
Des adversaires aussi intraitables étaient trop à craindre pour qu’on n’essayât point de les gagner. Un ministre adroit, qui avait exercé l’art facile après les révolutions d’imposer silence aux idées en s’adressant aux intérêts, crut que ces écrivains rigides ne seraient pas plus que d’autres inaccessibles à ses séductions. Il les fit venir plusieurs fois auprès de lui. Après les avoir loués de leur patriotisme et de leur courage, il leur demanda, au nom de l’empereur, ce qui pourrait leur convenir. « Un bon gouvernement pour la France libre, répondirent-ils, et pour nous la continuation paisible de notre travail. » Ils résistèrent à toutes les flatteries comme à toutes les offres.
N’ayant pu assouplir leur rude indépendance, le même ministre chercha à l’entraver. Il fit arrêter le cinquième volume du Censeur, dans lequel les actes de l’Empire rétabli étaient discutés aussi hardiment que l’avaient été naguère ceux de la royauté restaurée. M. Comte se rendit sur-le-champ chez le préfet de police, et réclama le volume saisi. « Si nous avons mal raisonné, dit-il, il faut nous réfuter, si nous nous sommes rendus coupables, il faut nous punir. Le ministre croit que ses menaces auront plus d’effet sur nous que ses offres; il se trompe. Sous le dernier règne nous avons été menacés d’être assassinés par des fanatiques, et nous avons ri de leurs poignards. Aujourd’hui, je vous déclare que je me moque également des baïonnettes de Bonaparte. — Ah ! vous demandez le martyre, répondit le préfet. — Je ne cours pas après, répliqua M. Comte, mais je ne le crains pas. »
Secondé par le sentiment public, Comte l’emporta. Le volume saisi fut restitué et parut. Le Censeur continua ses libres discussions dans un moment où il convenait peut-être de s’occuper un peu moins des droits du pays, et de songer un peu plus il son salut. Ainsi que d’autres excellents citoyens, M. Comte ne comprit pas assez le changement survenu dans le rôle de l’empereur et la position de la France. Avant 1814, on pouvait considérer l’Empire sous deux points de vue différents : y voir une forme ou un oubli de la Révolution ; la consécration de ses intérêts ou l’abandon de ses principes; la dictature d’un grand homme qui s’était fait l’habile législateur de la nouvelle société civile, ou la domination d’un ambitieux qui avait substitué son pouvoir, comme sa pensée, aux droits d’un peuple libre et à la marche naturelle de l’esprit humain. Mais, en 1815, il n’en était pas ainsi. Cet immense besoin d’ordre, qui, au sortir de l’anarchie, avait précipité la nation vers le pouvoir d’un seul, n’existait plus; la liberté ne courait aucun péril. En présence du parti de l’ancien régime vaincu, mais menaçant; à l’approche de l’Europe coalisée s’avançant en armes. Napoléon n’était plus que le représentant de la Révolution, le défenseur du territoire. Il ne fallait pas, par des défiances intempestives, l’entraver et l’affaiblir; il ne fallait pas chercher comment et jusqu’à quel point on serait libre avant de savoir si l’on ne serait pas envahi, ni s’occuper subtilement à constituer la nation quand il s’agissait de la défendre. La question de liberté était dans ce moment subordonnée à la question d’indépendance ; car, si l’étranger était victorieux, la contre-révolution devenait triomphante.
C’est ce qui arriva après le désastre de Waterloo et la seconde abdication de Napoléon. MM. Comte et Dunoyer l’apprirent bientôt. Le même ministre qui avait voulu les gagner à la cause de l’empereur les plaça, pour servir sans doute la cause des Bourbons, sur une liste de bannis, d’où les fit rayer un autre ministre, depuis leur confrère dans cette Académie, et de qui l’on peut dire avec justice que, s’il a pris part ç beaucoup de changements politiques, il n’a pris part a aucun excès.
Les auteurs redoutés du Censeur ne furent pas condamnés à l’exil, mais au silence. Le septième volume de leur journal, qui contenait les débats de la Chambre des représentants, jusqu’à cette solennelle protestation faite la veille du jour où des soldats prussiens avaient fermé la salle de ses séances, et qui racontait les premiers excès de la réaction royaliste dans le Midi, fut saisi, et cette fois ne fut jamais rendu. M. Comte entreprit alors de défendre l’armée dans un écrit qui ne put pas paraître. La liberté de la presse ayant été interdite, la liberté individuelle suspendue, la justice prévôtale instituée, il fallut céder à la violence des temps et des lois, et M. Comte dut se taire pendant tout le temps de cette fougueuse réaction.
Mais cette trêve forcée ne fut point inutile pour lui : il y renouvela en quelque sorte ses munitions pour le combat. Dans la retraite où il vécut près de dix-huit mois, l’économie politique, qu’il connaissait vaguement, devint l’objet de son étude approfondie, et il eut pour principal instituteur M. J.-B. Say, dont il était l’ami, et dont il devait être bientôt le gendre. Le livre méthodique sur la formation, la distribution et la consommation des richesses, dans lequel M. Say, concentrant et complétant les doctrines d’Adam Smith, donna aux aperçus de ce grand observateur une forme plus régulière, et, par la vigueur des déductions autant que par la précision élégante du langage, chercha à rapprocher la science économique des sciences exactes, inspira un vif enthousiasme à M. Comte. Il adopta avec passion et d’une manière fort absolue les principes de cette science, qui lui parut à la fois l’instrument et la mesure de la civilisation des peuples. Elle le brouilla surtout avec les Grecs et les Romains, qui avaient eu jusque-là toute son admiration. Leurs fortes vertus n’obtinrent pas grâce pour leurs imperfections sociales. Ces auteurs admirables de tant d’idées immortelles, ces premiers fondateurs des sciences humaines, ces créateurs incomparables des arts de l’esprit, ces utiles dominateurs du monde, qui lui avaient donné l’unité de sa civilisation, et qui lui ont laissé la sagesse de ses meilleures lois, ne furent plus à ses yeux que des barbares, parce qu’ils avaient eu des esclaves, n’avaient pas pratiqué le travail libre, et n’avaient connu que les procédés de la force et l’industrie de la conquête.
C’est sous le drapeau de l’économie politique que M. Comte, de concert avec M. Dunoyer, dont les idées avaient éprouvé un changement analogue, rentra en campagne, lorsque la dissolution de la Chambre de 1815, et les tendances plus libérales du ministère, qui avait résisté aux emportements de cette Chambre, lui permirent de reprendre l’œuvre interrompue du Censeur. Les deux amis, toujours profondément attachés aux droits de leur pays, mais s’intéressant avec non moins d’ardeur aux progrès de tous les peuples, se sentirent animés de l’amour de la civilisation comme d’un patriotisme nouveau. Ils modifièrent le titre de leur journal, qu’ils appelèrent le Censeur européen, et qu’ils destinèrent, en lui donnant pour devise Paix et Liberté, à soutenir les intérêts universels des hommes, à tourner vers l’industrie l’activité des esprits, à combattre également les préjugés barbares du moyen âge et les passions ardentes de la Révolution, à s’élever contre les mœurs oisives de l’ancienne monarchie et les habitudes militaires de l’Empire, à diriger la société moderne sous une forme plus libre vers un but plus humain, en lui assignant le travail pour guide, la loi économique pour règle, le bien-être général pour fin. Ils formèrent à cet égard un système complet. Les théoriciens de 1780 avaient proclamé la souveraineté du droit populaire et eux professèrent la souveraineté plus inattendue de l’industrie. Ils ne se bornèrent point à penser que le gouvernement devait respecter la liberté absolue du travail, qui était le principe fondamental de la science économique; mais ils prétendirent encore que ce principe devait servir de base même au gouvernement. L’état des sociétés commandant la forme de leur organisation politique, il fallait, selon eux, à une société devenue de plus en plus laborieuse, une administration tirée des classes industrielles et animée de leur esprit.
Comte poussa ce système fort loin. Le développant avec une logique inflexible, il crut, dans sa bonne foi, trop inexpérimentée, que le triomphe de l’industrie réaliserait le bienfait de la paix perpétuelle, et substituerait à la longue l’heureux accord de la fraternité humaine aux luttes sanglantes des rivalités nationales. Il crut que les intérêts auraient la vertu d’annuler les passions, de supprimer les injustices, et que l’avide recherche des satisfactions matérielles ferait ce que n’avaient pu faire encore les plus nobles idées et les sentiments les plus désintéressés.
Pour marcher vers cet état que son enthousiasme croyait possible, M. Comte demandait qu’on licenciât les armées, et qu’on changeât les casernes en manufactures. L’utilité lui semblant être la seule mesure de la valeur des hommes, et le succès dans les professions privées le signe certain de leur capacité pour l’administration des intérêts publics, il voulait, dans les assemblées et dans les fonctions de l’État, des agriculteurs éprouvés, des manufacturiers intelligents, des négociants hardis, dos banquiers habiles, et il reléguait les savants dans les académies, les avocats au barreau, les grands seigneurs dans leurs manoirs, et les généraux aux Invalides. Il ne croyait pas les hommes d’État plus nécessaires que les hommes de guerre; et, pour montrer le cas qu’il faisait de ces derniers, il allait jusqu’à dire que le plus petit manufacturier était au-dessus du grand Pompée, et que César était au-dessous d’un bouvier. Il oubliait que les plus grands progrès de l’humanité ont eu pour représentants et pour défenseurs ses plus grands capitaines; que dans les victoires d’Alexandre était le triomphe de la civilisation grecque sur la barbarie orientale ; que César avait inauguré, par la défaite de l’aristocratie romaine, l’affranchissement et l’unité du monde ancien ; et que l’épée de Napoléon avait fait pénétrer, pendant quinze ans, le principe de la moderne égalité dans toute l’Europe. Il contestait également l’art difficile de gouverner les peuples, qui a toujours exigé des qualités si hautes et si rares, auxquelles ne préparent pas la gestion la plus heureuse des affaires particulières, et cette connaissance des intérêts généraux qu’est loin de donner la pratique trop assidue des intérêts privés ; art devenu encore plus compliqué sous le régime représentatif, où la nécessité d’expliquer ce qu’on projette, et de défendre ce qu’on fait, oblige d’ajouter l’habileté de l’orateur a la prudence du politique.
Quand on est jeune, a dit depuis M. Comte fort spirituellement, on frappe fort en attendant de frapper juste. Aussi reconnut-il un peu plus tard les exagérations d’un système que d’autres, vers cette époque, poussèrent même plus loin, en fondant sur l’industrie une religion dont ils se firent les prophètes. Malgré ce qu’il avait d’excessif et d’inapplicable dans ses doctrines, le Censeur européen facilita les progrès de la classe moyenne, prépara son avènement aux affaires, et contribua surtout, en répandant les idées économiques, à assurer aux intérêts matériels un triomphe que l’austère M. Comte trouverait peut-être trop grand, s’il vivait encore.
La polémique éloquente que les auteurs du Censeur européen soutinrent contre les actes de l’autorité fut utile à leur pays, mais périlleuse pour eux. Enfermé cinq mois à la Force dès 1817, pour ne pas s’être exprimé avec assez de respect sur ceux qu’on appelait nos alliés et qui tenaient encore notre territoire envahi, pour avoir osé dire que nous avions trop de gendarmes et pas assez de maîtres d’école, et s’être permis de provoquer l’établissement d’institutions municipales, M. Comte fut cité en 1818, comme ayant mal parlé des chouans, devant un petit tribunal de Bretagne, et distrait de ses juges naturels. La poursuite lui parut illégale et la résistance obligatoire. Un matin donc, les agents de la force publique s’étant présentés chez lui inopinément, il parvint à leur échapper, grâce à la présence d’esprit de sa jeune femme, qui facilita son évasion par un escalier dérobé, en enfermant dans une chambre, où elle les retint quelque temps prisonniers les gendarmes envoyés pour le saisir. Moins heureux que lui, M. Dunoyer fut conduit au fond de la Bretagne. Mais la fermeté avec laquelle il protesta contre un tribunal qui n’était pas le sien, et la discussion que du lieu de sa retraite M. Comte engagea contre le garde des sceaux, firent annuler cette procédure irrégulière, et consacrer par la cour de cassation le principe tutélaire qu’en matière de presse les écrivains ne pouvaient être jugés que là où ils publiaient leurs ouvrages.
Comte n’était pas au terme de ses tribulations. En 1820, la loi des élections ayant été changée, la censure rétablie, la sûreté individuelle suspendue, une souscription nationale fut ouverte en faveur de ceux que frapperaient des mesures arbitraires. M. Comte ayant annoncé cette souscription dans son journal, devenu depuis près d’un an quotidien, fut condamné à deux mois de prison et deux mille francs d’amende, la condamnation était bien légère; mais M. Comte ne la trouva pas fondée, et ne consentit point à la subir. Il résolut de s’expatrier pendant cinq ans, jusqu’à ce que sa peine fût légalement prescrite, et qu’il put rentrer dans son pays en vertu de son droit, sans avoir un instant cédé, sans s’être une fois démenti, préférant a une courte mais injuste captivité, un exil long mais volontaire.
Il quitta donc la France avec la compagne dévouée (il avait uni sa vie à la sienne depuis deux années), et il se rendit en Suisse. Il s’établit d’abord à Genève. Dans cette ville industrieuse et éclairée, en entendant parler la langue de son pays, en rencontrant des hommes aussi distingués par le mérite que ceux dont il venait de se séparer; en jouissant de l’illustre et douce amitié d’Etienne Dumont, qui avait été le collaborateur de Mirabeau et de Bentham; de Sismondi, qui venait d’achever son éloquente Histoire des républiques italiennes, et qui devait être un jour son confrère à l’Institut ; de Candolle, dont la science et la gloire commencées en France s’achevaient à Genève, il crut avoir retrouvé sa patrie avec presque autant d’esprit et un peu plus de liberté. La grande estime où l’avaient mis son caractère et ses talents lui fit offrir en 1821, par le canton de Vaud, la chaire de droit naturel, devenue vacante à Lausanne. Il l’accepta, et la remplit avec autant de savoir que d’éclat. De tous les côtés on accourait pour l’entendre et l’applaudir.
Mais le parti qui avait condamné ses écrits en France ne tarda point à étouffer sa voix en Suisse. En 1823, ce parti régnait sans obstacle d’un bout de l’Europe à l’autre. Il ne voulut souffrir aucune espèce de liberté sur le continent, et le paisible enseignement du droit par un exilé l’offusqua. Il demanda l’expulsion de M. Comte. Le canton directeur, pressé par l’ambassadeur de France qu’appuyaient les ministres de la sainte alliance, placé entre le danger de repousser cette injonction inhospitalière et la honte d’y céder, finit par conseiller au canton de Vaud de renvoyer M. Comte. Mais le canton de Vaud se montra plus soigneux de sa dignité. Il résista. Instruit de la périlleuse position où un plus long refus devait mettre ses hôtes, M. Comte vint noblement à leur aide. « Je reconnaîtrais mal, écrivit-il au landamman et aux conseillers d’État du canton, la confiance dont vous m’avez honoré en m’appelant à donner des leçons à la jeunesse de votre pays, si je souffrais qu’une lutte si pénible se prolongeât plus longtemps. À aucun prix je ne consentirai à être le prétexte d’une agression contre la Suisse ; vous voudrez bien permettre que je me relire, et que je mette ainsi un terme aux débats dont j’ai été ou dont je pourrais être encore le sujet. »
Comte donna sa démission, et, suivi des regrets universels, il partit pour un autre exil. Il ne lui restait plus d’autre asile que l’Angleterre. En arrivant dans ce grand et libre royaume , il y reprit ses travaux sur les législations, et il s’y lia surtout avec un homme dont l’esprit hardi et les doctrines indépendantes ne furent pas sans influence sur lui : je veux parler de ce docteur de l’utilité, de ce chimiste du droit, qui, dans le pays des traditions et sous le gouvernement de l’aristocratie, opposant la raison à la coutume, la justice aux privilèges, soumettait les institutions politiques et civiles a une analyse inexorable, ne reconnaissait la bonté des lois qu’h leur accord avec l’intérêt universel des hommes; du célèbre Jérémie Bentham, novateur à la fois généreux et sec, subtil et confus, original et fatigant, plus propre encore à argumenter qu’à découvrir, possédant surtout le génie des distinctions et des nomenclatures, et resté le chef sans imagination d’une école enthousiaste.
Dès que le temps exigé pour la prescription de sa peine fut écoulé, M. Comte reparut en France, on il essaya vainement de se faire inscrire sur le tableau des avocats de Paris. Il se livra alors presque exclusivement à la composition de l’œuvre qui, longtemps méditée, souvent interrompue, toujours reprise, fut terminée en 1827. Cette œuvre était son Traité de législation. Appartenant à l’école du dix-huitième siècle, disciple de Locke et de Condillac en philosophie, d’Adam Smith, de J.-B. Say et de Malthus en économie politique, émule de Bentham en législation, M. Comte appliqua aux sciences morales la méthode analytique qui, depuis la fin du dernier siècle, avait fait marcher si rapidement les sciences physiques, et se servit des principes économiques pour apprécier l’état et les constitutions des peuples. À ses yeux, la loi de la société c’est le perfectionnement de l’homme. Ce perfectionnement consiste dans la satisfaction de plus en plus régulière de ses besoins matériels, dans le développement de plus en plus libre de son intelligence, dans l’exercice de plus en plus juste de ses facultés morales, dans l’harmonie de plus en plus étendue de ses rapports avec ses semblables. Tel est le but initial vers lequel tend le genre humain à travers des formes sociales qui se brisent lorsqu’elles le compriment et l’arrêtent, et qui marquent chacun de ses pas sur la route de la civilisation.
On aimerait à suivre dans l’ouvrage de M. Comte la marche graduelle des peuples depuis les premières et informes ébauches de l’association politique, jusqu’aux grands empires de nos jours. Mais M. Comte n’a examiné, d’une manière nette et développée, que l’influence exercée sur les législations par l’action des climats combinée avec la nature des lieux, les violences de la guerre et les vices de l’esclavage. Le rapport que Malthus a établi entre les moyens de subsistance et le mouvement de la population, M. Comte l’étend à l’histoire, et veut en faire découler la plupart des actions des peuples et des formes de gouvernement. Il attribue à la recherche violente des moyens de subsistance les migrations et les conquêtes, la réduction en servitude des vaincus, l’organisation des vainqueurs en aristocraties militaires, et la fondation des États despotiques. Il y a du vrai dans cet aperçu, à condition de ne pas le pousser trop loin, et de ne pas substituer à la science de Montesquieu et de Machiavel la science d’Adam Smith et de Malthus, que l’esprit humain a eu raison de distinguer, et qu’il n’est point permis de confondre.
Comte insiste tellement sur l’état des peuples chez lesquels les lois étaient entachées de tyrannie, les moyens de subsistance demeuraient frappés d’incertitude, le travail était déshonoré par l’esclavage, qu’il n’a plus de place pour traiter le reste de son sujet. Malgré ses lacunes et ses longueurs, le Traité de législation est une œuvre sérieuse et savante. Les vues économiques qui y sont jetées éclairent souvent les institutions d’un jour nouveau. Bien qu’il veuille appliquer, dans sa rigueur et sa sécheresse, la méthode analytique, M. Comte à l’esprit trop résolu et l’âme trop bouillante pour exposer sans s’émouvoir les longues traverses de l’humanité. Je l’en loue; car l’historien et le juge des législations ne saurait être un observateur impassible, et les procédés du savant ne doivent pas éteindre en lui les sentiments du moraliste.
Un an après sa publication, cet ouvrage reçut la distinction la plus flatteuse, qui fut en même temps la récompense la mieux méritée. L’Académie française, on s’en souvient, avec une hardiesse inusitée mais opportune, élevant son imposante voix pour défendre les droits de plus en plus menacés de la pensée humaine, avait donné le signal de ce réveil de l’esprit public, de cet effort victorieux de la nation, qui, en 1827, avait assuré, dans des élections décisives, le triomphe de la liberté légale. Elle crut alors devoir honorer publiquement l’écrivain qui avait longtemps combattu et noblement souffert pour cette liberté, et M. Comte obtint, en 1828, le grand prix destiné par M. de Monthyon, et décerné par l’Académie française a l’ouvrage le plus utile aux mœurs.
Ce précieux suffrage l’encouragea dans la poursuite de ses travaux, que la Révolution de juillet Il s’interrompit un moment pour l’appeler à la Chambre et même aux affaires. Nommé député par les électeurs de la Sarthe, et devenu procureur du roi près le tribunal de la Seine, M. Comte ne conserva pas longtemps ces dernières fonctions, dont l’exercice à une époque de troubles politiques était assez difficile pour lui. Plus propre à attaquer un gouvernement qu’il n’aimait pas qu’à défendre un gouvernement qui lui convenait, moins disposé à poursuivre les autres qu’il ne l’avait été à se faire poursuivre lui-même, M. Comte ne tarda point à se séparer du procureur général, son chef, sur une question de poursuite politique, et cessa d’être procureur du roi. Rendu à l’indépendance, qui était un besoin de sa nature, et à l’opposition, qui était une habitude de son esprit. M. Comte fut bientôt reçu dans votre compagnie, où il n’était pas exposé à perdre l’une, et où il devait paisiblement exercer l’autre dans les fécondes controverses de la science. Il ne fut pas seulement élu membre de l’Académie reconstituée, il eut l’honneur insigne d’en devenir le secrétaire perpétuel.
Comte s’acquitta avec zèle des obligations que lui imposait votre choix. Mais il ne se borna point à conduire vos travaux, il continua les siens, et, comme pour se rendre encore plus digne de vos suffrages, il ajouta au Traité de législation le Traité plus précis, plus complet, plus concluant de la propriété. Ce sujet avait une sorte d’à-propos, et M. Comte, qui avait publié en 1817 un livre sur le jury, au moment où siégeaient les cours prévôtales ; qui avait écrit une histoire de la garde nationale en 1827, au moment où la garde nationale de Paris venait d’être brusquement dissoute, n’entreprit point sans opportunité, en 1854, d’exposer la nature, les règles et les effets de la propriété; car c’était en même temps la défendre contre les attaques des sectes sociales qui voulaient en changer les conditions. Dans son savant ouvrage, il assigne à la propriété son caractère fondamental et en suit les applications variées. Philosophe, il voit en elle non un principe abstrait, mais un besoin inhérent à l’homme, et il ne la fait point dériver d’une convention universelle, comme Grotius et Montesquieu, ni reposer uniquement sur la loi, comme Bentham. Économiste, il montre l’influence qu’exercent sur elle les changements survenus dans les valeurs, l’accroissement de la population, le progrès de la liberté et le respect du travail. Jurisconsulte, enfin, il se sert des législations comparées pour marquer les différences de la propriété dans les divers pays, pour examiner de grandes questions de droit public, pour traiter à fond les questions nouvelles de droit privé qui résultent des inventions des arts et des productions de la pensée. Il ne quitte pas son sujet sans jeter des hauteurs de la science et de l’histoire des mépris altiers sur ces systèmes conçus par les rêveurs de tous les temps, et repoussés par l’humanité comme contraires aux lois de sa nature ; systèmes qui, altérant le principe de la propriété, paralyseraient les mobiles de l’homme, détruiraient la constitution de la famille, ébranleraient la base de la société, et, loin d’être un moyen de progrès, seraient pour le monde une cause de décadence.
C’est comme votre secrétaire perpétuel que M. Comte, remplissant envers deux de ses éminents confrères le devoir que je remplis envers lui, a fait les éloges de Garat et de Malthus. À cette place même, nous l’avons entendu raconter d’un ton ferme et simple la vie à la fois rêveuse et agitée du premier, qui avait porté une imagination si brillante dans la philosophie, s’était engagé avec une naïveté si périlleuse dans une révolution, et que l’aveugle fortune appela un moment au gouvernement troublé des hommes, lui qu’elle n’aurait jamais dû détourner de la région paisible des idées. Mais M. Comte ne put pas lire lui-même son excellent travail sur Malthus, et vous exposer la théorie originale et profonde que ce sévère économiste a déposée d’une manière si hardie, d’autres ont dit si dure, dans l’Essai sur le principe de la population. Pendant qu’il composait avec une sorte de prédilection l’éloge de cet inexorable penseur, dont il admirait le génie pénétrant et dont il aimait la vie uniquement consacrée à la science et au bien, M. Comte était atteint d’une maladie qui paraissait ne devoir être que douloureuse, et qui était mortelle. Elle le saisit lorsqu’il était encore dans toute la vigueur de l’âge, brisa lentement son corps, épuisa peu à peu ses forces, et M. Comte se sentit enlever prématurément a la chère compagne qui s’était associée à ses pensées, l’avait suivi dans son exil, et aux quatre jeunes enfants qui avaient encore besoin de son appui comme de sa tendresse. C’étaient pour lui les côtés les plus douloureux de la maladie, et les plus grandes amertumes de la mort. Après plus de dix mois de souffrances, il expira le 13 avril 1837, à l’âge de cinquante-cinq ans, laissant de profonds regrets, de nobles exemples, d’utiles travaux, et une renommée pure.
Les temps où s’est distingué M. Comte sont déjà loin de nous. Ils sont loin de nous, les souvenirs de ces convictions généreuses, de ces luttes persévérantes, de ces intrépides dévouements qui animaient tant de fermes esprits, qui inspiraient tant de nobles conduites. Alors on croyait aux idées avec une foi vive, on aimait le bien public avec une passion désintéressée. Ces belles croyances, qui sont l’honneur de l’intelligence humaine, M. Comte les a eues jusqu’à l’enthousiasme; ces fortes vertus, qui sont aussi nécessaires à un peuple pour rester libre que pour le devenir, M. Comte les a portées jusqu’à la rudesse. C’est que son esprit comme son caractère était tout d’une pièce. Soit qu’il pensât, soit qu’il agît, il allait droit devant lui, au risque même, en attaquant un préjugé, de tomber dans une erreur. Il n’avait ni ces nuances dans la pensée qui donnent de la grâce au talent, en lui ôtant quelquefois la force, ni ces ménagements dans la conduite, qui sont la source de l’aménité, et qui peuvent être le principe de la faiblesse. S’il a quelquefois haï, il n’a jamais nui, car les indispositions qu’il ressentait contre les idées ne s’étendaient pas jusqu’aux personnes. Sous des formes un peu âpres, et avec des apparences froides, il avait cette bonté du cœur, cette chaleur de l’âme, cette élévation de sentiments, cette verve de la conviction qui se montrent à la fois dans ses écrits et dans sa vie. C’est par là qu’il a inspiré de solides affections, mérité l’estime universelle, et que sa mémoire sera honorée tant que notre pays demeurera fidèle au culte de la science, et gardera le souvenir de ceux qui l’ont servi.
A lire également :
Notice sur la vie et les travaux de Charles Dunoyer, par Mignet.
Entretien avec Robert Leroux sur l’industrialisme de Comte et Dunoyer.
L’âge d’or du libéralisme français. Anthologie, par David Hart et Robert Leroux.





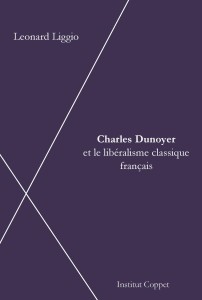
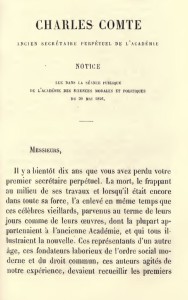




Laisser un commentaire