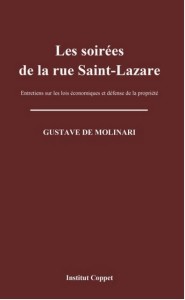 Les Soirées de la rue Saint Lazare
Les Soirées de la rue Saint Lazare
Introduction à l’ouvrage majeur de Gustave de Molinari.
Extrait de la revue Laissons Faire, numéro 15, décembre 2014.
Les années 1840 voient la montée du socialisme en France puis la révolution de 1848. Gustave de Molinari, l’un des principaux économistes du marché libre en France, écrit alors un « dialogue » fictif entre un économiste, un conservateur et un socialiste, pour exposer la folie du collectivisme et pour démontrer comment les lois économiques et le droit de propriété, bien compris suffisent à établir un ordre juste, pacifique et prospère. Les Soirées sont également célèbres pour la 11e conversation dans laquelle Molinari explique que de nombreux biens publics, y compris la police et les services de défense, pourraient être fournis volontairement par le marché libre. Acheter le livre ici (Éditions de l’Institut Coppet)
Par Damien Theillier
Gustave de Molinari est mort en 1912. Il est né à Liège le 3 Mars 1819 mais c’est en France qu’il a déployé son activité d’écrivain. Il a été le principal représentant du laissez-faire radical au sein de l’école libérale classique en France dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Disciple et ami de Frédéric Bastiat, il devint le second rédacteur en chef du Journal des Économistes (1881-1909), à la mort de Joseph Garnier, cédant ensuite sa place à son ami Yves Guyot. Comme Bastiat, Molinari a reconnu sa dette à l’égard des « industrialistes », les économistes Charles Comte et Charles Dunoyer. Comme eux, il fut radicalement individualiste et anti-étatiste, luttant contre toutes les formes d’interventionnisme économique. Écrivain prolifique, il était capable d’affronter ses adversaires sur tous les terrains : aussi bien la philosophie que le droit, la morale, la religion ou l’histoire.
La société, disaient les économistes du dix-huitième siècle, s’organise en vertu de lois naturelles ; ces lois ont pour essence la Justice et l‘Utilité. Lorsqu’elles sont méconnues, la société souffre ; lorsqu’elles sont pleinement respectées, la société jouit d’un maximum d’abondance, et la justice règne dans les relations des hommes. Le jeu des lois naturelles de la concurrence et de la valeur assure spontanément l’adaptation de la production aux besoins. Chaque individu cherche à satisfaire son intérêt personnel et à obtenir le maximum de rendement avec le minimum d’efforts. La juxtaposition et la rencontre de ces efforts individuels réalisent spontanément l’harmonie sociale.
Mais au XIXe siècle, la misère dont la classe ouvrière a souffert dans la première moitié du XIXe siècle semble avoir été la conséquence directe de la libre concurrence et du libre contrat. Dès lors, l’harmonisation spontanée des intérêts n’est-elle pas simplement une utopie sortie du cerveau d’économistes naïfs ? C’est pour répondre à cette accusation, venue de la gauche comme de la droite, que Gustave de Molinari a entrepris d’écrire ses fameuses Soirées de la rue Saint Lazare.
Plan de l’ouvrage
En fait, la vraie question à se poser selon Molinari est la suivante : la pauvreté a-t-elle sa source dans les lois économiques qui gouvernent la société ou dans les entraves apportées à l’action de ces lois ? Telle est la question cruciale posée dans la préface des Soirées de la Rue Saint Lazare.
A cette question il existe trois réponses possibles selon lui :
1° Les « socialistes » répondent en affirmant que les maux de la société proviennent des imperfections ou des vices des lois naturelles qui gouvernent le monde économique. Les plus timides concluent qu’il les faut modifier ; les plus audacieux sont d’avis qu’il faut faire table rase d’une organisation radicalement mauvaise et la remplacer par une organisation nouvelle.
La base sur laquelle repose tout l’édifice de la société, c’est la propriété ; les socialistes s’efforcent donc d’altérer ou de détruire le principe de la propriété.
2° Les « conservateurs » défendent la propriété ; mais ils la défendent mal, selon Molinari. Ils sont naturellement partisans du statu quo. Pour eux tout changement est mauvais. Ils font d’avantage confiance aux coutumes qu’aux théories. « A l’exemple de ces chrétiens ignorants et sauvages qui proscrivaient jadis les hérétiques au lieu de les réfuter, ils invoquent la loi, de préférence à la science, pour avoir raison des aberrations du socialisme ».
3° Les « économistes » reconnaissent la propriété comme la base de l’organisation naturelle de la société. C’est pourquoi les souffrances de la société, bien loin d’avoir leur origine dans le principe de la propriété, proviennent au contraire, d’atteintes portées à ce principe. D’où il faut conclure que la solution du problème de l’amélioration du sort des classes laborieuses consiste à affranchir la propriété de toute entrave directe ou indirecte.
Molinari entend défendre la thèse des économistes et suivre la voie qu’ils ont tracée. En effet, tous les économistes ont défendu la propriété, et l’économie n’est d’abord que la démonstration des lois naturelles qui ont la propriété pour base. De Quesnay à J.-B. Say, en passant par Turgot, Adam Smith et leurs disciples : Charles Dunoyer, Michel Chevalier, Frédéric Bastiat, Joseph Garnier, etc., tous ont passé leur vie à observer ces lois et à les démontrer.
La préface du livre donne le ton :
« Reconnaissant, dit l’auteur, avec tous les économistes, la propriété comme la base de l’organisation naturelle de la société, j’ai recherchée si le mal dénoncé par les socialistes, et que nul, à moins d’être aveugle ou de mauvaise foi, ne saurait nier, j’ai recherché si ce mal provient, oui ou non, de la propriété.
Le résultat de mes études et de mes recherches a été que les souffrances de la société, bien loin d’avoir leur origine dans le principe de la propriété, proviennent au contraire, d’atteintes directement ou indirectement portées à ce principe. D’où j’ai conclu que l’amélioration du sort des classes laborieuses réside dans l’affranchissement pur et simple de la propriété. »
Dans la première soirée, il pose les termes du problème social. Il établit que la société est gouvernée par des lois immuables, que l’on ne viole pas impunément. La première de ces lois, celle dont toutes les autres dérivent, est le droit de propriété, base de l’organisation naturelle de la société.
Dans les soirées suivantes, il passe successivement en revue les atteintes à la propriété et s’attache à faire ressortir les effets pervers qui en dérivent. Chemin faisant, il réfute, à mesure qu’elles se présentent devant lui, les doctrines opposées des deux adversaires qu’il s’est donnés.
Le socle du droit de propriété
Après John Locke, Molinari, comme nombre de libéraux français, situe l’origine de la propriété dans le prolongement de la personne humaine. « La propriété, explique-t-il, émane d’un instinct naturel dont l’espèce humaine tout entière est pourvue. Cet instinct révèle à l’homme avant tout raisonnement qu’il est le maître de sa personne et qu’il peut disposer à son gré de toutes les virtualités qui composent son être. » On comprend dès lors la distinction opérée par l’auteur entre la propriété intérieure et la propriété extérieure. La première est le droit pour chacun de disposer librement de ses facultés physiques, morales et intellectuelles comme du corps qui leur sert de support. Chacun est propriétaire de sa propre personne. La seconde, qui est un prolongement de la première, concerne les fruits du travail. Ce que j’ai produit avec mes propres facultés m’appartient de droit
La propriété n’est donc par une création de la société. Elle est un droit naturel que la société a précisément pour but de reconnaître, de proclamer et de protéger : « La société n’a pas institué la propriété ; c’est bien plutôt la propriété qui a institué la société. »
C’est pourquoi, selon Molinari, seul l’affranchissement complet de la propriété à l’égard de toutes ses entraves légales et artificielles peut sauver la société :
« J’affirme que les misères et les iniquités dont l’humanité n’a cessé de souffrir ne viennent point de la propriété ; j’affirme qu’elles viennent d’infractions particulières ou générales, temporaires ou permanentes, légales ou illégales, commises au principe de propriété. J’affirme que si la propriété avait été, dès l’origine du monde, religieusement respectée, l’humanité aurait constamment joui du maximum de bien-être que comportait, à chaque époque, l’état d’avancement des arts et des sciences, comme aussi d’une entière justice » (Première soirée, p. 39).
Les atteintes au droit de propriété
Qu’est-ce que l’esclavage ? C’est une privation de la propriété intérieure et/ou extérieure. Or, rappelle Molinari, « toute atteinte portée à la propriété intérieure ou extérieure, est contraire à l’Utilité aussi bien qu’à la Justice » (Première soirée, p. 43).
Quelles sont alors les formes modernes de l’esclavage ? Il y a esclavage chaque fois que l’Etat réglemente les échanges, taxe les produits, bloque les prix et les salaires, élève des barrières et des douanes, légifère sur l’héritage, fixe les taux d’intérêt, décide de la monnaie, organise le crédit, s’immisce dans les relations privées, la famille, l’éducation et la religion. Dans sa Troisième soirée, Molinari évoque les expropriations, toujours réalisées au nom de l’intérêt public, les lois sur les mines. Dans la Quatrième soirée, il aborde les lois sur l’héritage, puis sur l’exploitation agricole, dans la Cinquième, le prêt à intérêt, dans la Sixième, le code du travail, dans la Septième le commerce international etc.
Or cette usurpation abusive des forts sur la propriété des faibles est à l’origine d’une lutte qui traverse toute l’histoire humaine :
« Dès l’origine des sociétés, une lutte incessante s’est établie entre les oppresseurs et les opprimés, les spoliateurs et les spoliés; dès l’origine des sociétés, l’humanité a tendu constamment vers l’affranchissement de la propriété. L’histoire est pleine de cette grande lutte ! D’un côté, vous voyez les oppresseurs défendant les privilèges qu’ils se sont attribués sur la propriété d’autrui; de l’autre, les opprimés réclamant la suppression de ces privilèges iniques et odieux. La lutte dure encore, et elle ne cessera que lorsque la propriété sera pleinement affranchie. »
Ainsi la fameuse devise des Physiocrates « laissez-faire, laissez-passer », est un appel à limiter la sphère publique pour donner davantage de liberté à la sphère privée mais aussi pour affranchir la propriété des lois injustes qui l’entravent. C’est un appel aux autorités à laisser les producteurs s’organiser eux-mêmes selon la loi de l’offre et de la demande, pour produire et échanger de façon plus efficace et à moindre coût. C’est également un appel à la justice entendue comme le fait de ne pas traiter les individus comme des esclaves, sous quelque forme que ce soit.
Le gouvernement libre
C’est dans sa « Onzième Soirée », très controversée, que Molinari aborde le rôle du gouvernement. Et ce dernier propose d’aller bien au-delà de la défense d’un État minimum. Il propose en effet l’abolition pure et simple du « monopole de la sécurité » pour le remplacer par un système de concurrence entre des compagnies privées de protection des citoyens. Pendant longtemps, les économistes ont refusé de s’occuper non seulement du gouvernement, mais encore de toutes les fonctions purement immatérielles. J.-B. Say a fait entrer, le premier, cette nature de services dans le domaine de l’économie politique, en leur appliquant la dénomination commune de produits immatériels. En cela, il a rendu à la science économique un service plus considérable qu’on ne suppose :
« L’industrie d’un médecin, dit-il, et, si l’on veut multiplier les exemples, d’un administrateur de la chose publique, d’un avocat, d’un juge, qui sont du même genre, satisfont à des besoins tellement nécessaires, que, sans leurs travaux, nulle société ne pourrait subsister. Les fruits de ces travaux ne sont-ils pas réels ? Ils sont tellement réels qu’on se le procure au prix d’un autre produit matériel, et que, par ces échanges répétés, les producteurs de produits immatériels acquièrent des fortunes. — C’est donc à tort que le comte de Verri prétend que les emplois de princes, de magistrats, de militaires, de prêtres, ne tombent pas immédiatement dans la sphère des objets dont s’occupe l’économie politique. » (J.-B. SAY. Traité d’Économie politique, t. I, chap. XIII.)
En matière économique, dit encore Molinari, le gouvernement n’a qu’une chose à faire, c’est de « maintenir le milieu libre », ce qui veut dire que sa mission « consiste uniquement à assurer à chacun la conservation de sa propriété [sa personne, sa propriété intérieure et extérieure]. (Onzième soirée, p. 199) »
« Il y a aujourd’hui, dans le monde, deux sortes de gouvernements: les uns font remonter leur origine à un prétendu droit divin. Les autres sont issus de la souveraineté du peuple… Les premiers sont des gouvernements de monopole, les seconds sont des gouvernements communistes. »
Or toutes les fonctions du gouvernement doivent être soumises au jeu des lois de l’économie privée et concurrentielle.
« Au nom du principe de la propriété, au nom du droit que je possède de me pourvoir moi-même de sécurité, ou d’en acheter à qui bon me semble, je demande des gouvernements libres… c’est-à-dire, des gouvernements dont je puisse, au gré de ma volonté individuelle, accepter ou refuser les services. »
Pour ce qui est de la sécurité extérieure, l’importance de la tâche de l’État est destinée à aller en décroissant puisque la guerre jouera de moins en moins dans l’avenir le rôle utile qu’elle a joué dans le passé. Pour les services collectifs internes (justice, police, éclairage et pavage des rues, etc.), l’idéal serait que l’État s’adressât à des entreprises privées et conclût avec elles des contrats, en mettant autant que possible ces entreprises en concurrence les unes avec les autres.
Molinari est très conscient du fait que la sécurité est une des conditions de l’existence de l’individu à l’intérieur du groupe. Mais il souligne que le monopole étatique de la force est aussi inefficace que despotique. Selon lui, des entreprises privées comme les compagnies d’assurance pourraient fournir des services tels que la police et même la sécurité nationale à un prix plus avantageux, plus efficace et plus moral que ne pourrait le faire l’Etat. D’où il résulte « qu’aucun gouvernement ne devrait avoir le droit d’empêcher un autre gouvernement de s’établir concurremment avec lui, ou obliger les consommateurs de sécurité de s’adresser exclusivement à lui pour cette denrée ». Et c’est ce qu’il appelle « la liberté de gouvernement ».
« On ne gouverne pas à bon marché, lorsqu’on n’a aucune concurrence à redouter, lorsque les gouvernés sont privés du droit de choisir librement leurs gouvernants. Accordez à un épicier la fourniture exclusive d’un quartier, défendez aux habitants de ce quartier d’acheter aucune denrée chez les épiciers voisins, ou bien encore de s’approvisionner eux-mêmes d’épiceries, et vous verrez quelles détestables drogues l’épicier privilégié finira par débiter et à quel prix! Vous verrez de quelle façon il s’engraissera aux dépens des infortunés consommateurs, quel faste royal il étalera pour la plus grande gloire du quartier… Eh bien! ce qui est vrai pour les services les plus infimes ne l’est pas moins pour les services les plus élevés. Le monopole d’un gouvernement ne saurait valoir mieux que celui d’une boutique d’épiceries. La production de la sécurité devient inévitablement coûteuse et mauvaise lorsqu’elle est organisée en monopole. »
Par ailleurs, il explique que parmi les nombreux avantages d’une telle concurrence le plus important est la limitation des guerres. La guerre est toujours la conséquence du contrôle étatique de la production de sécurité.
« De même que la guerre est inévitable sous un régime de monopole, la paix est inévitable sous un régime de libre gouvernement. Sous ce régime, les gouvernements ne peuvent rien gagner par la guerre ; ils peuvent, au contraire, tout perdre. Quel intérêt auraient-ils à entreprendre une guerre ? serait-ce pour augmenter leur clientèle ? Mais, les consommateurs de sécurité étant libres de se faire gouverner à leur guise, échapperaient aux conquérants. Si ceux-ci voulaient leur imposer leur domination, après avoir détruit le gouvernement existant, les opprimés réclameraient aussitôt le secours de tous les peuples…. Les guerres de compagnie à compagnie ne se feraient d’ailleurs qu’autant que les actionnaires voudraient en avancer les frais. Or, la guerre ne pouvant plus rapporter à personne une augmentation de clientèle, puisque les consommateurs ne se laisseraient plus conquérir, les frais de guerre ne seraient évidemment plus couverts. Qui donc voudrait encore les avancer ? Je conclus de là que la guerre serait matériellement impossible sous ce régime, car aucune guerre ne se peut faire sans une avance de fonds. »
Conservatisme et socialisme
En conclusion, qu’est-ce que le socialisme et qu’est-ce que le conservatisme ? En quoi le libéralisme, qu’incarne l’économiste, est-il la seule doctrine réaliste et juste à la fois ?
Le socialisme, c’est d’abord une protestation contre les troubles, les désordres, les misères de la société actuelle. Or ces désordres et misères sont engendrés par une série d’abus. En effet, les lois humaines, en tant qu’elles violent la propriété ou le droit, jettent le trouble dans la société et engendrent plupart de nos misères.
L’économiste ne cesse de le répéter : il existe une organisation naturelle, fort supérieure à tout ce que peuvent imaginer de vains utopistes, parfaite dans son essence, immuable dans ses lois, bien que perfectible. Vouloir lui substituer une organisation artificielle ne peut que semer le trouble et le désordre des révolutions.
Supprimez les abus d’où ces misères dérivent, et le socialisme tombe de lui-même, parce qu’il a perdu sa raison d’être. Mais le problème des conservateurs, c’est qu’ils veulent préserver le droit de propriété de nouvelles atteintes, tout en laissant subsister par ailleurs les abus du passé : toutes les lois qui le violent ou le restreignent. Au fond, ils sont les défenseurs de l’ordre établi et donc du statu quo :
« Les conservateurs, constate Molinari, défendent la propriété; mais ils la défendent mal. Les conservateurs sont naturellement partisans du statu quo ; ils trouvent que le monde va bien comme il va, et ils s’épouvantent à la seule idée d’y rien changer. Ils évitent, en conséquence, de sonder les profondeurs de la société, dans la crainte d’y rencontrer des souffrances qui nécessiteraient une réforme quelconque dans les institutions actuelles. D’un autre côté ils n’aiment pas les théories, et ils ont peu de foi dans les principes. Ce n’est qu’à leur corps défendant qu’ils engagent une discussion sur la propriété; on dirait qu’ils redoutent la lumière pour ce principe sacré. A l’exemple de ces chrétiens ignorants et sauvages qui proscrivaient jadis les hérétiques au lieu de les réfuter, ils invoquent la loi, de préférence à la science, pour avoir raison des aberrations du socialisme. »
Au contraire, l’économiste veut réformer l’ordre actuel, conformément aux saines doctrines. Et c’est seulement à ce prix, nous dit Molinari, que le socialisme cesserait d’être un danger, et pourrait même de disparaître entièrement.
Damien Theillier
Extrait de la revue Laissons Faire, numéro 15, décembre 2014.
Acheter le livre ici (Éditions de l’Institut Coppet)


Bonjour,
Il y a certains points conceptuellement flous dans cet article, et tous suivent la même ligne directrice.
Au fond, je m’étonne que cette approche philosophique ne soit pas revendiquée comme utopiste (on pourrait très bien défendre l’idée que la nature est un idéal, et que la civilisation éloigne de cet idéal, il n’y a pas de contradiction ici), et je soupçonne Molinari de vouloir s’écarter de cette position utopiste par stratégie :
“L’économiste ne cesse de le répéter : il existe une organisation naturelle, fort supérieure à tout ce que peuvent imaginer de vains utopistes, parfaite dans son essence, immuable dans ses lois, bien que perfectible. Vouloir lui substituer une organisation artificielle ne peut que semer le trouble et le désordre des révolutions.
Supprimez les abus d’où ces misères dérivent, et le socialisme tombe de lui-même, parce qu’il a perdu sa raison d’être.”
Avant de contester ce point, je voudrais discuter la thèse centrale, fondatrice de ce libéralisme, celle de Locke qui est illustrée dans le Second Traité du Gouvernement Civil.
On pourrait résumer rapidement son propos en deux points, il existe un état naturel : l’abondance, commune à tous les hommes, et une loi naturel, fondée sur un principe pragmatique (d’efficacité pratique) : les hommes se servent dans cette abondance pour se conserver (la propriété intérieure justifie la propriété extérieure, pour reprendre les termes du texte), et le travail (intentionnalité (virtualité) + effort (réalisation)) fonde une seconde justification à cette propriété extérieure. En cas de litige on pourrait dire : nous en avons tous les deux besoins mais moi j’ai fais l’effort, ou je l’ai fais plus tôt : le fruit m’appartient.
Et c’est là que Molinari bascule dans l’utopie, où dans la création d’une société ahistorique idéale.
Locke, premièrement, est réaliste, et fonde sa pensée dans l’histoire, “la tourbe qu’a coupée mon serviteur” devient ma propriété. En effet chez Locke pas de morale présupposée, il va au bout de sa thèse, mon serviteur je l’ai acquis par la force, par le travail, en tout cas par cette intention (réalisée) en acte qui constitue ma propriété extérieure. Et on comprend bien qu’avec cet axiome pratique, cette conséquence est inévitable, on peut tout à fait justifier la servitude volontaire par la nécessité de conservation de sa propriété intérieure par une mise à disposition de sa propriété extérieure à un autre.
Deuxièmement, Locke ignore l’idée d’intérêt collectif, ce qui constitue la limite de sa portée historique, lui-même finit par se placer dans un cadre utopiste d’abondance. En effet lorsque il y a crise, comme le rappelle Rousseau, l’idée d’appropriation d’une ressource devient nettement moins évidente, l’effort consacré est-il réellement le seul étalon de justice ?
Si oui alors une conséquence : qu’est ce qui empêche l’autre de m’arracher par la force le produit de mon travail ? Il n’y a pas de morale présupposée, l’état de nature le permet, même, peut le justifier en dernière instance : toujours cette idée de propriété intérieure qui fonde la propriété extérieure.
Et là on comprend l’intérêt de Molinari à cacher l’utopie dans sa théorie.
Pour revenir à sa thèse, Molinari invente un homme naturel qui fonde sa prospérité dans sa propriété individuelle qui s’épanouit dans une société créée pour lui, à sa mesure : « Au nom du principe de la propriété, au nom du droit que je possède de me pourvoir moi-même de sécurité, ou d’en acheter à qui bon me semble, je demande des gouvernements libres… c’est-à-dire, des gouvernements dont je puisse, au gré de ma volonté individuelle, accepter ou refuser les services. ».
Mais ce système est intenable si il n’est pas automatiquement fondé par des lois morales, deus ex machina qui n’ont rien de naturel : interdiction d’attenter à la propriété intérieure d’autrui (ma foi qu’est ce qui m’en empêche, si je m’arrange pour que cela n’ait aucune répercussion sur mon intégrité physique, et les exemples historiques sont nombreux), et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.
Au fond Molinari invente ce qui Nietzsche appelle la tyrannie des faibles, une société régit par des lois économiques, elles-mêmes justifiées par des lois morales implicites, fondée dans un supposé état de nature qui s’en prévaut simplement pour éviter de penser le fondement de ces axiomes moraux.
“Supprimez les abus d’où ces misères dérivent, et le socialisme tombe de lui-même, parce qu’il a perdu sa raison d’être.”
Mais qui supprime ? Qui a intérêt à supprimer ? Pourquoi supprimer si ce n’est pour réinventer un homme nouveau, encore plus utopiste que le socialiste ? Un homme qui n’est capable de bien que par intérêt économique (encore faut il qu’il en ait le désir), doit être maintenu dans une forme de servilité, car la maximisation de son intérêt ne va pas forcément avec celui des autres, penser à Freud par exemple.
Molinari dans une superbe inversion de sens, accuse l’État d’être la cause de la pauvreté, comme si le marché, lui, était capable de redistribution juste. Car enfin il faut penser avec l’histoire, qui oserait affirmer que le laisser faire se soucis de moral ? A moins encore une fois d’inventer un homme, à mille lieux de l’homme naturel et de l’état de nature (relire Hobbes).
J’aimerais donc que ce monsieur m’explique quelle puissante volonté s’occupera de redistribuer les cartes de la propriété, sans spoliation des plus riches par les plus pauvres. Quel est le lien magique entre laisser faire et suppression des maux ? Quel intérêt a celui qui ne possède rien de vivre dans une société où à la fois le riche n’est pas soumis à la justice transcendantale de l’état, et où le pauvre se voit priver de recours puisque c’est l’économie qui dirige les actions militaires ?
Que l’on m’explique comment satisfaire l’homme du ressentiment, le misérable, sans priver celui qui possède de sa sacro-sainte propriété extérieure.